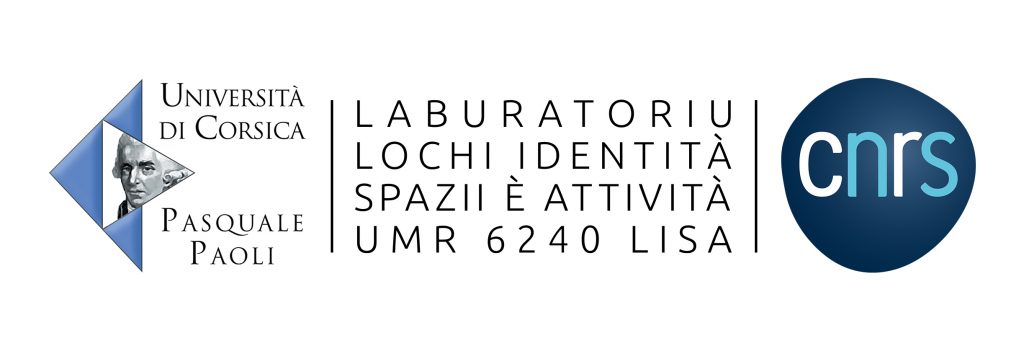L’Université, une affaire de civilisation
Francine Demichel
Notre société est de plus en plus technicienne, techniciste, technicisée. Elle veut tout mesurer, tout compter, tout calculer. La technique est devenue notre milieu de vie, totalisant, automatisant. Pour lutter contre cette société technicienne, technicisée, qui mesure tout, il nous faut parier sur une culture de la complexité, de l’insaisissable. Pour ne pas se laisser enfermer dans la compétence technique, technicienne, autoritaire, cherchant à tout maîtriser, il faut dépasser l’hermétisme, le totalitarisme, la primauté des moyens sur les fins, l’augmentation systématique de la production, la prolifération des incertitudes. Alors que la logique technicienne vit dans le présent, en niant le temps, la technique est devenue une méthode de gouvernement, organisant la rareté, détruisant les solidarités. La technique tend à faire du savoir mécanique une valeur d’échange, en négligeant sa valeur d’usage. Il ne peut y avoir de culture technique, en raison de l’universalité et de l’uniformité de celle-ci. La technique repose sur l’idéologie de la productivité. L’aléatoire disparaît. On y circule dans le vide social, on s’y croise sans s’y rencontrer.
L’Université n’est ni dans les rapports marchands ni dans le champ politique. Elle est dans un milieu singulier, original, autonome, collectif, fait de cooptation et d’inconditionnalité, d’imaginaire social, d’utopie, d’extraordinaire. C’est un espace illimité, dédié au savoir, hospitalier, désintéressé. On pénètre dans un système post-obligatoire, où se pratiquent le don, la gratuité, l’esthétisation. L’Université est un des rares lieux publics où tout n’est pas calculé à la minute près, où l’on peut gaspiller son temps, prendre plaisir à la flânerie, à la conversation, à la rêverie. Les rapports sociaux d’amitié non dominés par l’argent, peuvent largement contrebalancer les rapports marchands. La parole y circule librement et égalitairement. Cette circulation libre et égale, se place hors des contraintes de la division du travail capitaliste. L’Université fait reculer l’ argent dans les rapports sociaux, conquiert un « élément », met en place des régimes de désir ne reposant pas sur le souci d’acquérir des biens, sur la raison calculatrice. La puissance du capitalisme, c’est qu’il nous inculque des normes qui marquent nos corps, faites pour le corps, et mises dans le corps : cette capture des corps fonctionne à la séduction. Plutôt que de vivre « sans », l’Université nous apprend à accepter de vivre « avec » l’imperfection, l’impureté, la finitude. Elle nous apprend à saisir non ce qui est en place, à sa place, dans son rôle, mais ce qui bouge, qui est fluide, qui ne reste pas en place, qui fait des plis et des replis ; en un mot, qui est insaisissable.
L’Université n’est pas une institution d’argent, elle ne privilégie pas l’avoir sur l’être, elle ne surestime pas l’emprise sur les choses. Le réel de l’argent, inconnu à l’Université, veut qu’il n’y ait pas de perte, que tout se garde, que tout soit en ordre. Alors que le bourgeois ne veut rien perdre, ni son passé ni son patrimoine, l’universitaire sait perdre, il mesure l’insignifiance. Il sait que tout renvoie à tout, que tout bouge, que rien n’est solidifié, que tout est singulier, différencié : la seule permanence est celle de l’inconditionnalité.
C’est ainsi que la recherche fait ses preuves, mais à long terme. On ne peut lui demander des comptes au jour le jour. Chaque domaine de recherche produit sa propre temporalité, ses propres exigences, ce qui exclut toute normalisation étatique. Chaque objet de recherche a ses spécificités parmi les autres, et non pas comme les autres.
Les Universités ne sont pas en concurrence les unes avec les autres, mais dans une collaboration complémentaire. La recherche innovante peut être partout et les classements sont inopérants. A condition que les sciences se décloisonnent et qu’une attention particulière soit portée aux limites, aux ruptures, aux frontières, aux séparations entre disciplines et objets de recherche. Toute recherche enrichit l’enseignement et inversement, tout en sachant que la recherche innovante se situe plus souvent dans les marges, à la périphérie, qu’au centre du système. C’est pourquoi elle n’intéresse pas les grosses structures. L’Université est le lieu par excellence de la diversité, de la différenciation, des processus minoritaires. L’essentiel est de pratiquer la morale « rhizomique », antihiérarchique, anti-autoritaire, anticonformiste. Cette morale universitaire est un « impératif catégorique ». Il faut accepter l’hétérogénéité, dans une Université ouverte et pluraliste, décentralisée, sans spécialisation fermée, pratiquant la transdisciplinarité, rejetant le saupoudrage technologique. Il faut assumer les erreurs, les défaillances, les contradictions. L’Université est de l’ordre du sacré et non du nécessaire, elle est un révélateur d’une structuration sociale déterminée. Fondée sur l’inachèvement du savoir, par auto-création continue, l’Université, lieu non obligatoire pour les étudiants et les enseignants, se construit elle-même, à travers chaque établissement, à l’aide de son propre esprit critique, de ses pensées « contre », de ses scandales intellectuels, de ses capacités de résistance. Tout cela permet de comprendre pourquoi, à l’Université, on enseigne aussi ce qui ne s’enseigne pas sans cesse et sans fin.
Page 1
Le savoir possède une puissance de soulèvement qui renverse les frontières des possibles, engendre le geste critique, qui trie, tranche, crible, tamise. L’Université c’est, non seulement le partage du savoir mais aussi le « partage du sensible » (Jacques Rancière), et c’est aussi le désir de ce qui n’est pas, le désœuvrement de ne-pas, la révolte sans violence, les explosions de l’histoire, les vagues de « devenirs minoritaires », sans digues, dans l’allégresse de la fête qui déferle dans la liberté, laquelle est flux, mouvement, désir, incandescence. L’Université est le seul lieu où s’opèrent à la fois le partage du savoir et le « partage du sensible ». Tel un essaim d’abeilles, chaque individu jette, projette ses émotions, ses sentiments. Le cours est la parfaite illustration de ce partage et du « nous » ainsi constitué, à travers les affects divers et irréductibles les uns aux autres. Au-delà d’un discours de l’ordre, le cours est fait d’une multitude de discours, de paroles fondatrices d’un imaginaire commun, imaginaire interminable, fait de ratés, d’échecs, de bifurcations.
Le monde se couvre partout de murs, bâtis pour empêcher les humains de se rencontrer, de s’entraider, de s’émanciper. Par opposition aux murs, qui fabriquent des ennemis, l’Université est une des rares institutions ouvertes, sans murs, accueillant l’Autre. Il ne s’agit ni de se séparer ni de se replier, ni de surveiller, ni d’isoler, ni d’exercer une vigilance sécuritaire. L’Université est une brèche dans un espace encerclé de frontières. Le savoir, quand il est lié au sensible, sert de passage à la transgression, à la subversion, à l’altérité, une vie autre, déplacée vers autrui, libérée de tout assujettissement. L’Université est un lieu d’envol, un « amplificateur psychique ». La subjectivation s’élargit, la vie devient spacieuse. A travers ses lignes de fuite et ses plissements, l’Université élargit les espaces de vie. Elle aide à s’émanciper, à agir au large de soi-même, en recréant une véritable resubjectivation, afin de devenir autre.
Aujourd’hui, le rôle de la science dans le mouvement social est déterminant. C’est pourquoi la recherche est au milieu du système sociétal, pour développer la démocratie. Ainsi, une recherche, pour être applicable socialement, doit fonctionner, non par disciplines, mais par fonctions, de façon transdisciplinaire, sans évaluation a priori, ni pilotage administratif tatillon. La recherche a besoin de désordre, d’effervescence, de controverses. Lieu d’utopie, l’Université doit porter l’ailleurs en elle. Diffusant la parole hérétique, elle reste le lieu de passage de l’universel au singulier, du général au particulier ; elle le fait par le singulier-universel, et cela concerne la qualité des rapports entre le savoir et le sujet. L’Université démontre, que le savoir, l’invention intellectuelle ne sont pas dissociables de l’intérêt social, de l’expérimentation sociale. C’est pour cela que l’Université doit fonctionner à l’inconditionnalité.
A l’Université, rien n’est écrit d’avance. Chaque événement exprime et représente un ailleurs qui prolonge l’ici, le proche. L’universitaire sait qu’il faut parfois « accommoder les restes », que l’histoire ce n’est pas la politique de la table rase. A l’Université, on déterre l’histoire, pour qu’elle ne soit pas seulement l’histoire des vainqueurs, des dominants, mais celle des révoltés, des insurgés, des rebelles, de celles et ceux qui secouent le monde, agitent le réel, pratiquent l’intranquillité.
Institution d’influence, l’Université n’est pas une institution de pouvoir. En revanche, elle a pour fonction de désobéir au réel, pour inventer d’autres possibles et dépayser ce réel avec un véritable savoir. C’est pourquoi la parole universitaire est porteuse de vérité, au-delà de l’affirmation du réel. L’Université est le seul lieu où l’on enseigne ce que l’on ne sait pas, où l’on transmet ses doutes, ses incertitudes, où le chercheur jongle avec l’imprévisible. On subvertit les normes, ainsi, non seulement on enseigne un savoir, mais on forme un sujet, on lui montre comment être lui-même, comment s’émanciper. Plus généralement, l’Université montre ce qui n’est pas dit, ce qui est caché dans la société, l’invisible. Notre société a peur des mots, et cela permet au pouvoir de porter atteinte à la liberté d’expression, y compris dans les universités, où l’auto-censure se développe. Le débat universitaire inconditionnel doit pourtant s’y poursuivre, y compris dans la conflictualité. L’Université doit être un lieu d’explication et de compréhension, sinon d’excuse.
Page 2
Qu’elles soient au centre des villes ou à leur périphérie, les universités sont au milieu de la société, en tant que lieux de puissance, sinon de pouvoir, lieux où s’expriment le désir inconditionnel d’apprendre et la parole inconditionnelle de la liberté de penser. Cela est d’autant plus indispensable que le bruit ambiant, parfois vacarme, devient terrorisant. Ainsi naît un terrorisme qui détruit le mythe dionysiaque, terrorisme accentué par une technique qui nous acclimate à la reproduction sociale. Le savoir, lui, est indéfini, dans un mouvement infini, toujours recommencé, dans une puissance d’invention incessante. L’Université ne se contente pas du faire ni du fait. Dans une société qui bavarde, mais ne transmet plus, envahie par des objets banalisés, uniformisés, indifférenciés, mais qui ne parlent plus à l’Histoire, l’Université oppose ses paroles, où rien n’est écrit d’avance : chaque événement intellectuel exprime et représente un ailleurs, qui prolonge l’ici, le proche.
C’est dans l’Université que l’on peut apprendre dans la liberté et le savoir se crée dans la Joie.
Il nous reste à inventer, à fabriquer autrement l’humanité. C’est là une magnifique mission pour l’Université.
Page 3
D'autres articles

L’enseignement doit-il être une affaire d’état ? Réflexions personnelles d’un universitaire Corse
Ma réponse est oui. L’enseignement c’est un tout qui repose sur trois piliers : un lieu ; un budget ; un savoir. L’enseignement, à première vue, c’est tout d’abord un lieu où il faut pouvoir le dispenser. Dans l’Antiquité grecque, c’était sous les portiques du temple d’Apollon, allées couvertes qui laissaient passer la « lumière » d’où le nom de « lycée ». Je…

Annexe, Extraits des pages 141 à 151 du Testament politique d’Alberoni
« L’aveugle prévention des Anglois, ne laisse aucun espoir de leur retour vers leur Souverain naturel. C’est à lui de se faire, par sa valeur & sa conduite, le rang qu’ils lui refusent, & de se bâtir à leurs dépens un trône, qui lui tienne lieu de celui où ils ne veulent pas le faire monter.
La postérité ne pardonnera point au Prince Edouard, d’avoir…

Théodore, l’Angleterre et le projet d’Alberoni pour la Corse
Au cours du XVIIIe siècle, la Corse a fait l’objet de bien des spéculations de la part des États européens. Les nationaux, dans leur combat pour venir à bout de l’occupant génois, ont tenté en permanence de s’appuyer sur ces ambitions, afin de trouver des alliés de circonstance : non sans de nombreuses désillusions. De ce point de vue, l’épisode qui…