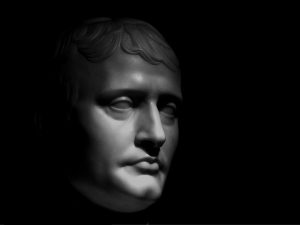La commémoration du bicentenaire du décès de Napoléon est l’occasion de revenir sur la trace qu’il laisse dans l’histoire au travers de deux de ses successeurs à la tête de l’État qui sont parfois comparés à lui : son neveu Louis-Napoléon-Napoléon III et Charles de Gaulle1La comparaison se fait généralement deux à deux. Alors que Patrice Gueniffey a donné Napoléon et De Gaulle. Deux héros français (Paris, Perrin, 2017) et que Francis Choisel compare Napoléon III et De Gaulle dans Bonapartisme et gaullisme (Paris, Albatros, 1987), nous préparons avec Pierre Branda, un Napoléon et Napoléon III. Destins croisés pour Perrin..
Si l’un et l’autre sont arrivés au sommet de l’État puis l’ont quitté à des âges bien plus avancés que le sien, Napoléon ayant même quitté le pouvoir à un âge où De Gaulle n’était même pas encore entré dans l’Histoire2Respectivement, 40 et 62 ans dans le premier cas, 53 ans et 78 dans le second, contre 30 et 45 ans., et si les contextes sont différents puisque le premier empereur est fils des Lumières, son neveu de la révolution industrielle et De Gaulle de la Grande Guerre, ils sont les seuls avec Louis-Philippe, François Mitterrand et Jacques Chirac à avoir exercé d’aussi longs passages aux affaires, mais surtout des passages qui peuvent se comparer en raison de leur caractère marquant.
Cette analyse abordera synthétiquement et successivement la vision et l’action politique des trois hommes, les aspects économiques et sociaux de leur programme et enfin leur rapport à l’Europe et au monde.
- Une vision politique
Trois destins forgés dans l’adversité de personnalités qui ont cru en leur étoile et qui se sont vues en hommes providentiels, trois figures passées par une formation militaire qui les singularise du personnel politique traditionnel et qui leur apprend à gouverner, leur donne l’habitude du contrôle et leur enseigne que toute erreur si infime soit-elle peut avoir de graves conséquences, trois grands simulateurs et dissimulateurs disciples de Machiavel, trois réalisateurs de coups d’éclat pour prendre le pouvoir (Napoléon Bonaparte, les 18 et 19 Brumaire an VIII), pour s’y maintenir (le président Louis-Napoléon Bonaparte, le 2 décembre 1851), ou pour y revenir (Charles de Gaulle le 13 mai 1958), en profitant d’un contexte de crise et de l’incapacité des dirigeants politiques d’alors à la résoudre (celle du Directoire avec la guerre extérieure, celle de la Deuxième République avec l’impasse constitutionnelle et celle de la Quatrième République avec la guerre d’Algérie), trois hommes d’État qui ont su discerner le sens de l’Histoire.
Louis-Napoléon assume totalement la source d’inspiration de son oncle dans le culte duquel il a été élevé par sa mère, la reine Hortense, elle-même, belle-fille, fille adoptive et belle-sœur de Napoléon et dont il a fait une lecture littérale de l’œuvre, en prenant le Mémorial de Sainte-Hélène pour bréviaire dès sa publication en 1823, au point de le citer constamment dans ses propres ouvrages, de réaliser son coup d’État le jour anniversaire du sacre de Napoléon et de sa plus belle victoire, Austerlitz, et d’affirmer reprendre son modèle dans le préambule de sa Constitution du 14 janvier 1852. De son côté, De Gaulle a pu invoquer sa légitimité contre la légalité, en juin 1940, en une formule qui n’est pas sans rappeler celles de ses deux prédécesseurs, mais il ne va pas jusqu’à se revendiquer explicitement de leur héritage politique : « Les deux Empires avaient pour un temps empêché la dispersion, mais moyennant la dictature3Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, Paris, Plon, 1970, rééd. Omnibus, 1996, tome 2, chapitre 1er, p. 237. ». Il faut préciser ici que ses détracteurs se chargent de le faire pour lui, de Raymond Aron pendant la Deuxième Guerre mondiale à François Furet, Jacques Duclos et François Mitterrand au début de la Cinquième République. Il y a pourtant une parenté indéniable entre le bonapartisme tel que pratiqué par Napoléon, celui qui est théorisé et appliqué par son neveu et le gaullisme du général, ainsi que l’ont souligné René Rémond et maints autres analystes à la suite, dont Francis Choisel4René Rémond, Les Droites en France, Paris, Aubier-Montaigne, 1982 [1954], et Francis Choisel, ouv. cité..
Comme Napoléon, ses deux successeurs ont la même conviction qu’à chaque peuple correspond une Constitution. « Non seulement un même système ne peut convenir à tous les peuples, écrit Louis-Napoléon, mais les lois doivent se modifier avec les générations, avec les circonstances, plus ou moins difficiles5Considérations politiques et militaires sur la Suisse [1833], Napoléon III, Œuvres, Paris, Plon et Amyot, 1869, t. 2, p. 341. ». Et encore : « Une Constitution doit être faite uniquement pour la nation à laquelle on veut l’adapter. Elle doit être comme un vêtement qui, pour être bien fait, ne doit aller qu’à un seul homme6Des Idées napoléoniennes, chapitre 3 [1839], dans Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. I, p. 98-99. ». Charles de Gaulle lui fait écho : « Des Grecs, jadis, demandaient au sage Solon : « Quelle est la meilleure Constitution » ? Il répondait : « Dites-moi d’abord pour quel peuple et à quelle époque7Discours de Bayeux du 16 juin 1946, Mémoires d’espoir et allocutions et messages, ouv. cité, rééd., Omnibus, 1996, p. 314. ».
Page 1
[1]. La comparaison se fait généralement...
La comparaison se fait généralement deux à deux. Alors que Patrice Gueniffey a donné Napoléon et De Gaulle. Deux héros français (Paris, Perrin, 2017) et que Francis Choisel compare Napoléon III et De Gaulle dans Bonapartisme et gaullisme (Paris, Albatros, 1987), nous préparons avec Pierre Branda, un Napoléon et Napoléon III. Destins croisés pour Perrin.
[2]. Respectivement, 40 et 62 ans dans...
Respectivement, 40 et 62 ans dans le premier cas, 53 ans et 78 dans le second, contre 30 et 45 ans.
[3]. Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir...
Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, Paris, Plon, 1970, rééd. Omnibus, 1996, tome 2, chapitre 1er, p. 237.
[4]. René Rémond, Les Droites en France...
René Rémond, Les Droites en France, Paris, Aubier-Montaigne, 1982 [1954], et Francis Choisel, ouv. cité.
[5]. Considérations politiques et militaires...
Considérations politiques et militaires sur la Suisse [1833], Napoléon III, Œuvres, Paris, Plon et Amyot, 1869, t. 2, p. 341.
[6]. Des Idées napoléoniennes, chapitre 3...
Des Idées napoléoniennes, chapitre 3 [1839], dans Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. I, p. 98-99.
[7]. Discours de Bayeux du 16 juin 1946...
Discours de Bayeux du 16 juin 1946, Mémoires d’espoir et allocutions et messages, ouv. cité, rééd., Omnibus, 1996, p. 314.
Ces constitutions, du Consulat, de l’Empire et des Cent-Jours pour Napoléon Bonaparte, de la République et de l’Empire de 1852 et de l’Empire libéral de 1870 pour Louis Napoléon-Napoléon III et de la Cinquième République pour Charles de Gaulle sont courtes et amendables. Comme Louis-Napoléon le résume dans le préambule du texte de 1852 en rappelant son oncle : « L’Empereur disait au Conseil d’État : « Une Constitution est l’œuvre du temps ; on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations ». « Aussi la constitution présente n’a-t-elle fixé que ce qu’il était impossible de laisser incertain. Elle n’a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d’un grand peuple ; elle a laissé aux changements une assez large voie pour qu’il y ait, dans les grandes crises, d’autres moyens de salut que l’expédient désastreux des révolutions8Bulletin des lois de la République française ; Xe série, 1re semestre 1852, t. IX, Imp. nationale, août 1852, n° 479, p. 49 et suiv.. » De Gaulle modifie la Constitution de 1958 en introduisant quatre ans plus tard l’élection présidentielle au suffrage universel direct.
Ces Constitutions, ratifiées ou préparées par des plébiscites (an VIII, an X, an XII, 1815, 1851, 1852), des référendums (1958 et 1962) ou un plébiscite à caractère référendaire qui sert de transition entre ceux-là et ceux-ci (1870), présentent bien des similitudes. En 1852, la première Constitution de Louis-Napoléon tend vers celles de son oncle ; en 1870, la seconde annonce celle de De Gaulle. Celui-ci reprend l’histoire constitutionnelle là où, d’une certaine façon, elle s’était arrêtée. Lois fondamentales et pratiques du pouvoir se ressemblent.
Chez Napoléon III et De Gaulle, il y a le même souci que chez Napoléon de s’appuyer sur une idée fondatrice, directrice et forte et lorsque le président de la Cinquième République affirme : « La politique (est) l’action au service d’une idée forte et simple », il fait écho à la politique de ces deux prédécesseurs9Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, ouv. cité, rééd. Omnibus, 1996, tome 1, p. 274.. Cependant aucun des trois ne fait non plus preuve d’esprit de système et ils sont, au contraire, profondément pragmatiques. Louis-Napoléon Bonaparte définit ainsi la politique de son oncle : « L’empereur Napoléon ne commit pas la faute de beaucoup d’hommes d’État, de vouloir assujettir la nation à une théorie abstraite, qui devient alors, pour un pays, comme le lit de Procuste ; il étudia, au contraire, avec soin le caractère du peuple français, ses besoins, son état présent ; et d’après ces données, il formula un système, qu’il modifia ensuite suivant les circonstances10Des Idées napoléoniennes, chapitre 3 [1839], dans Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. I, p. 99-100. ».
On retrouve chez eux le même culte des principes fondamentaux de 1789, de l’État et de la nation, la même volonté d’assumer tout le passé national. « De Clovis jusqu’au Comité de salut public, je me sens solidaire de tout », lance Napoléon Bonaparte en devenant Premier consul11Lucian Regenbogen, Napoléon a dit. Aphorismes, citations et opinions, Paris, Les Belles Lettres, 1998, 2002, p. 15., ce que Louis-Napoléon traduit en : « Non seulement je reconnais les gouvernements qui m’ont précédé, mais j’hérite en quelque sorte de ce qu’ils ont fait de bien ou de mal12Discours du 1er décembre 1852 devant le Sénat et le Corps législatif, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 352-354. » et De Gaulle en : « Il n’y a qu’une histoire de France13Discours du 6 septembre 1964 à Reims sur le site INA.fr. ». On retrouve aussi le même sentiment que la France est faite pour une république monarchique ou une monarchie républicaine, la même aspiration à « concilier l’ordre et la liberté, les droits du peuple et le principe d’autorité, le même primat du politique, le même sentiment que l’homme d’État animé d’une volonté est en capacité de pouvoir, la même conviction de la nécessité d’un exécutif fort qui soit pleinement responsable de ses actes devant le peuple souverain et qui établisse un lien direct avec lui, y compris en se rendant au contact direct des populations par des voyages à travers la France, la même aspiration à dépasser les clivages politiques partisans, la même idée que le parlementarisme doit être « rationnalisé », subordonné, divisé. Au « Gouverner par un parti c’est se mettre tôt ou tard dans sa dépendance : on ne m’y prendra pas ! Je suis national », de Napoléon14Lucian Regenbogen, ouv. cité, p. 19., répond le « Soyons les hommes du pays et non les hommes d’un parti » de son neveu15Discours devant l’Assemblée le 20 décembre 1848, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 29-31., et le « Le fait que les partisans de droite et les partisans de gauche déclarent que j’appartiens à l’autre côté, prouve précisément ce que je vous dis, c’est-à-dire que, maintenant comme toujours, je ne suis pas d’un côté, je ne suis pas de l’autre, je suis pour la France » de Charles de Gaulle16Entretien télévisé avec Michel Droit du 15 décembre 1965, Mémoires d’espoir, Paris, Plon, 1970, rééd. Omnibus, 1996, tome 2, p. 972.. On retrouve enfin, le même art de choisir ses subordonnés et de les faire se transcender (Molé, Rouher, Debré), la même aspiration à s’appuyer sur les hommes de talent de toutes provenances, sur l’expertise d’une haute fonction publique de qualité et sur les meilleurs spécialistes de chaque profession. Après Napoléon Ier qui affirme : « Un gouvernement en appelant à soi toutes les intelligences, travaille dans son propre intérêt17Lucian Regenbogen, ouv. cité, p. 60. », Louis-Napoléon entend « appeler aux fonctions publiques les hommes (…) les plus honnêtes, les plus capables, sans s’arrêter à leurs antécédents politiques18Message du 7 juin 1849 à l’Assemblée législative, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 43 et suiv. » et De Gaulle rappelle : « Personnellement, je ne me suis (…) jamais occupé de savoir de quelle famille spirituelle provenaient les hommes qui voulaient collaborer avec moi. Je tâchais de les juger seulement d’après leurs capacités, leur dignité et leur bonne volonté19Conférence de presse du 12 novembre 1947, Mémoires d’espoir, Paris, Plon, 1970, rééd. Omnibus, 1996, tome 2, p. 376 et suiv. ».
Les trois hommes sont des modernisateurs en phase avec leur temps, car ils ont compris, comme le souligne Louis-Napoléon que : « Marchez à la tête des idées de votre siècle, ces idées vous suivent et vous soutiennent. Marchez à leur suite, elles vous entraînent. Marchez contre elles, elles vous renversent20Fragments historiques, 1688 et 1830, chapitre V, conclusion, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. I, p. 329 et suiv. ». Ils arrivent au pouvoir avec un plan réformateur mûri et la conviction que les changements doivent se faire vite pour réussir. L’année qui suit le coup d’État du 2 décembre et les années 1944-1945 et 1958-1965 sont des échos du grand Consulat, des moments d’intenses réformes.
Napoléon, Napoléon III et de Gaulle jouissent d’une grande popularité, mais sont aussi très clivants, comptent des ennemis irréductibles dont certains attentent à leur vie : la rue Saint-Nicaise, Orsini, le Petit-Clamart… Ils en réchappent toujours et parfois même miraculeusement. Arrivés au pouvoir avec l’appui d’une grande partie des élites désireuses de se trouver un sauveur, Napoléon et De Gaulle tombent après avoir été lâchés par elles lorsqu’ils leur sont apparus comme des handicaps. Napoléon III dénote par rapport à eux en s’étant imposé contre la majorité des élites et en succombant après avoir pourtant réussi à les rallier.
Page 2
[8]. Bulletin des lois de la République...
Bulletin des lois de la République française ; Xe série, 1re semestre 1852, t. IX, Imp. nationale, août 1852, n° 479, p. 49 et suiv.
[9]. Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir...
Charles de Gaulle, Mémoires d’espoir, ouv. cité, rééd. Omnibus, 1996, tome 1, p. 274.
[10]. Des Idées napoléoniennes, chapitre...
Des Idées napoléoniennes, chapitre 3 [1839], dans Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. I, p. 99-100.
[11]. Lucian Regenbogen, Napoléon...
Lucian Regenbogen, Napoléon a dit. Aphorismes, citations et opinions, Paris, Les Belles Lettres, 1998, 2002, p. 15
[12]. Discours du 1er décembre 1852...
Discours du 1er décembre 1852 devant le Sénat et le Corps législatif, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 352-354.
[13]. Discours du 6 septembre 1964 à...
Discours du 6 septembre 1964 à Reims sur le site INA.fr.
[14]. Lucian Regenbogen, ouv. cité, p. 19.
Des Idées napoléoniennes, chapitre 3 [1839], dans Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. I, p. 99-100.
[15]. Discours devant l’Assemblée le 20...
Discours devant l’Assemblée le 20 décembre 1848, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 29-31.
[16]. Entretien télévisé avec Michel Droit...
Entretien télévisé avec Michel Droit du 15 décembre 1965, Mémoires d’espoir, Paris, Plon, 1970, rééd. Omnibus, 1996, tome 2, p. 972.
[17]. Lucian Regenbogen, ouv. cité, p. 60.
Lucian Regenbogen, ouv. cité, p. 60.
[18]. Message du 7 juin 1849 à l’Assemblée...
Message du 7 juin 1849 à l’Assemblée législative, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 43 et suiv.
[19]. Conférence de presse du 12...
Conférence de presse du 12 novembre 1947, Mémoires d’espoir, Paris, Plon, 1970, rééd. Omnibus, 1996, tome 2, p. 376 et suiv.
[20]. Fragments historiques, 1688 et 1830...
Fragments historiques, 1688 et 1830, chapitre V, conclusion, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. I, p. 329 et suiv.
II L’importance des considérations économiques et sociales
Si Napoléon, Napoléon III et De Gaulle, font passer la politique avant toute autre considération, tous trois se préoccupent beaucoup plus des questions économiques que la plupart des chefs d’État de leur temps. Ils envisagent une représentation politique des intérêts économiques et sociaux, Napoléon Bonaparte dans la Constitution qu’il donne à la République italienne en 1802, puis dans l’Acte additionnel aux constitutions de l’Empire en 1815, Louis-Napoléon Bonaparte-Napoléon III en faisant entrer massivement les représentants des affaires économiques au Corps législatif, grâce à la candidature officielle, et De Gaulle en projetant de fusionner le Sénat et le Conseil économique et social. Ils sont surtout convaincus que la confiance publique est le préalable indispensable dont les acteurs économiques ont besoin pour développer leurs affaires. Il en découle la nécessité d’institutions stables.
Napoléon est le créateur de la Banque de France et du franc germinal et l’introducteur des nouveaux principes budgétaires. Il demande des rapports quotidiens sur la situation de la Trésorerie, le prix des denrées, le cours de la rente, la qualité des récoltes, les difficultés des entreprises…21Voir Pierre Branda (dir.), L’Économie selon Napoléon, Paris, Vendémiaire, 2016. Cela traduit sa volonté d’assurer la puissance de la France ainsi qu’une préoccupation d’ordre public, bien davantage qu’une sensibilité au sort des humbles.
Ici, Napoléon III annonce plus de Gaulle qu’il n’est l’héritier de son oncle. Autant par piété familiale et par admiration pour le grand homme que par auto-persuasion et volonté de légitimer ses propres projets, il prête parfois à ce dernier des pensées qu’il n’a pas eues et prend en l’occurrence pour argent comptant l’affirmation de sa mère que Napoléon se souciait beaucoup du sort des ouvriers. Chez lui, au contraire, la préoccupation est réelle. Marqué par l’industrialisation et la question sociale qui en découle, il s’inspire ouvertement dans ses jeunes années de la Constitution de 1793 : « Le but de la société est le bonheur commun. Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d’exister à ceux qui sont hors d’état de travailler. » L’impôt est nécessaire. Les riches doivent le comprendre car la paix sociale est à ce prix. « La pauvreté ne sera plus séditieuse lorsque l’opulence ne sera plus oppressive », écrit-il dans L’Extinction du paupérisme, au milieu des années 184022Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. II, p. 150-151..
Très inspiré par le saint-simonisme, il imagine un système mixte qui ne soit ni du capitalisme libéral, ni du socialisme étatique mais qui emprunte aux deux ce qu’ils ont de meilleur. Il est moins interventionniste que son oncle en économie23Voir Éric Anceau, « Napoléon III, empereur libéral ? », dans Pierre Branda (dir.), L’Économie selon Napoléon, Vendémiaire, 2016, p. 385-402.. Ses voyages en Angleterre et la lecture des principaux économistes politiques contrebalancent son penchant naturel vers le socialisme. Il faut « éviter cette tendance funeste qui entraîne l’État à exécuter lui-même ce que les particuliers peuvent faire aussi bien et mieux que lui24Manifeste électoral en vue de l’élection présidentielle du 10 décembre 1848, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 27. », affirme-t-il, ou encore « le plus grand danger, peut-être, des temps modernes vient de cette fausse opinion qu’un gouvernement peut tout, et qu’il est de l’essence même d’un système quelconque de répondre à toutes les exigences et de remédier à tous les maux25Discours prononcé le 11 novembre 1849 à Paris, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 119.. » En revanche, il revient à l’État de créer les conditions du développement par le crédit, les infrastructures, l’aménagement du territoire, les transports, mais aussi de définir une stratégie d’ensemble cohérente et de grandes orientations. Le Haut-Commissariat au Plan créé par De Gaulle à la Libération et qui connaît un apogée quand il revient aux affaires en 1958 n’est pas sans rappeler les lettres-programmes détaillées de Napoléon III, en particulier celle de janvier 1860.
Néanmoins, pour l’un comme pour l’autre, l’économie n’est jamais une fin en soi et s’articule toujours avec le social. Pour Louis-Napoléon, la prospérité économique est le levier essentiel du progrès social et l’organisation du travail un moyen de résoudre les maux de la société. L’ouvrier doit être associé à la marche de l’entreprise et tirer les dividendes de sa réussite. De Gaulle lui fait ici écho : « C’est l’économie qui me paraît l’emporter sur tout le reste, parce qu’elle est la condition de tout et en particulier la condition du progrès social26Entretien télévisé avec Michel Droit du 13 décembre 1965, Mémoires d’espoir et Allocutions et messages, ouv. cité, p. 956. » et la participation gaullienne ressemble beaucoup à l’association du second empereur27Voir en particulier le fragment du 23 juillet 1869 en AN 400 AP 54.. Rien de tel chez Napoléon.
Page 3
[21]. Voir Pierre Branda (dir.), L’Économie...
Voir Pierre Branda (dir.), L’Économie selon Napoléon, Paris, Vendémiaire, 2016.
[22]. Napoléon III, Œuvres, ouv. cité...
Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. II, p. 150-151.
[23]. Voir Éric Anceau, « Napoléon III...
Voir Éric Anceau, « Napoléon III, empereur libéral ? », dans Pierre Branda (dir.), L’Économie selon Napoléon, Vendémiaire, 2016, p. 385-402.
[24]. Manifeste électoral en vue de...
Manifeste électoral en vue de l’élection présidentielle du 10 décembre 1848, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 27.
[25]. Discours prononcé le 11 novembre...
Discours prononcé le 11 novembre 1849 à Paris, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 119.
[26]. Entretien télévisé avec Michel...
Entretien télévisé avec Michel Droit du 13 décembre 1965, Mémoires d’espoir et Allocutions et messages, ouv. cité, p. 956.
[27]. Voir en particulier le fragment...
Voir en particulier le fragment du 23 juillet 1869 en AN 400 AP 54.
Il est également fascinant de rapprocher le manifeste de Louis-Napoléon Bonaparte, candidat à la présidence de la République en novembre 1848 et son discours de Bordeaux qui annonce le passage à l’Empire quatre ans plus tard, d’une part, des prises de paroles publiques de De Gaulle rappelé aux affaires en juin 1958 : retour de la confiance, restauration des finances de la France, économies qui permettent de diminuer les impôts sans désorganiser les services publics, libération des capacités d’initiative des entreprises.
En revanche, le premier se singularise du second, lorsque devenu empereur, il a les mains libres. Il applique en effet la théorie des dépenses productives et accepte que soient lancés de grands emprunts alors que De Gaulle se montre beaucoup plus attaché au dogme de l’équilibre budgétaire comme pouvaient l’être Napoléon et la plupart des dirigeants du XIXe siècle.
Si le Blocus continental amène Napoléon à concevoir un espace économique européen dont son Empire serait le centre et qui exclut l’Angleterre et s’il incite même les rois de Naples et de Hollande à créer les mêmes subdivisions monétaires qu’en France pour faciliter les échanges dans cet espace28Voir J.-M. Thiveaud, « Monnaie universelle, unique, unitaire, cosmopolite, internationale… Petite anthologie de quelques siècles de projets monétaires entre utopie et réalité », Revue d’économie financière, vol. 36, n° 1, 1996., il reste avant tout un homme de son temps, très attaché au mercantilisme colbertien. En revanche, Napoléon III dénote en étant l’instigateur du traité de janvier 1860 libéralisant les échanges entre la France et la Grande-Bretagne, des autres traités commerciaux bilatéraux qui le suivent et de l’Union monétaire latine de décembre 1865. C’est ici De Gaulle qui apparaît en position intermédiaire. Héritant de la Communauté économique européenne mise en place un an avant son retour au pouvoir, il joue le jeu, tout en n’hésitant pas à pratiquer la politique de la chaise vide quand il estime que les intérêts français sont lésés et en refusant obstinément de faire entrer la Grande-Bretagne dans le Marché Commun.
- Une vision planétaire
Les questions internationales sont aussi centrales chez Louis-Napoléon-Napoléon III et De Gaulle qu’elles l’étaient pour Napoléon. L’objectif premier et constant des trois hommes d’État est la grandeur de la France. Depuis 1789, celle-ci se sent investie de la mission de répandre les Lumières et les droits de l’homme à travers l’Europe et Napoléon Bonaparte qui a été l’un de ses principaux missionnaires bottés de la Révolution en est le premier convaincu et continue cette politique sous le Consulat et l’Empire avant tout par le fer et par le feu et secondairement par la diplomatie.
Même s’ils usent principalement de celle-ci, dans le cas de Napoléon III, et exclusivement d’elle, dans celui de De Gaulle, l’un et l’autre sont les héritiers de l’empereur, y compris en recourant comme lui à des coups de théâtre. Ils considèrent aussi que la France ne peut souffrir la médiocrité. De Gaulle qui la destine à « des succès achevés ou des malheurs exemplaires29Mémoires de guerre, Paris, Plon [1954], rééd. Omnibus, 1996, t. 1, chapitre 1er, p. 9. » fait ainsi écho à Louis-Napoléon lorsqu’il affirme : « Il faut qu’une nation comme la nôtre, si elle s’engage dans une lutte colossale, puisse justifier, à la face du monde, ou la grandeur de ses succès, ou la grandeur de ses revers30Message du 7 juin 1849 à l’Assemblée législative, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 69.. »
Page 4
[28]. Voir J.-M. Thiveaud, « Monnaie...
Voir J.-M. Thiveaud, « Monnaie universelle, unique, unitaire, cosmopolite, internationale… Petite anthologie de quelques siècles de projets monétaires entre utopie et réalité », Revue d’économie financière, vol. 36, n° 1, 1996.
[29]. Mémoires de guerre, Paris, Plon...
Mémoires de guerre, Paris, Plon [1954], rééd. Omnibus, 1996, t. 1, chapitre 1er, p. 9.
[30]. Message du 7 juin 1849 à...
Message du 7 juin 1849 à l’Assemblée législative, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 69.
En ce domaine de la politique étrangère aussi, le neveu défend la politique de son oncle, lequel n’aurait entrepris que des guerres défensives pour protéger et répandre les bienfaits de la Révolution et aurait cherché à libérer les peuples asservis, à bâtir une Europe plus juste, à garantir la paix par une large confédération des nations, avant que le Congrès de Vienne de 1814-1815 n’anéantisse ses projets31En particulier aux chapitres IV et V de Des Idées napoléoniennes, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 69..
Louis-Napoléon considère que la France doit montrer la voie aux autres peuples en défendant leur droit à disposer d’eux-mêmes. Il est l’inventeur et le principal promoteur du principe des nationalités. Face aux deux géants en train d’émerger, la Russie et les États-Unis d’Amérique dont il a prophétisé l’avènement peut-être à la suite de son oncle32« En mourant je laisse deux vainqueurs, deux hercules au berceau : la Russie et les États-Unis d’Amérique », Napoléon, 1820, Lucian Regenbogen, ouv. cit., 1998, 2002, p. 55. et certainement conjointement avec Tocqueville, il estime que l’Europe doit s’organiser autour de la France pour continuer de faire entendre sa voix. Dans ce but, il considère que l’expansion coloniale est un facteur de dispersion de l’énergie nationale, mais se ravise, une fois devenu empereur, et appuie l’implantation en Nouvelle-Calédonie, au Sénégal et en Cochinchine ainsi que la « pacification » de l’Algérie qui s’achève sous son règne, à la fin des années 1850. Néanmoins, convaincu que l’assimilation de celle-ci à la métropole est impossible, il promeut l’idée d’un royaume arabe associé à la France. De Gaulle lui rend hommage sur ce point et déplore que le projet n’ait pu aboutir. Lui aussi se pose surtout en champion d’une troisième voie entre les deux grands, en adversaire des blocs et en défenseur des nationalités33Ainsi, à titre d’exemple, le 14 mai 1968 en Roumanie : « Notre Europe commence à se rétablir dans l’indépendance de chacune de ses nations ». Et le lendemain devant l’Assemblée nationale roumaine : il dénonce « le honteux effacement des souverainetés nationales ».. Comme Napoléon III souhaite réviser l’ordre international établi par le Congrès de Vienne, il entend remettre en cause le monde de Yalta.
Ces changements doivent s’opérer par la diplomatie et par la médiation de grands congrès internationaux, non par les armes. La saine concurrence que les États souverains doivent se livrer est économique. La réponse de De Gaulle au toast du président bolivien du 28 septembre 1964 : « Que (chaque peuple) transforme en émulation créatrice et productrice par rapport aux autres nations ce qui fut et demeure trop souvent rivalité d’ambitions » fait ici écho au discours de Louis-Napoléon Bonaparte à l’Exposition de l’industrie le 31 août 1849 : « Aujourd’hui, c’est par le perfectionnement de l’industrie, par les conquêtes du commerce, qu’il faut lutter avec le monde entier34Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 105.. »
L’un et l’autre dépassent l’horizon européen. Lors de la campagne d’Égypte, Napoléon Bonaparte avait repris de l’Antiquité le projet d’un canal dans l’isthme de Suez, mais c’est son neveu qui en permet la réalisation, en appuyant l’initiative de Ferdinand de Lesseps. Quant à De Gaulle, il porte la bonne parole à travers le monde. Il referme les plaies ouvertes au Mexique par Napoléon III, comme ce dernier avait refermé celles ouvertes par Napoléon en Espagne. Napoléon III et De Gaulle pratiquent une politique de réimplantation au Nouveau Monde, là où Napoléon avait vendu la Louisiane et s’était désintéressé du Canada français.
Les deux empereurs achèvent leur parcours par des défaites militaires et par des exils en terre anglaise, Waterloo et Sainte-Hélène dans un cas, Sedan et Chislehurst dans l’autre. Quant à De Gaulle, il se retire après une défaite politique, le référendum de 1969, et choisit un exil intérieur et volontaire à Colombey. Avec le domaine de La Boisserie, le petit cimetière et le Mémorial, le village lorrain est devenu depuis sa mort un lieu de pèlerinage très fréquenté à l’instar des Invalides pour Napoléon. L’abbaye de Farnborough où se trouve la sépulture de Napoléon III l’est dans une bien moindre mesure et l’exil en terre étrangère n’explique pas tout.
Dans la mémoire collective de la nation, Napoléon et De Gaulle ont laissé une trace bien plus grande que Napoléon III. En témoignent aussi et surtout les sondages qui les placent régulièrement en tête, quand il est exceptionnel que le premier président et dernier empereur de notre histoire y figure, même en queue de classement. Contrairement à eux sur lesquels le récit officiel s’est toujours plus ou moins appuyé depuis 1830 dans un cas, 1970 dans l’autre, en dépit de voix discordantes, lui a été un repoussoir qui a permis à la République de s’affirmer en effaçant une œuvre imposante derrière le coup d’État initial et la débâcle finale. Il constitue pourtant un maillon essentiel de l’histoire qui va de l’un à l’autre. Formons le vœu (pieux ?) que 2023 permette une aussi digne commémoration du cent-cinquantenaire de sa mort, que celles dont De Gaulle a bénéficié en 2020 et Napoléon en 2021.
Page 5
[31]. En particulier aux chapitres IV...
En particulier aux chapitres IV et V de Des Idées napoléoniennes, Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 69.
[32]. « En mourant je laisse deux...
« En mourant je laisse deux vainqueurs, deux hercules au berceau : la Russie et les États-Unis d’Amérique », Napoléon, 1820, Lucian Regenbogen, ouv. cit., 1998, 2002, p. 55.
[33]. Ainsi, à titre d’exemple, le 14 mai...
Ainsi, à titre d’exemple, le 14 mai 1968 en Roumanie : « Notre Europe commence à se rétablir dans l’indépendance de chacune de ses nations ». Et le lendemain devant l’Assemblée nationale roumaine : il dénonce « le honteux effacement des souverainetés nationales ».
[34]. Napoléon III, Œuvres, ouv. cité...
Napoléon III, Œuvres, ouv. cité, t. III, p. 105.