Résumé : L’expression et la compréhension de l’expérience émotionnelle ne sont ni universelles ni univoques. L’expérience émotionnelle résulte de l’interaction complexe de déterminants culturels, sociologiques, économiques, historiques et juridiques. La conceptualisation du bonheur diffère ainsi considérablement entre la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud et le Japon, révélant une pluralité de modèles sociétaux distincts. En Chine, bien qu’une conception individualiste du bonheur émerge au sein de la population, la Constitution montre un syncrétisme opéré entre l’idéal confucéen d’harmonie sociale et l’idéologie marxiste-communiste, à travers la notion de prospérité commune et de bien-être, structurant le discours politique et les projets de développement à long terme. Le bonheur collectif est privilégié. En Corée du Nord, si dans les textes fondateurs du régime, la conception du bonheur était d’inspiration marxiste, elle a évolué vers la doctrine Juche, adoptant une vision nationaliste de prospérité de la patrie, bien que la réalité ne corresponde en rien à ses prétentions constitutionnelles. Contrairement à la Chine et à la Corée du Nord, qui ont rejeté la conception occidentale individualiste du bonheur, la Corée du Sud et le Japon l’ont embrassée en l’intégrant dans leur Constitution avec la notion de « droit à la poursuite du bonheur ». La dimension culturelle confucéenne a toutefois été préservée avec l’inclusion de la notion de bien commun. Ce droit a été rendu effectif par le système constitutionnel diffus japonais, et le système concentré coréen, ce dernier présentant des résultats plus significatifs.
Mots-clés : droit à la poursuite du bonheur ; prospérité commune ; communisme ; droit constitutionnel ; bien-être.
Abstract : The expression and understanding of emotional experience are neither universal nor unambiguous. Emotional experience arises from the complex interaction of cultural, sociological, economic, historical and legal determinants. The conceptualization of happiness thus differs considerably between China, North Korea, South Korea and Japan, revealing a plurality of distinct social models. In China, although an individualistic conception of happiness is emerging among the population, the Constitution reflects a syncretism between the Confucian ideal of social harmony and Marxistcommunist ideology, articulated through the notion of common prosperity and well-being. This framework structures political discourse and long-term development plans, prioritizing collective happiness. In North Korea, while the founding texts of the regime initially drew upon a Marxist conception of happiness, this later evolved into the Juche doctrine, adopting a nationalist vision of the nation’s prosperity, though reality starkly contrasts with its constitutional claims. Unlike China and North Korea, which rejected the Western individualistic notion of happiness, South Korea and Japan embraced it by incorporating the “right to the pursuit of happiness” into their constitutions. However, they preserved the Confucian cultural dimension through the inclusion of the common good. This right has been effectively implemented through Japan’s decentralized constitutional system and South Korea’s centralized system, with the latter yielding more significant results.
L’expression et la perception des émotions s’inscrivent dans une perspective diachronique, comme démontré par l’historien Georges Vigarello[1].
La conceptualisation du bonheur en Chine et en Corée du Nord a initialement été influencé, entre autres, par les idées confucéennes d’harmonie sociale et par la doctrine marxiste. Ainsi, l’idéologie Juche nord-coréenne met en avant le bien-être du peuple, tandis que l’économie de marché socialiste chinoise met en avant de façon récurrente l’aspiration à la prospérité du peuple chinois. Si la Chine a pu atteindre un certain stade de développement économique, et de confort pour une partie de sa population avec l’avènement d’une classe moyenne, le constat est bien différent pour la Corée du Nord.
Contrairement à la Chine et à la Corée du Nord, le droit à la poursuite du bonheur, par chaque citoyen, a été reconnu constitutionnellement en Corée du Sud et au Japon. Il trouve son inspiration dans la déclaration d’indépendance des États-Unis de 1776, héritage de la pensée occidentale. Ce dernier est le résultat des liens étroits des États-Unis avec le Japon à l’issue de la Seconde Guerre mondiale, et avec la Corée du Sud, à l’issue de la guerre de Corée. Malgré sa paternité, ce droit n’a pas coupé ses liens avec l’héritage culturel des pays dans lesquels il a été accueilli. La mise en pratique d’un tel droit n’est pas sans difficultés, comme le témoigne le phénomène de Hell Joseon en Corée du Sud expression d’un mal-être sociétal.
Qu’on l’appelle droit à la poursuite du bonheur, prospérité commune ou encore bien-être des travailleurs, les différentes acceptions de ce qu’on appelle le bonheur (selon les conditions culturelles, politiques, sociales et historiques) témoignent de visions pluralistes de la société. Tantôt instrument du discours politique, utopie sociétale, ou encore outil juridique, une conclusion apparait sur la mise en pratique de ces droits, leur caractère subjectif rend difficile leur réalisation effective. Dans quelle mesure les cadres juridiques et politiques de ces pays traduisent-ils des conceptions antagonistes du droit au bonheur, révélatrices de leurs orientations idéologiques et de leurs fondements constitutionnels distincts ? Quelle est l’effectivité de la protection de ces droits ?
I. Le droit à la poursuite du bonheur en Corée du Sud et au Japon
Au Japon et en Corée du Sud, il y a des références constitutionnelles au concept occidental de poursuite du bonheur. Nonobstant, des nuances significatives caractérisent l’intégration constitutionnelle de ce droit, tandis que des différences plus substantielles se manifestent dans les mécanismes de protection juridictionnelle des prérogatives qui en émanent.
A. Le Japon : Un pays précurseur dans le droit à la poursuite du bonheur en Asie
Au Japon, le droit au bonheur s’est initialement manifesté comme une construction politique sous l’influence états-unienne, avant d’être réapproprié par le corps social et intégré dans la Constitution Meiji de 1889, puis dans celle de 1947.
La Constitution Meiji, ou Constitution de l’Empire du Japon, promulguée en 1889, fut appliquée de 1890 à 1947[2], dans un contexte d’ouverture naissante aux influences internationales. Ainsi, la pensée politique de John Locke, la Déclaration des droits de la Virginie de 1776 et la Déclaration d’indépendance des États-Unis vont inspirer des mouvements d’activistes politiques et la rédaction de cette Constitution[3]. L’article 9 de celle-ci déclare : « L’Empereur donne ou fait donner les ordres nécessaires pour assurer l’exécution des lois, maintenir l’ordre et la paix publique, ou développer le bonheur de ses sujets ».
Les activistes politiques critiquaient alors l’accent mis dans cet article sur la prospérité du pays, plutôt que sur les droits du peuple, ne répondant pas à l’injustice sociale ressentie[4]. Torsten Weber rappelle ainsi la critique de l’activiste Ōi Kentarō : « Le bonheur de la minorité est le [résultat du] malheur de la majorité »[5]. Dans cette Constitution, le concept de poursuite du bonheur, pourtant apprécié des activistes et progressivement intégré au discours politique, a été dévoyé en une recherche de puissance étatique.
À l’issue de la défaite japonaise lors de la Seconde Guerre mondiale, l’archipel est occupé par les États-Unis (1945-1952) qui vont exercer une influence majeure sur son système juridique. Le 3 novembre 1946 est alors promulguée la Constitution du Japon[6], surnommée Constitution de la paix. Pour la première fois est intégré fois dans son article 13 le concept de poursuite du bonheur. Ce dernier énonce que : « Tous les citoyens devront être respectés comme individus. Leur droit à la vie, à la liberté, à la poursuite du bonheur, dans la mesure où il ne fait pas obstacle au bien-être public, demeure le souci suprême du législateur et des autres responsables du gouvernement. ». Le droit à la poursuite du bonheur est ainsi constitutionnalisé.
La Constitution de 1946 dans son essence vise la protection des droits fondamentaux des citoyens[7], ce qui marque un changement profond par rapport à la Constitution Meiji. La première phrase de l’article 13 exprime une pensée individualiste à travers le respect de l’individu, ce qui constitue la prémisse de la garantie des droits fondamentaux de l’Homme et leur développement conformément aux exigences de dignité humaine[8]. La deuxième phrase, quant à elle, peut être interprétée comme affirmant les droits de l’Homme dans un sens général, donc des droits fondamentaux[9]. Ces droits peuvent être rattachés à l’article 97 qui les garantit en énonçant que : « Les droits fondamentaux de la personne humaine, garantis par la présente Constitution […] sont conférés à la présente génération et à celles qui la suivront, avec mission d’en garantir à jamais l’inviolabilité. ».
Toutefois, les droits fondamentaux de la deuxième partie de l’article 13 sont restreints par l’exigence de non-interférence avec le bien-être public, ce qui constitue une particularité japonaise[10]. Cette spécificité reflète l’influence du concept japonais d’harmonie, le wa, héritage du syncrétisme du confucianisme, du bouddhisme et du shintō. Ainsi, l’harmonie de la société est nécessaire pour atteindre le bonheur.
Si lors de l’élaboration de la Constitution le droit à la poursuite du bonheur n’apparaissait que comme une déclaration des principes fondamentaux de la politique nationale, depuis les mutations économiques et sociales des années 1960, ce droit a connu une requalification doctrinale. En effet, il s’est mué en prérogative juridique susceptible de fonder des actions contentieuses, tout en constituant le fondement pour la reconnaissance de droits de l’Homme non-énumérés[11].
Bien que le droit à la poursuite du bonheur ait puisé son inspiration dans le droit états-unien, la préférence doctrinale s’est dirigée vers le droit allemand pour l’interprétation de sa portée normative, avec la théorie des intérêts de la personnalité. Le professeur Nobuyoshi Ashibe le résume comme un droit individuel fondamental qui n’englobe pas toutes les libertés d’action, mais l’ensemble des droits indispensables à l’existence des individus au sens de intérêts de la personnalité[12].
L’architecture juridictionnelle japonaise n’inclut pas de juridiction constitutionnelle spécialisée, cependant il est possible de faire une demande sur la base de la Constitution et celle de l’inconstitutionnalité d’une loi devant la Cour suprême, la plus haute juridiction, ou devant les tribunaux ordinaires : les Hautes cours et les tribunaux de district. Il faut toutefois souligner que seule la Cour suprême a compétence pour invalider une loi inconstitutionnelle selon l’article 81 de la Constitution. Les tribunaux sommaires, compétents pour les litiges mineurs, n’ont pas de compétence en matière constitutionnelle.
Les universitaires japonais se sont interrogés sur les rapports entre le droit à la poursuite du bonheur et les droits non-énumérés. La doctrine et la jurisprudence ont écarté la théorie de la garantie conjointe où les garanties se chevauchent pour retenir la théorie des relations de type loi spéciale / loi générale, et la théorie de la garantie supplémentaire, sans parvenir à faire un choix[13]. Si la doctrine retient de nombreux droits non-énumérés tels que le droit au calme, à l’environnement, à la vie privée, à l’accès aux plages ou autres, la jurisprudence de la Cour suprême n’a retenu explicitement que le droit à l’image comme élément du droit à la vie privée dans l’affaire de la Fédération des étudiants de Kyoto du 24 décembre 1969[14]. Sans leur consentement, des étudiants avaient été photographié lors d’une manifestation[15]. Sur la base de l’article 13, la Cour a reconnu une liberté à la vie privée protégeant ainsi le droit à l’image, tout en posant des restrictions. Ces dernières, sur la base du bien-être public, doivent satisfaire un test de proportionnalité (avec des critères cumulatifs)[16]. L’article 13 ayant été mentionné dans une variété d’autres affaires, il faut souligner que « […] l’interprétation constitutionnelle du droit à la poursuite du bonheur au Japon repose principalement sur les juridictions judiciaires, à savoir la Cour suprême, les Cours d’appel et les tribunaux locaux. »[17].
On pourrait s’interroger sur comment rendre la défense de ce droit à la poursuite du bonheur plus efficace au Japon.
B. La Corée du Sud : Vers une garantie effective du droit à la poursuite du bonheur
L’adoption constitutionnelle du droit à la poursuite du bonheur est plus tardive en Corée qu’au Japon, mais a montré une approche plus large et approfondie.
La Constitution de la Corée du Sud, encore en vigueur, fut adoptée en 1948. La Corée, sous une même Constitution, au gré des révisions constitutionnelles a connu des régimes présidentiels et parlementaires, ainsi que la dictature et la démocratie. La vie politique sud-coréenne fut très mouvementée entre 1948 et 1987. Avec l’assassinat du dictateur Park Chung-Hee, la Corée entre dans la Sixième République et accueille la démocratie. La révision du 29 octobre 1987, qui entre en vigueur le 25 février 1988, marque un tournant avec l’introduction du droit à la poursuite du bonheur.
Le bonheur est mentionné par deux fois dans la Constitution. Tout d’abord à l’avant-dernier alinéa du préambule, le bonheur et la prospérité commune de l’humanité sont mentionnés : « Pour élever la qualité de la vie pour tous les citoyens et contribuer à une paix mondiale durable et à la prospérité commune de l’humanité et, ainsi, assurer la sécurité, la liberté et le bonheur à nous-mêmes et à notre postérité, pour toujours ». Cette notion de prospérité rappelle la Constitution chinoise qui sera abordée dans la deuxième partie de cet article. Le préambule semble être une simple déclaration d’intention et de politique générale.
Néanmoins, l’article 10, qui est le premier article du chapitre II portant sur les droits et devoirs des citoyens mentionne le droit à la poursuite du bonheur de façon similaire à la déclaration d’indépendance des États-Unis et à la Constitution japonaise : « Tout citoyen est assuré de la valeur et de la dignité humaine et a le droit de rechercher le bonheur. Il incombe à l’État de confirmer et de garantir les droits fondamentaux et inviolables de l’individu. ». Contrairement à la Constitution japonaise, il n’y a pas de notion de bien-être public accolée au droit à la poursuite du bonheur, au contraire, ces droits sont présentés comme inviolables. Nonobstant, des limitations aux droits et libertés sont possibles en vertu de l’article 37 pour des raisons de sécurité nationale, de maintien de la loi, d’ordre public, et, de façon similaire au droit japonais, pour le bien-être de tous. On retrouve là une influence des traditions confucéennes[18].
La notion de bien-être est également présente à plusieurs reprises dans la Constitution. Le président de la République lors de son serment doit promettre de favoriser le bien-être du peuple (article 69), tandis que les collectivités territoriales doivent traiter des questions administratives relatives au bien-être des résidents locaux (article 117). Cependant l’article le plus important concernant le bien-être est sans doute le 34 sur la dignité humaine, car il prévoit que l’État promeut le bien-être grâce à son système de sécurité sociale et aux droits des femmes ; mais aussi qu’il met en œuvre des politiques améliorant « le bien-être des personnes âgées et des jeunes ».
Se distinguant du modèle japonais, la Corée a institué en 1988 une Cour constitutionnelle, permettant ainsi la garantie et l’effectivité des normes constitutionnelles. De nombreuses décisions ont ainsi été rendues sur la base de l’article 10 sur le droit à la poursuite du bonheur. L’interprétation de cet article, tout comme au Japon a été influencée par l’Allemagne sur la base de la théorie de la libre expression de la personnalité[19] et dans des modalités assez similaires quant aux rapports entre droits énumérés et non-énumérés[20]. Également, le droit à la poursuite du bonheur apparait comme lié à celui de la dignité humaine et ceux des droits de l’Homme[21].
La décision 89Hun-Ma56 du 27 octobre 1989 concernant l’exercice disciplinaire dans l’armée a « pour la première fois, reconnu le droit à la poursuite du bonheur comme un droit constitutionnel concret ». La Cour constitutionnelle va préciser ce droit dans ses décisions suivantes. Les affaires dans lesquelles le droit à la poursuite du bonheur est invoqué sont très variées, en voici une courte sélection : l’affaire concernant la déclaration de naissance d’un enfant né d’une femme mariée et d’un homme autre que son mari (2021Hun-Ma975 du 3 mars 2023) ; l’affaire concernant les moyens de transport spéciaux pour les personnes handicapées (2019Hun-Ma1234 du 25 mai 2023) ; l’affaire sur le plafonnement de la propriété des terrains à bâtir (94Hun-Ba37 et al. du 29 avril 1999) ; ou encore l’affaire concernant l’obligation pour les détenus non condamnés de porter des uniformes de prison (97Hun-Ma137 et al. du 27 mai 1999).
Jae-Do Jung a analysé les tendances décisionnelles de la Quatrième Cour constitutionnelle (2006-2012) dans les décisions relatives aux droits de la personnalité et au droit à la poursuite du bonheur[22]. Il compare les décisions qui ont une approche conservatrice (judicial restraint) et celles qui ont une approche progressiste (judicial activism). Même si quantitativement, 77% des décisions étaient conservatrices, la tendance générale était à l’accroissement du progressisme, puisque ce type de décision a quasiment triplé en 6 ans passant de 11,11% à 29,63%[23]. Il constate que les décisions progressistes sont plus nombreuses concernant le droit à la poursuite du bonheur que les autres droits[24].
La décision 2017Hun-Ba127 du 11 avril 2019 est dans cette tendance progressiste. Elle a eu un impact majeur sur le droit à l’avortement en Corée. En effet, la pénalisation de l’avortement a été déclaré inconstitutionnelle. Namseok Yoo, président de la Cour constitutionnelle, explique que « La Cour a estimé que les femmes ont le droit de ne pas être contraintes de porter et de donner naissance à des enfants pour leur propre bonheur. », avant d’ajouter que la Cour « a considéré que criminaliser complètement et uniformément l’avortement […] porte atteinte au droit à l’autodétermination de la femme »[25]. Ainsi, la Cour avait fixé un délai afin d’amender la loi, ce qui fut, non sans débat, chose faite le 31 décembre 2020, l’amendement entrant en vigueur dès le lendemain.
Le droit à la poursuite du bonheur en Corée, en plus d’être un progrès, est un instrument juridique au service d’objectifs sociétaux, offrant aux citoyens la possibilité d’exprimer librement leur personnalité. Pourtant, ce droit se heurte à une réalité paradoxale avec le phénomène de Hell Joseon qui représente une critique d’une société coréenne inégalitaire et perçue sans espoir. Le Hell Joseon semble ainsi contredire l’idéal de prospérité commune porté par la Constitution. Les chiffres de l’OCDE, notamment concernant le bien-être subjectif des coréens, sont préoccupants, tout comme le taux de suicide. Ainsi, le décalage entre le droit et la réalité sociale interroge.
II. La recherche de la prospérité commune et du bien-être à travers le droit et la politique en Chine et en Corée du Nord
Bien que la Chine et la Corée du Nord aient des fondements idéologiques commun avec le socialisme et le communisme, et que la terminologie conceptuelle employée dans leurs constitutions soit analogue, elles ont choisi des voies très différentes. Ainsi la concrétisation normative et la perception sociétale du bonheur et de la prospérité commune divergent significativement dans ces deux pays.
A. La Chine : Les expressions constitutionnelles et politiques de la conception communiste de la prospérité commune aux caractéristiques chinoises
Comme exprimé par Félicien Lemaire : « Le bonheur est une notion qui a traversée toutes les théories politiques, des antiques au marxisme et au communisme. »[26].
Dans le confucianisme, on retrouve les idées de bonheur et de prospérité commune. Le Livre des rites met en avant l’idée d’harmonie à travers notamment la vie heureuse et paisible du peuple et des groupes vulnérables, tandis que Les entretiens de Confucius, dans cette continuité mettent en avant l’harmonie sociale, la bienveillance dite le rén et la gouvernance vertueuse qui doit « viser à enrichir le peuple »[27]. Mencius, disciple de Confucius, continuera son travail en développant ses idées sur la gouvernance vertueuse[28]. Le confucianisme a une vision du bonheur qui est terrestre à travers l’éducation et les relations sociales, mais aussi collective à travers les valeurs d’harmonie sociale, de respect des rites et de cultivation de la vertu[29].
Si le confucianisme est la tradition ayant le plus d’impact aujourd’hui sur la notion de prospérité commune et de bonheur, il ne faut pas oublier les autres traditions philosophiques. Le légisme avait comme le confucianisme une vision collective (par l’ordre et les lois) et terrestre (par la prospérité) du bonheur[30], contrairement au taoïsme et au bouddhisme qui en avaient des visions individuelles et célestes.
Cette vision de la prospérité a ensuite évolué avec Sun Yat-Sen qui a développé la théorie de l’égalisation des droits fonciers, dont l’idée centrale était le partage des droits fonciers avec le peuple, influencé par la théorie de l’impôt unique de Henry George[31]. En 1905, Sun Yat-Sen évoque ce qu’il désigne comme les principes du peuple : le nationalisme, la démocratie et le bien-être du peuple[32]. Sur certains points, ces idées s’alignent avec le discours socialiste.
Avec l’arrivée du Parti communiste chinois (PCC) au pouvoir, la Chine se dote d’une première Constitution en 1954 dans laquelle au préambule est énoncé l’objectif d’« édifier une société socialiste prospère et heureuse ». Cela constitue la première référence juridique à la prospérité et au bonheur. Cependant, avec la deuxième Constitution de 1975, élaborée après l’échec de la Révolution culturelle, on est à l’apogée du maoïsme et la mention de la société socialiste prospère et heureuse disparait. Il faut attendre la troisième Constitution de 1978, qui fait suite à la mort de Mao Zedong en 1976, pour retrouver une référence à la prospérité dans le préambule à l’alinéa 2 : « La Chine est devenue un État socialiste connaissant un début de prospérité ». À l’article 48 sur le droit au travail, est mentionné le rôle de l’État d’« accroître le bien-être collectif ». La Constitution de 1982, encore en vigueur aujourd’hui, marque une rupture avec le maoïsme et précise dans le préambule, à l’alinéa 11, que : « L’État déploiera tous ses efforts pour contribuer à la prospérité commune de nos diverses ethnies[33] ». Le bien-être collectif devient le bien-être des travailleurs dans l’article 48. Dans la dernière révision constitutionnelle, à ce jour, de la Constitution de 1982 a été ajouté le respect et la garantie des droits de l’Homme par l’État à l’article 33, et la notion de relations harmonieuses à l’alinéa 11 du préambule, concept largement mis en avant par Hu Jintao pendant son mandat présidentiel, et qui continue à être mis en avant.
Bien que la terminologie de prospérité commune ne soit pas apparue immédiatement, celle-ci ayant nécessité un affinage du temps, dans la doctrine politique chinoise, l’essence même de ce terme n’est pas nouvelle. En effet, on en retrouve la volonté dans les discours de Mao Zedong, et des explications dans les discours de ces successeurs[34]. Dans les discours politiques, cette notion a donc connu des évolutions dans sa compréhension. Deng Xiaoping est le premier à séparer les deux dimensions de l’expression de prospérité commune de façon explicite[35]. Si Mao Zedong a mis l’accent sur le commun, Deng Xiaopeng a lui mis l’accent sur la prospérité, suivi par Jiang Zemin et Hu Jintao[36]. La doctrine chinoise considère que la théorie de la prospérité commune issue du socialisme n’a pu être réellement mise en place pour l’atteindre de façon effective qu’avec les réformes et la politique d’ouverture. Avec l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012, cette distinction entre la prospérité et le commun est nuancée, ce dernier estimant que les deux termes de l’expression sont d’égale importance[37]. Selon lui, cet équilibre entre le commun et la prospérité passe par quatre éléments : le partage universel, caractérisé par l’équité sociale ; le partage progressif, caractérisé par la lutte constante ; la co-construction de l’État de droit socialiste ; le partage global dépendant de l’environnement institutionnel pour le développement humain[38].
Le bonheur et la prospérité commune sont deux notions étroitement liées dans le discours communiste chinois, notamment à travers le concept formulé par Xi Jinping de rêve chinois, pendant de l’American Dream. Le bonheur est l’un des objectifs du rêve chinois, tandis que l’amélioration du bien-être du peuple à travers la réalisation de la prospérité commune est un des axes autour duquel il faut agir pour l’atteindre. Si Xi Jinping annonce viser pour 2035 la réalisation de la prospérité commune, en 2049, pour le centenaire de la République Populaire de Chine, il vise la réalisation du rêve chinois. La notion de bonheur dans ce rêve chinois est une vision socialiste qui a évolué à partir d’une conception marxiste afin d’y inclure des caractéristiques chinoises si l’on se base sur le discours officiel. Ainsi, l’individu réel, auquel il s’adressait, est devenu le sujet populaire, le bonheur réel a laissé place à la belle vie (faisant référence aux progrès globaux de l’Homme et aux progrès sociaux), le bonheur par le travail est devenu le bonheur par la lutte, et le bonheur du peuple est devenu le bonheur de l’humanité (le bonheur ne devant pas viser que les chinois)[39].
En se targuant de vouloir dépasser le simple bonheur du peuple chinois pour le bonheur de l’humanité, Xi Jinping a développé la notion de Communauté de destin commun[40] qu’il a promue comme élément de sa gouvernance globale, que cela soit aux Nations Unies, ou encore dans le cadre des projets des routes de la soie. À cet égard, il affirme que « Sur la voie de la poursuite du bonheur humain, aucun pays, aucune nation ne doit être laissé pour compte. »[41]. Plus que de promouvoir le bonheur humain, la promotion de cette notion est une critique de l’universalisme occidental qui est présenté dans le discours politique chinois comme un « outil de préservation des intérêts de la classe bourgeoise », alors que leur concept au contraire en promouvant les « valeurs communes de l’humanité », que sont la paix, le développement, l’équité, la justice, la démocratie et la liberté, reflèterait « l’idéal de recherche du bien-être de toute l’humanité et de réalisation des intérêts communs »[42]. Cette notion a par ailleurs été ajoutée à l’alinéa 12 du préambule de la Constitution à l’occasion de la révision constitutionnelle de 2018. Malgré son intégration dans la Constitution, la dimension instrumentale de ce concept est révélée par la dichotomie entre la rhétorique aux aspirations universalistes chinoises, puisant ses sources de l’idéologie communiste, et les actions pragmatiques observables sur la scène internationale. Ainsi, il est plus un outil de soft power et vecteur d’influence diplomatique, qu’un programme concret intégralement applicable.
Les différents concepts et projets chinois sont pour la plupart interconnectés et forment un réseau de concepts. Leur évocation est donc nécessaire afin d’approfondir et comprendre le développement de la prospérité commune.
La doctrine est unanime sur le fait que la prospérité commune est d’abord centrée sur le peuple, estimant que cela différencie l’État de droit aux caractéristiques chinoises des modèles occidentaux[43]. Ce centrage sur le peuple passe par des droits associés à celui de la prospérité commune, tels que l’amélioration de la vie du peuple à l’article 14 de la Constitution, les droits de l’Homme à l’article 33, la dignité humaine à l’article 38 ou encore le soin apporté envers les groupes sociaux vulnérables grâce à l’existence d’un système de sécurité sociale[44]. La justice distributive est également un des éléments clés du principe de prospérité commune grâce à sa vision égalitaire, qui correspondrait plus à ce qu’on appelle l’équité, permettant un équilibre social[45]. Yu Ping souligne que « la justice distributive inclut, en plus de la répartition juste des richesses matérielles, un partage équitable de toutes les ressources sociales. »[46].
À cela s’ajoute le bien-être des travailleurs protégé par la Constitution à l’article 48 qui exprime la théorie communiste du bonheur par le travail. Cela correspond au fait d’assurer l’accès à l’emploi et de garantir le bonheur au travail du point de vue social, le tout en respectant les principes de rétribution équitable, de dignité du travail et de libération par le travail[47].
La prospérité commune est un droit non-opposable, car il s’agit d’un principe constitutionnel et d’une déclaration de politique générale. Les justiciables ne peuvent pas en faire usage devant les tribunaux. Pour ces raisons, la seule tentative d’invoquer ce principe devant la Cour populaire suprême a échoué en 2001 dans l’affaire Qiu Jiandong, n°(2001) Min Ti Zi 76. L’architecture juridictionnelles chinoise est hiérarchisée et centralisée sous le contrôle du PCC. Elle est composée de quatre niveaux avec à sa tête la Cour populaire suprême, puis les Cours populaires supérieures, les Cours populaires intermédiaires et les tribunaux de base, sachant qu’il existe également des Cours spécialisées dans des domaines spécifiques du droit, tels que le droit maritime ou la propriété intellectuelle. Nonobstant, il n’existe pas de juridiction constitutionnelle spécialisée. Donc, il n’y a de contrôle de constitutionnalité ni concentré, ni diffus. Seul le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire peut contrôler la constitutionnalité des lois[48]. Xuanzi Cui est très critique à cet égard, estimant que cela nuit à la mise en œuvre de la Constitution et son efficacité, il suggère la création d’une véritable loi de procédure administrative (celles en vigueur lui semblant insatisfaisantes), afin de garantir le droit à la prospérité commune[49]. Wensheng Yang et Yingshou Hou vont plus loin en présentant « l’établissement d’un système de contrôle de constitutionnalité [comme] une exigence inévitable »[50]. Ils souhaitent la création d’un organe spécialisé, indépendant, qui puisse effectuer un contrôle de constitutionnalités des lois a priori et a posteriori, s’assurant également de la bonne exécution du contenu de la Constitution. Ils suggèrent en plus de cela un système complémentaire de surveillance constitutionnelle[51], ce qui peut faire penser à la théorie des cinq pouvoirs de Sun Yat-Sen qui ajoute aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les pouvoirs d’examen et de contrôle.
Il y a d’autres suggestions de la doctrine. Pan Jiang, par exemple, propose pour renforcer l’effectivité de la prospérité commune, une loi de promotion de la prospérité commune qui en conformité avec la Constitution s’articulerait avec les lois sur l’environnement, l’éducation, la fiscalité…[52]. Xuanzi Cui suggère de s’inspirer des constitutions japonaise et sud-coréenne en ajoutant dans celle chinoise le droit à la poursuite du bonheur comme réaffirmation et renforcement des droits de la personnalité y étant déjà présent[53]. Le fait que le Japon et la Corée du Sud aient su adapter à leurs spécificités locales ce droit permet de rassurer la doctrine chinoise face à une influence juridique occidentale qu’elle exècre[54]. Également, cela pourrait permettre d’adapter le droit à l’évolution de la perception du bonheur en Chine qui montre une montée de l’importance des facteurs individualistes[55] face à ceux collectivistes, bien que ces derniers restent dominants dans le discours politique avec notamment l’idée d’harmonie sociale et qu’un certain attachement symbolique des chinois demeure[56].
Ainsi, la préférence des termes de prospérité commune et de bien-être des travailleurs, plutôt que l’usage de la poursuite du droit au bonheur reflète l’idéologie chinoise actuelle.
B. La Corée du Nord : La vision du bien-être collectif à travers la doctrine Juche
La Corée du Nord est un État se présentant comme socialiste-nationaliste et suivant l’idéologie Juche, bien qu’initialement fondé comme un État communiste. Progressivement, les références au communisme ont disparu de la Constitution nord-coréenne, jusqu’à disparaitre totalement avec la réforme de 2009 de la Constitution du 5 septembre 1998. Le communisme a disparu en même temps que la famille Kim a renforcé ses pouvoirs et approfondi la doctrine Juche. Cela dénote d’un changement d’orientation politique depuis les débuts de la création du pays. Il faut noter que 2 ans avant la séparation officielle, en 1948, alors que le pays a été déjà divisé, est élaborée une Constitution promulguant la République Populaire Démocratique de Corée, couramment désignée par le terme de Corée du Nord. Ensuite, Kim Il-Sung, dirigeant nord-coréen, souhaitant alors renforcer ses pouvoirs élabore une nouvelle Constitution en 1972 et introduit alors la doctrine Juche. Dans cette continuité, Kim Jong-Il, son fils, élabore la Constitution de 1992, puis celle de 1998 où dans le Préambule il se déclare président éternel.
Bien que la première Constitution ait établi un corpus de droits fondamentaux et d’obligations civiques qui, comme l’Histoire le démontre, n’ont pas eu de matérialisation effective, il convient de noter l’absence de référence explicite aux notions de bien-être, de bonheur et de prospérité commune.
La notion garantie matérielle de la prospérité est introduite avec l’article 24 de la Constitution de 1972. Celle-ci s’est transformée avec la Constitution de 1992 en prospérité de la patrie, l’article 26 expliquant que l’économie nationale indépendante du pays est « une base solide pour la vie socialiste heureuse du peuple et la prospérité de la patrie. ». Le deuxième alinéa de cet article fait également référence à la volonté que l’économie soit de type Juche. Enfin avec la dernière Constitution, cette notion est inscrite dans le préambule où on précise le caractère socialiste de la prospérité de la patrie, toujours en maintenant des références à la doctrine Juche.
Concernant le bonheur, la Constitution de 1972 fait référence au bonheur collectif dans son article 3, en utilisant le terme de bonheur de peuple. Ce droit a été maintenu, mais il est désormais à l’article 2 dans les versions de 1992 et de 2002 de la Constitution.
Enfin, concernant le bien-être des travailleurs, qui peut rappeler la Constitution chinoise, et qui demeure un héritage du communiste, on en trouve une première référence dans l’article 23 de la Constitution de 1972 dans lequel il est établi qu’en Corée du Nord, « les richesses matérielles de la société qui sont en croissance continue sont entièrement destinées à l’amélioration du bien-être des travailleurs ». Cette disposition a été maintenue dans les articles 25 des Constitutions de 1992 et 1998. Le bien-être des travailleurs est conditionné par leur loyauté au régime[57], la vision collectiviste limite les droits individuels.
Bien que non-explicitement mentionné dans la Constitution de 1972, on y retrouve au début les éléments de la doctrine Juche. Dans la dernière Constitution, la doctrine Juche est largement citée[58]. Comme expliqué par Eung-Ki Jeong, le système d’asservissement idéocratique est dominé par l’idéologie Juche[59]. Jeong-Won Park définit ainsi cette doctrine : « La doctrine Juche a pour principes fondamentaux l’autonomie dans la pensée, l’indépendance politique, l’autosuffisance économique et l’autodéfense militaire. »[60]. Nam-Hui Cha, quant à lui la présente comme une constante du régime nord-coréen et son fondement idéologique, alors que les caractéristiques nationalistes du régime ne sont que des variables d’ajustement aux changements internes et externes[61]. D’une manière générale dans la doctrine trois éléments ressortent pour la caractériser : l’autosuffisance, l’indépendance et l’autodéfense[62].
Si le régime nord-coréen cherche à se maintenir en plaçant la priorité sur le maintien de son idéologie, on constate une effectivité inexistante ou quasi-inexistante des droits des citoyens et un contexte défavorable aux trois principes cités pourtant dans sa constitution : le bonheur du peuple, la prospérité de la patrie et le bien-être des travailleurs.
L’influence confucéenne est présente dans les quatre pays étudiés avec l’idée d’harmonie sociale et de bien-être ou bonheur collectif. Toutefois, le Japon et la Corée du Sud ont ajouté l’idée de bonheur individuel et mis en place des mécanismes de protection des normes constitutionnelles.
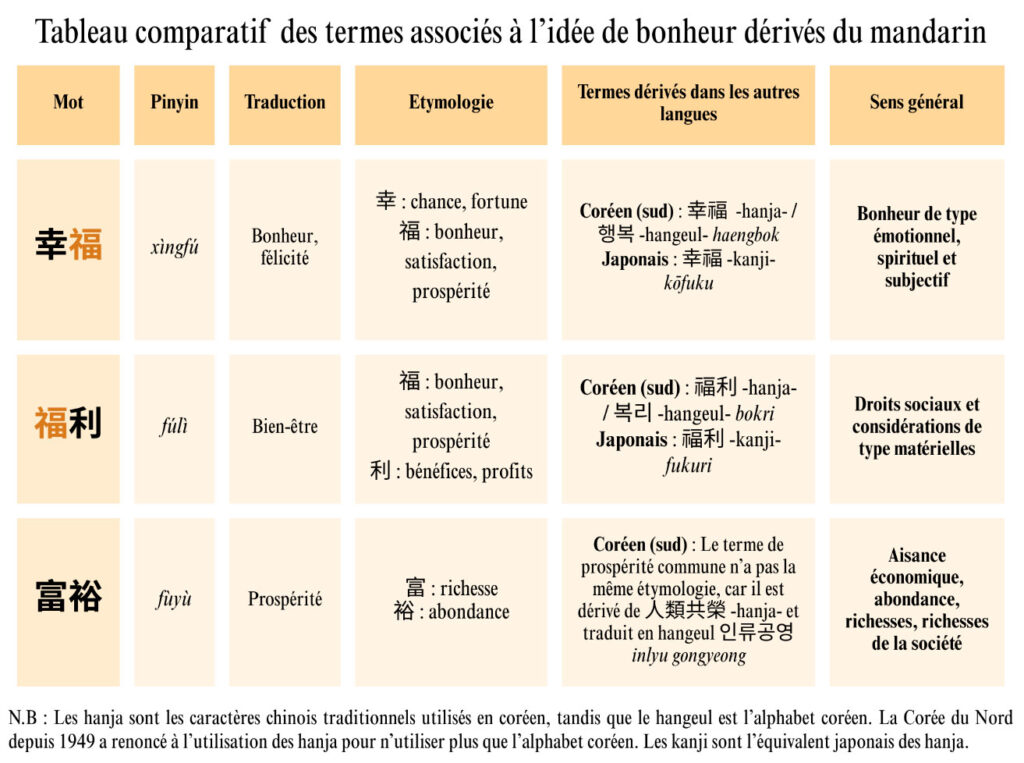
[1] Georges Vigarello, Le sentiment de soi : Histoire de la perception du corps XVIe – XXe siècle, Paris, Éditions Points, coll. « Points. Histoire », 2016, p.318.
[1] Georges Vigarello, Le sentiment de soi : Histoire de la perception du corps XVIe – XXe siècle, Paris, Éditions Points, coll. « Points. Histoire », 2016, p.318.
[2] Encyclopédie Universalis.
[2] Encyclopédie Universalis.
[3] Torsten Weber, « The pursuit of happiness in modern Japan », The Newsletter, « The Study », n°67, 2014, p.8.
[3] Torsten Weber, « The pursuit of happiness in modern Japan », The Newsletter, « The Study », n°67, 2014, p.8.
[4] Ibid.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Elle entre en vigueur le 3 mai 1947.
[6] F. Choay, Urbanisme, utopies et réalités. Une anthologie, Seuil, 1965.
[7] 秦前红 [Qianhong Qin] et 韩永红 [Yonghong Han], « 宪法 “基本权利核心概念” 研究———基于中日比较的视角 [Étude sur le "concept clé des droits fondamentaux" dans la Constitution — Une perspective comparative entre la...
[7] 秦前红 [Qianhong Qin] et 韩永红 [Yonghong Han], « 宪法 “基本权利核心概念” 研究———基于中日比较的视角 [Étude sur le "concept clé des droits fondamentaux" dans la Constitution — Une perspective comparative entre la Chine et le Japon] », 广东社会科学 [Guangdong Social Sciences], n°1, 2008, p. 190-191.
[8] 张薇薇 [Weiwei Zhang], « 论作为日本宪法概括权利的“幸福追求权” ...
[8] 张薇薇 [Weiwei Zhang], « 论作为日本宪法概括权利的“幸福追求权” [Sur le droit à la poursuite du bonheur en tant que droit constitutionnel non énuméré dans la Constitution du Japon] », 河北法学 [Hebei Law Science], vol. 28, n°10, 2010, p. 173-174.
[9] Ibid
[9] Ibid
[10] 崔玄子 [Xuanzi Cui], 韩国宪法幸福追求权 对我国的启示 [Le droit à la poursuite du bonheur dans la Constitution coréenne : Implications pour notre pays], Mémoire, Yanbian University, 2020, p.46.
[10] Le contexte de la première révolution industrielle est important pour comprendre leur démonstration. R. Owen, par exemple, pensait que « les grandes inventions modernes, les améliorations progressives et le progrès continu des sciences et des arts techniques et mécaniques (qui, sous le régime de l’individualisme, ont augmenté la misère et l’immoralité des producteurs industriels), sont destinés, après avoir causé des souffrances, à détruire la pauvreté, l’immoralité et la misère. Les machines et les sciences sont appelés à faire tous les ouvrages pénibles et malsains », in The book of the New Moral World, Paris, 1846.
[11] Ibid, p.174.
[11] Ibid, p.174.
[12] Ibid, p. 175.
[12] Ibid, p. 175.
[13] Ibid.
[13] Ibid. p. 176.
[14] Ibid. p. 176.
[14] Ibid. p. 176.
[15] Suga Hiroshi, Analyse de jurisprudence : Cour suprême du Japon, Grande Chambre, 24 décembre 1969 (Shōwa 44), Affaire n°9-3, Université de Kyoto Sangyo, 1969...
[15] Suga Hiroshi, Analyse de jurisprudence : Cour suprême du Japon, Grande Chambre, 24 décembre 1969 (Shōwa 44), Affaire n°9-3, Université de Kyoto Sangyo, 1969 https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/9-3.html ; et Norio, 京都府学連事件をわかりやすく解説!肖像権と公共の福祉 [Une explication facile à comprendre de l'incident de l'Union des étudiants de la préfecture de Kyoto ! Les droits de portrait et l'intérêt public], 京都府学連事件 [Connaissances de base de la Constitution japonaise], 2023, https://kenpou-jp.norio-de.com/kyotofugakuren-jiken/
[16] Ibid.
[16] Ibid.
[17] 张薇薇 [Weiwei Zhang], op. cit., p. 176.
[17] 张薇薇 [Weiwei Zhang], op. cit., p. 176.
[18] 崔玄子 [Xuanzi Cui], art. cit.
[18] 崔玄子 [Xuanzi Cui], art. cit.
[19] Ibid.
[19] Ibid.
[20] 장영수 [Young-Soo Jang], « 헌법상 행복추구권의 의미와 실현구조 ...
[20] 장영수 [Young-Soo Jang], « 헌법상 행복추구권의 의미와 실현구조 [La signification du droit à la poursuite du bonheur dans la Constitution et sa structure de réalisation] », 고려법학 [Revue de droit de l’Université de Corée], n°85, 2017, p. 81-108.
[21] Ibid.
[21] Ibid.
[22] 정재도 [Jae-Do Jung], « 제4기 헌법재판소의 인격권과 행복추구권에 관한 판결성향 분석 [Analyse des tendances décisionnelles concernant les droits à la personnalité et à la poursuite du bonheur dans les jugements de la 4ᵉ Cour constitutionnelle]...
[22] 정재도 [Jae-Do Jung], « 제4기 헌법재판소의 인격권과 행복추구권에 관한 판결성향 분석 [Analyse des tendances décisionnelles concernant les droits à la personnalité et à la poursuite du bonheur dans les jugements de la 4ᵉ Cour constitutionnelle] », 외법논집 [Journal of Comparative Law], vol. 45, n°2, 2021, p. 31-65
[23] Ibid.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Constitutional Court of Korea 2023 Annual Report, 2024
[25] Constitutional Court of Korea 2023 Annual Report, 2024
[26] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », in Aux confins du droit : Mélanges-Hommage amical à Xavier Martin, Prénom Christophe Blanchard et Flore Gasnier (dir.), Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso, « Droit & Sciences sociales », 2015, p. 271-284.
[26] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », in Aux confins du droit : Mélanges-Hommage amical à Xavier Martin, Prénom Christophe Blanchard et Flore Gasnier (dir.), Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso, « Droit & Sciences sociales », 2015, p. 271-284.
[27] 喻平 [Ping Yu] , « 共同富裕的权利向度、法治意蕴与法治保障 [La dimension des droits, les implications de l’état de droit et la...
[27] 喻平 [Ping Yu] , « 共同富裕的权利向度、法治意蕴与法治保障 [La dimension des droits, les implications de l’état de droit et la garantie de l’état de droit pour la prospérité partagée] », 云梦学刊 [Journal of Yunmeng], vol. 45, n°1, 2024, p. 109-116.
[28] Ibid.
[28] Ibid.
[29] 石伟 [Wei Shi] , « “幸福”如何变为一种权利 ?———透过《幸福的历史》的分析...
[29] 石伟 [Wei Shi] , « “幸福”如何变为一种权利 ?———透过《幸福的历史》的分析 [Comment le "bonheur" devient-il un droit ? — Une analyse à travers L’Histoire du bonheur] », 求是学刊 [Seeking Truth], vol. 39, n°5, 2012, p. 90-94.
[30] Ibid.
[30] Ibid.
[31] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[31] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[32] Ibid.
[32] Ibid.
[33] En Chine, l’ethnie Han est majoritaire, et il y a 55 autres minorités ethniques.
[33] En Chine, l’ethnie Han est majoritaire, et il y a 55 autres minorités ethniques.
[34] Ibid.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[35] Ibid.
[36] 蒋盼 [Pan Jiang], « 共同富裕的宪法学阐释 [Élaboration constitutionnelle sur la prospérité partagée] », 厦门大学法律评论 [Revue juridique de l’université de Xiamen], vol. 37, n°2, 2023, p. 51-71.
[36] 蒋盼 [Pan Jiang], « 共同富裕的宪法学阐释 [Élaboration constitutionnelle sur la prospérité partagée] », 厦门大学法律评论 [Revue juridique de l’université de Xiamen], vol. 37, n°2, 2023, p. 51-71.
[37] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[37] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[38] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[38] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[39] 冯刚 [Gang Feng] et 胡忠浩 [Zhonghao Hu], « 新时代中国共产党人民幸福观的理论论析 [Analyse théorique de la conception du...
[39] 冯刚 [Gang Feng] et 胡忠浩 [Zhonghao Hu], « 新时代中国共产党人民幸福观的理论论析 [Analyse théorique de la conception du bonheur du peuple par le Parti communiste chinois dans la nouvelle ère] », 思想战线 [Thinking], vol. 51, n°1, 2025, p. 15-23.
[40] Jinping Xi, La gouvernance de la Chine, Mille Fleurs, 2015.
[40] Jinping Xi, La gouvernance de la Chine, Mille Fleurs, 2015.
[41] 冯刚 [Gang Feng] et 胡忠浩 [Zhonghao Hu], art. cit.
[41] 冯刚 [Gang Feng] et 胡忠浩 [Zhonghao Hu], art. cit.
[42] Ibid.
[42] Ibid.
[43] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[43] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[44] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[44] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[45] Ibid. et 喻平 [Ping Yu] , art. cit
[45] Ibid. et 喻平 [Ping Yu] , art. cit
[46] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[46] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[47] 陈识远 [Shiyuan Chen], « 劳动幸福权与劳动权利的关系探析 [Analyse de la relation entre le droit au bonheur du travail et les droits du travail] », 劳动哲学研究 [Études de la philosophie du travail], 2024, p. 82-91.
[47] 陈识远 [Shiyuan Chen], « 劳动幸福权与劳动权利的关系探析 [Analyse de la relation entre le droit au bonheur du travail et les droits du travail] », 劳动哲学研究 [Études de la philosophie du travail], 2024, p. 82-91.
[48] 崔玄子 [Xuanzi Cui], op. cit.
[48] 崔玄子 [Xuanzi Cui], op. cit.
[49] Ibid.
[49] Ibid.
[50] 杨文圣 [Wensheng Yang] et 侯应寿 [Yingshou Hou], « 论共同富裕的法治保障 [Sur la garantie juridique de la prospérité partagée] », 天津师范大学学报(社会科学版) ...
[50] 杨文圣 [Wensheng Yang] et 侯应寿 [Yingshou Hou], « 论共同富裕的法治保障 [Sur la garantie juridique de la prospérité partagée] », 天津师范大学学报(社会科学版) [Journal of Tianjin Normal University (Social Sciences)], n°4, Sum n°295, 2024, p. 125-132.
[51] Ibid.
[51] Ibid.
[52] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[52] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[53] 崔玄子 [Xuanzi Cui], op. cit.
[53] 崔玄子 [Xuanzi Cui], op. cit.
[54] Ibid.
[54] Ibid.
[55] 孙春晨 [Chunchen Sun], « 改革开放以来中国人幸福观分析 [Analyse de la vision du bonheur des Chinois depuis la réforme et ...
[53] 崔玄子 [Xuanzi Cui], op. cit.
[56] Liza G. Steele, et Scott M. Lynch, « The Pursuit of Happiness in China: Individualism, Collectivism, and Subjective Well-Being during China’s Economic and Social Transformation », Social indicators research, n°2, 2013, p. 114-126.
[56] Liza G. Steele, et Scott M. Lynch, « The Pursuit of Happiness in China: Individualism, Collectivism, and Subjective Well-Being during China’s Economic and Social Transformation », Social indicators research, n°2, 2013, p. 114-126.
[57] 박정원 [Jeong-Weon Park], « 북한의 ‘사회주의 법치국가 건설론’과법제 정비 동향 [La théorie de la construction d'un 'État de droit socialiste' en Corée du Nord et les...
[57] 박정원 [Jeong-Weon Park], « 북한의 ‘사회주의 법치국가 건설론’과법제 정비 동향 [La théorie de la construction d'un 'État de droit socialiste' en Corée du Nord et les tendances de l'amélioration du système juridique] », 동북아법연구 [Études juridiques sur l'Asie du Nord-Est], vol. 5, n°1, 2011, p. 1-29
[58] J’ai noté qu’elle était citée 11 fois.
[58] J’ai noté qu’elle était citée 11 fois.
[59] 정응기 [Eung-Ki Jeong], « 북한 사회주의헌법의 기본원리-주체사상 [Le principe fondamental de la Constitution socialiste de...
[59] 정응기 [Eung-Ki Jeong], « 북한 사회주의헌법의 기본원리-주체사상 [Le principe fondamental de la Constitution socialiste de la Corée du Nord – L’idéologie du Juche] », 법학연구 [Études juridiques] , vol. 51, n°4, 2010, p. 219-243.
[60] 박정원 [Jeong-Weon Park], art. cit.
[60] 박정원 [Jeong-Weon Park], art. cit.
[61] 차남희 [Nam-Hui Cha], ...
[61] 차남희 [Nam-Hui Cha], « 주체사상과 민족주의- 북한사회 통치이념의 항상성과 변용성 [L’idéologie du Juche et le nationalisme – Permanence et variabilité des principes de gouvernance de la société nord-coréenne] », 담론201 [Discours 201], vol. 15, n°4, 2012, p. 109-140.
[62] 이효원 [Hyo-Weon Lee], « 북한의 입법조직과 작용에 관한 법체계 [Le système juridique nord-coréen sur les organisations législatives et les législations]», 통일과 법률 [Unité et droit], vol. 46, n°46, 2021, p. 3-35.
[62] 이효원 [Hyo-Weon Lee], « 북한의 입법조직과 작용에 관한 법체계 [Le système juridique nord-coréen sur les organisations législatives et les législations]», 통일과 법률 [Unité et droit], vol. 46, n°46, 2021, p. 3-35.
[1] Georges Vigarello, Le sentiment de soi : Histoire de la perception du corps XVIe – XXe siècle, Paris, Éditions Points, coll. « Points. Histoire », 2016, p.318.
[2] Encyclopédie Universalis.
[3] Torsten Weber, « The pursuit of happiness in modern Japan », The Newsletter, « The Study », n°67, 2014, p.8.
[4] Ibid.
[5] Ibid.
[6] Elle entre en vigueur le 3 mai 1947.
[7] 秦前红 [Qianhong Qin] et 韩永红 [Yonghong Han], « 宪法 “基本权利核心概念” 研究———基于中日比较的视角 [Étude sur le « concept clé des droits fondamentaux » dans la Constitution — Une perspective comparative entre la Chine et le Japon] », 广东社会科学 [Guangdong Social Sciences], n°1, 2008, p. 190-191.
[8] 张薇薇 [Weiwei Zhang], « 论作为日本宪法概括权利的“幸福追求权” [Sur le droit à la poursuite du bonheur en tant que droit constitutionnel non énuméré dans la Constitution du Japon] », 河北法学 [Hebei Law Science], vol. 28, n°10, 2010, p. 173-174.
[9] Ibid.
[10] 崔玄子 [Xuanzi Cui], 韩国宪法幸福追求权 对我国的启示 [Le droit à la poursuite du bonheur dans la Constitution coréenne : Implications pour notre pays], Mémoire, Yanbian University, 2020, p.46.
[11] Ibid, p.174.
[12] Ibid, p. 175.
[13] Ibid.
[14] Ibid. p. 176.
[15] Suga Hiroshi, Analyse de jurisprudence : Cour suprême du Japon, Grande Chambre, 24 décembre 1969 (Shōwa 44), Affaire n°9-3, Université de Kyoto Sangyo, 1969 https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/9-3.html ; et Norio, 京都府学連事件をわかりやすく解説!肖像権と公共の福祉 [Une explication facile à comprendre de l’incident de l’Union des étudiants de la préfecture de Kyoto ! Les droits de portrait et l’intérêt public], 京都府学連事件 [Connaissances de base de la Constitution japonaise], 2023, https://kenpou-jp.norio-de.com/kyotofugakuren-jiken/
[16] Ibid.
[17] 张薇薇 [Weiwei Zhang], op. cit., p. 176.
[18] 崔玄子 [Xuanzi Cui], art. cit.
[19] Ibid.
[20] 장영수 [Young-Soo Jang], « 헌법상 행복추구권의 의미와 실현구조 [La signification du droit à la poursuite du bonheur dans la Constitution et sa structure de réalisation] », 고려법학 [Revue de droit de l’Université de Corée], n°85, 2017, p. 81-108.
[21] Ibid.
[22] 정재도 [Jae-Do Jung], « 제4기 헌법재판소의 인격권과 행복추구권에 관한 판결성향 분석 [Analyse des tendances décisionnelles concernant les droits à la personnalité et à la poursuite du bonheur dans les jugements de la 4ᵉ Cour constitutionnelle] », 외법논집 [Journal of Comparative Law], vol. 45, n°2, 2021, p. 31-65
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Constitutional Court of Korea 2023 Annual Report, 2024
[26] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », in Aux confins du droit : Mélanges-Hommage amical à Xavier Martin, Prénom Christophe Blanchard et Flore Gasnier (dir.), Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ-Lextenso, « Droit & Sciences sociales », 2015, p. 271-284.
[27] 喻平 [Ping Yu] , « 共同富裕的权利向度、法治意蕴与法治保障 [La dimension des droits, les implications de l’état de droit et la garantie de l’état de droit pour la prospérité partagée] », 云梦学刊 [Journal of Yunmeng], vol. 45, n°1, 2024, p. 109-116.
[28] Ibid.
[29] 石伟 [Wei Shi] , « “幸福”如何变为一种权利 ?———透过《幸福的历史》的分析 [Comment le « bonheur » devient-il un droit ? — Une analyse à travers L’Histoire du bonheur] », 求是学刊 [Seeking Truth], vol. 39, n°5, 2012, p. 90-94.
[30] Ibid.
[31] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[32] Ibid.
[33] En Chine, l’ethnie Han est majoritaire, et il y a 55 autres minorités ethniques.
[34] Ibid.
[35] Ibid.
[36] 蒋盼 [Pan Jiang], « 共同富裕的宪法学阐释 [Élaboration constitutionnelle sur la prospérité partagée] », 厦门大学法律评论 [Revue juridique de l’université de Xiamen], vol. 37, n°2, 2023, p. 51-71.
[37] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[38] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[39] 冯刚 [Gang Feng] et 胡忠浩 [Zhonghao Hu], « 新时代中国共产党人民幸福观的理论论析 [Analyse théorique de la conception du bonheur du peuple par le Parti communiste chinois dans la nouvelle ère] », 思想战线 [Thinking], vol. 51, n°1, 2025, p. 15-23.
[40] Jinping Xi, La gouvernance de la Chine, Mille Fleurs, 2015.
[41] 冯刚 [Gang Feng] et 胡忠浩 [Zhonghao Hu], art. cit.
[42] Ibid.
[43] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[44] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[45] Ibid. et 喻平 [Ping Yu] , art. cit
[46] 喻平 [Ping Yu] , art. cit.
[47] 陈识远 [Shiyuan Chen], « 劳动幸福权与劳动权利的关系探析 [Analyse de la relation entre le droit au bonheur du travail et les droits du travail] », 劳动哲学研究 [Études de la philosophie du travail], 2024, p. 82-91.
[48] 崔玄子 [Xuanzi Cui], op. cit.
[49] Ibid.
[50] 杨文圣 [Wensheng Yang] et 侯应寿 [Yingshou Hou], « 论共同富裕的法治保障 [Sur la garantie juridique de la prospérité partagée] », 天津师范大学学报(社会科学版) [Journal of Tianjin Normal University (Social Sciences)], n°4, Sum n°295, 2024, p. 125-132.
[51] Ibid.
[52] 蒋盼 [Pan Jiang], art. cit.
[53] 崔玄子 [Xuanzi Cui], op. cit.
[54] Ibid.
[55] 孙春晨 [Chunchen Sun], « 改革开放以来中国人幸福观分析 [Analyse de la vision du bonheur des Chinois depuis la réforme et l’ouverture] », 思想政治工作研究 [Études sur le travail idéologique et politique], n°1, 2011, p. 21-23.
[56] Liza G. Steele, et Scott M. Lynch, « The Pursuit of Happiness in China: Individualism, Collectivism, and Subjective Well-Being during China’s Economic and Social Transformation », Social indicators research, n°2, 2013, p. 114-126.
[57] 박정원 [Jeong-Weon Park], « 북한의 ‘사회주의 법치국가 건설론’과법제 정비 동향 [La théorie de la construction d’un ‘État de droit socialiste’ en Corée du Nord et les tendances de l’amélioration du système juridique] », 동북아법연구 [Études juridiques sur l’Asie du Nord-Est], vol. 5, n°1, 2011, p. 1-29
[58] J’ai noté qu’elle était citée 11 fois.
[59] 정응기 [Eung-Ki Jeong], « 북한 사회주의헌법의 기본원리-주체사상 [Le principe fondamental de la Constitution socialiste de la Corée du Nord – L’idéologie du Juche] », 법학연구 [Études juridiques] , vol. 51, n°4, 2010, p. 219-243.
[60] 박정원 [Jeong-Weon Park], art. cit.
[61] 차남희 [Nam-Hui Cha], « 주체사상과 민족주의- 북한사회 통치이념의 항상성과 변용성 [L’idéologie du Juche et le nationalisme – Permanence et variabilité des principes de gouvernance de la société nord-coréenne] », 담론201 [Discours 201], vol. 15, n°4, 2012, p. 109-140.
[62] 이효원 [Hyo-Weon Lee], « 북한의 입법조직과 작용에 관한 법체계 [Le système juridique nord-coréen sur les organisations législatives et les législations]», 통일과 법률 [Unité et droit], vol. 46, n°46, 2021, p. 3-35.







