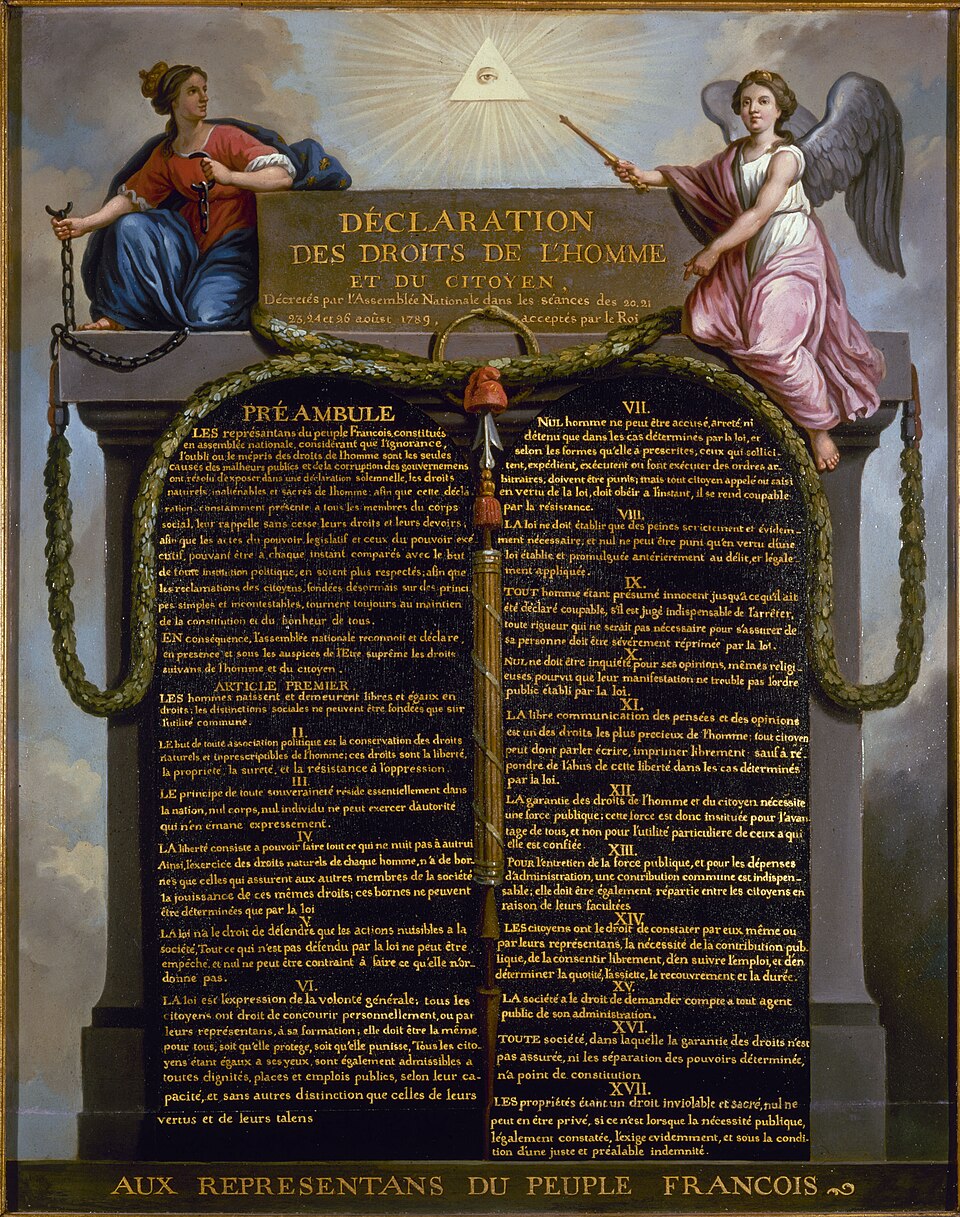Résumé :
Examiner l’existence d’un « droit au bonheur » à l’aune de l’action de Napoléon Bonaparte peut apparaître comme une gageure tant, accusé d’avoir été la cause des malheurs de l’Europe, l’héritage de l’Empereur reste controversé. Le « droit au bonheur » s’affirme pourtant comme un élément structurant du constitutionnalisme napoléonien. En effet, pour Napoléon, le but premier d’une Constitution consiste à assurer le bonheur des peuples. L’idée est énoncée avec constance, de ses écrits de jeunesse jusqu’aux Constitutions de l’Empire et de ses Etats satellites. Cet article se propose aussi bien d’interroger la genèse des idées de Bonaparte sur ce point, en insistant sur la part trop méconnue des textes révolutionnaires corses du XVIIIe siècle, ainsi que d’en mesurer les implications concrètes sur le plan du droit constitutionnel. Sur ce dernier aspect, l’élément le plus instructif de l’expérience napoléonienne réside certainement dans le fait que « le droit au bonheur », gravée dans le serment de la Constitution de l’an XII, servit de norme de référence à une sanction juridique, et non des moindres, à savoir le décret de déchéance de l’Empereur adopté par le Sénat en avril 1814.
Mots-clés : Droit ; bonheur ; Napoléon ; constitutionnalisme ; responsabilité.
Convoquer Napoléon Bonaparte afin d’évoquer la question du « droit au bonheur » peut apparaître comme une démarche contre-intuitive. Une telle entreprise comporte, assurément, quelque chose de déconcertant tant l’Empereur incarne, pour beaucoup, l’une des figures du malheur. On se souvient, à cet égard, des vives polémiques auxquelles les commémorations du bicentenaire de son décès ont pu donner lieu en 2021, il y a quelques années seulement. Conspué tour à tour comme esclavagiste, impérialiste, militariste, « mysogine », « fossoyeur de la République », « despote »[1], cet évènement a révélé toute la vitalité de la légende noire de Napoléon, que Jean Tulard s’était employé à décrypter, plusieurs années auparavant, dans son Anti-Napoléon[2].
Depuis ce point de vue, on peine, en effet, à percevoir ce que peut bien avoir en partage avec l’idée même de bonheur cet « ennemi du genre humain[3] » dépeint par Tolstoï dans Guerre et Paix.
Pourtant, sous la plume de Napoléon Bonaparte, la question du bonheur est omniprésente. Elle l’est à travers les lignes de ses échanges privés et singulièrement à la lecture des lettres adressées aux femmes qu’il a aimées : Laetitia, sa mère, Désirée Clary, son amour de jeunesse, ses épouses successives, Joséphine puis Marie-Louise. Mais ses écrits d’homme public sont pareillement parsemés de références au bonheur. Les occurrences sont innombrables. Dans ses œuvres de jeunesse, dans son abondante correspondance, dans les travaux préparatoires au Code civil, dans ses discours aux chambres et jusque dans les Constitutions du Consulat et de l’Empire, le bonheur des peuples est revendiqué comme un élément structurant de sa pensée et de son action politique.
En 1807, devant le Corps législatif, Napoléon a d’ailleurs ces mots, dignes d’une épitaphe : « Dans tout ce que j’ai fait, j’ai eu uniquement en vue le bonheur de mes peuples, plus cher à mes yeux que ma propre gloire[4] ». Si nous laissons aux historiens le soin de trancher s’il y est effectivement parvenu, il est en revanche évident que le thème du bonheur constitue, sans conteste, un invariant du constitutionnalisme napoléonien. La poursuite du bonheur du (des) peuple(s) se situe, en effet, au cœur des normes fondamentales du Consulat puis de l’Empire. Car c’est bien « dans la seule vue du bonheur du peuple[5] » que Bonaparte prête serment de gouverner aux termes des dispositions de la Constitution de l’an X. Serment qu’il réitérera au moment d’accéder à la magistrature impériale, sous le régime de la Constitution de l’an XII[6].
L’obligation du chef de l’Etat de gouverner au bénéfice du bonheur du peuple se présente donc bien comme une norme de droit positif. Devoir pour l’Etat, incarné par son premier représentant, le bonheur peut être ainsi être appréhendé, par analogie, comme un droit constitutionnel au bénéfice des gouvernés. C’est en ce sens que l’expression de « droit au bonheur » sera employée ici[7]. Certes, on pourra opposer à cette proposition la normativité douteuse des Constitutions de l’Empire, fréquemment dévaluées, chez les juristes comme chez les historiens, au motif qu’elles ne seraient que le paravent d’un pouvoir personnel et autoritaire et non la norme fondamentale appelée à en limiter les excès[8]. Le propos prêté à Bonaparte quant à la nécessité contribua certainement à installer cette vision. Si cela n’est pas dénué de toute vérité, il nous apparaît cependant que la question du bonheur, au sein du constitutionnalisme napoléonien, ne saurait être reléguée au rang d’une simple clause de style et mérite bien l’intérêt des juristes.
En conséquence, il s’agira de mettre en exergue, dans un premier temps, la place occupée par l’existence d’un droit au bonheur au sein du constitutionnalisme napoléonien (I), avant de s’interroger, dans un second temps, sur la portée effective d’un tel droit (II).
I. Le constitutionnalisme napoléonien et la consécration d’un droit au bonheur
Dès lors que l’on considère le constitutionnalisme comme une doctrine et non comme une simple collection de normes, il convient d’accorder au moins autant d’importances aux textes constitutionnels qu’aux principes qui les sous-tendent. Aussi, chez Napoléon Bonaparte, l’affirmation précoce d’un devoir constitutionnel des gouvernants à assurer le bonheur des peuples (A), est précédée de l’inscription de ces préceptes au sein des différentes Constitutions de l’Empire et de ses Etats satellites et permet de mieux la comprendre (B).
A) L’affirmation d’un droit au bonheur : la genèse des idées constitutionnelles de Bonaparte
La question du bonheur imprègne les idées constitutionnelles de Napoléon Bonaparte dès ses écrits de jeunesse. Sur ce terrain, Napoléon est généralement connu pour être l’auteur d’un Discours sur le bonheur[9], produit en réponse à un concours de l’Académie de Lyon, organisé en 1791, sur le thème : « Quelle vérité et quels sentiments importe-t-il le plus d’inculquer aux hommes pour leur bonheur ? ». Jugé sévèrement par le jury du concours[10], du point de vue de son contenu, la prose du jeune Bonaparte ne passa pas à la postérité. Depuis son exil sur l’île de Sainte-Hélène, l’Empereur déchu portera lui-même un regard sans concession sur la qualité de son œuvre, considérant que « tout cela méritait le fouet[11] ». Cette malheureuse tentative atteste cependant d’un intérêt ancien pour ces questions.
Cela étant, en 1791, le bonheur n’est pas une idée neuve chez Bonaparte. Dès sa toute première œuvre de jeunesse, intitulée Sur la Corse[12], et datée du 26 avril 1786, le thème est déjà présent sous sa plume. Napoléon n’a pas encore 17 ans et l’on y retrouve déjà une idée, de laquelle il ne se départira pas, à savoir que « le but du gouvernement est la tranquillité et le bonheur des peuples[13] ».
Ce que ce texte a d’éclairant quant à la généalogie des idées constitutionnelles de Napoléon, ce sont les références explicites qu’il révèle. Sur la Corse est un texte relativement bref qui ne sert qu’un objectif : celui de légitimer le droit à la révolte des Corses face à la tyrannie de l’occupant. La chute de l’essai est sans appel : « Les Corses ont, en suivant toutes les lois de la justice, secouer le joug génois et peuvent en faire autant de celui des Français. Amen[14] ». Or, les sources d’inspiration du jeune Bonaparte laissent peu de place au doute. L’ensemble du propos s’avère être une reprise quasi textuelle de l’argumentaire développé par les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle au sein de deux manifestes : le Disinganno[15] de l’abbé Natali, paru en 1736, et la Giustificazione, dont l’auteur est l’abbé Salvini, qui fut publiée, une première fois en 1758[16] puis rééditée en 1764[17].
Dans Sur la Corse, comme ses devanciers, Napoléon défend l’idée que le peuple corse a le droit de résister à l’oppression dès lors que la République de Gênes est à la fois, selon la grille de lecture forgée par la doctrine thomiste et prolongée par les auteurs de la Seconde Scolastique, un tyran d’usurpation et un tyran d’exercice. Or, il est établi que Napoléon a eu en sa possession le Disinganno, dont une édition est conservée au fonds Libri où figurent nombre de ses manuscrits de jeunesse[18]. Quant à la Giustificazione, tout laisse à penser qu’il en eût également connaissance[19]. Aussi, sur la question du bonheur comme devoir des gouvernants, observons que Bonaparte pose les choses en des termes analogues à ceux contenus au sein des deux manifestes révolutionnaires. Lorsque le Disinganno affirme que « la felicità degli stati […] è la mira, e lo scopo d’ogni legge civile[20] » (le bonheur des Etats est l’objectif et la finalité de toute loi civile »), la Giustificazione, se référant à Cicéron et son De legibus, proclame que « la legge suprema d’ogni buon governo [è] la felicità de Popolo[21] » (la loi suprême de tout bon gouvernement est le bonheur du peuple »).
L’affirmation du bonheur comme le premier devoir du gouvernement, d’une part, et l’influence des Révolutions de Corse sur la pensée de Bonaparte, d’autre part, sont deux éléments que l’on retrouvera à la lecture d’autres de ses productions de jeunesse.
Dans ses Lettres à l’abbé Raynal, à qui il transmet son projet d’Histoire de la Corse, Napoléon fait, cette fois-ci, explicitement référence à l’œuvre de Pasquale Paoli, qui fit adopter en novembre 1755 une « Constitution propre à assurer le bonheur de la Nation[22] ». À cette occasion, le futur Empereur y rappelle que « M. Paoli dont les sages institutions assurèrent un instant notre bonheur […] consacra le premier ces principes qui dont le fondement de la prospérité des peuples[23] ».
Une fois encore, en 1791, dans son Discours sur le bonheur, Napoléon convoque Paoli et sa Constitution. Il le fait, certes, de façon très approximative et en énonçant quelques contre-vérités[24]. Il n’en demeure pas moins, qu’une fois encore, c’est à la période des Révolutions de Corse et au constitutionnalisme paolien qu’il associe la réalisation du bonheur public. Rappelant qu’ « arrivé au timon des affaires, appelé par ses compatriotes à leur donner des lois, M. Paoli établit une Constitution[25] », Bonaparte voit en lui le législateur qui est le mieux parvenu à mettre en œuvres des principes assurant le bonheur de son peuple[26].
Évidemment, les influences de Bonaparte sont multiples et il ne s’agit pas de tout expliquer par la littérature révolutionnaire corse. D’ailleurs, dans son Discours sur le bonheur, Bonaparte revendique lui-même son adhésion aux idées rousseauistes et se définit comme un « zélé disciple[27] » de l’abbé Raynal[28]. Il n’en demeure pas moins que sur la question du droit au bonheur, comme sur d’autres aspects, la corsité de la pensée napoléonienne, autrement dit son inscription au sein de la culture constitutionnelle corse, est généralement éludée et mérite, à l’évidence, d’être réévaluée[29].
B) La permanence du droit au bonheur à travers les constitutions napoléoniennes
Si dans son action politique, Napoléon Ie a incontestablement renoncé à nombre de ses idéaux de jeunesse, le principe au terme duquel le but de toute Constitution est de garantir le bonheur des peuples se caractérise, pour sa part, par une grande permanence.
On l’observe, en premier lieu, sous la plume de Bonaparte, à l’époque de la Révolution française, alors qu’il n’est encore qu’un acteur secondaire de la scène publique et un lointain observateur de l’œuvre constituante. Au moment des débats préparatoires à l’adoption de la Constitution monarchique de 1791, il écrit, depuis la Corse, à d’ « amatissimi compatrioti » (« bien-aimés compatriotes »), que « l’union [est nécessaire] pour établir sur des bases solides la Constitution qui doit faire notre bonheur[30] ». Plus tard, à l’été 1795, alors que la Constitution thermidorienne de l’an III est en cours de finalisation[31], Napoléon adresse à son frère Joseph, deux lettres à ce sujet. Dans la première, datée du 23 juin, il indique dans les mêmes termes que dans son essai Sur la Corse, que « l’on attend le bonheur et la tranquillité de cette Constitution[32] ». Puis signifie, à l’occasion de la seconde, à la date du 1e août soit quelques jours seulement avant l’adoption du texte par référendum, que « l’on est généralement satisfait de la nouvelle Constitution qui procure bonheur, tranquillité, sûreté et long avenir à la France[33] ». La constance des vues de Napoléon sur le sujet, depuis ses jeunes années, est manifeste, ce alors même que les deux textes constitutionnels de 1791 et 1795 ne contiennent aucune occurrence expresse du bonheur public.
De façon somme toute logique, il apparaît, en second lieu, qu’après avoir accédé à la magistrature suprême, le droit au bonheur des peuples constituera un trait caractéristique du constitutionnalisme napoléonien. Si la Constitution de l’an VIII fait exception, les Constitutions de l’an X et de l’an XII intègrent la poursuite du bonheur public au serment prêté par le Premier Consul, puis l’Empereur, et donnent ainsi une consistance constitutionnelle au principe. On pourrait objecter que l’Acte additionnel aux Constitutions de l’Empire, adopté en 1815 au retour de l’Ile d’Elbe ne fait plus aucune mention du devoir impérial de gouverner au bénéfice du bonheur du peuple. Il serait cependant exagéré de tirer prétexte de ce silence de la « Constitution benjamine » pour en déduire une rupture à cet égard, et ce, pour au moins deux raisons. D’abord car l’Acte additionnel, comme son nom l’indique, ne vient pas abroger le Sénatus-Consulte de l’an XII mais bien le compléter et l’amender. Napoléon Ie le confirme lui-même dans son discours prononcé sur le Champ-de-Mars au moment de la signature officielle de l’Acte, au cours duquel il annonce le projet – avorté – de refonte des « Constitutions […] éparses[34] ». Ensuite, car Napoléon réitère solennellement, à cet instant, de vouloir gouverner en respectant « la volonté du peuple » et en assurant « le bonheur de la France[35] ».
L’imprégnation du constitutionnalisme napoléonien par la dialectique du « droit au bonheur » se mesure, en troisième et dernier lieu, à l’aune de sa transposition au sein des lois fondamentales des Etats satellites de l’Empire. Ce corpus constitutionnel, somme toute peu étudié en doctrine, mériterait, sans doute, qu’on y prête davantage d’attention. Il serait, en effet, bien excessif de le réduire à la seule expression d’un simple mimétisme constitutionnel de nature coloniale. Il y a bien sûr une large part de cela dans l’octroi de ces Constitutions tant les similitudes avec les Sénatus-consulte napoléoniens sont patentes. Mais il y a, à l’évidence, autre chose qui transparait de cet ensemble hétérogène de normes. On y décèle tantôt une part de substrat constitutionnel national[36], tantôt une volonté de perfectionnement de l’écriture constitutionnelle dont la Constitution du Royaume de Westphalie, motivée par la volonté de Napoléon de l’ériger en « Etat-modèle[37] », est tout à fait caractéristique. Mimétisme, syncrétisme ou innovations normatives : la consécration constitutionnelle du « droit au bonheur » relève alternativement de ces trois types de logiques de ces Etats sous domination napoléonienne.
D’un point de vue formel, l’insertion du devoir étatique de pourvoir au bonheur des peuples s’y manifeste selon trois modalités différentes. On le retrouve, d’abord, au sein des actes préparatoires à la promulgation de la Constitution du Royaume de 1808, dite « Constitution de Bayonne » où, à la proclamation du Roi Joseph affirmant vouloir « établir la tranquillité et fixer le bonheur au sein de chaque ménage[38] », l’Assemblée répondit en acceptant « la grande Charte, qui fixe sur des bases immuables le bonheur de l’Espagne[39] ». La réception du « droit au bonheur » des peuples se matérialise, ensuite, moyennant quelques ajustements, par la déclinaison du serment constitutionnel figurant aux sénatus-consultes de l’an X et de l’an XII. C’est le cas de l’Acte constitutionnel du Royaume d’Italie (1805)[40], du Statut constitutionnel de la République de Lucca (1805)[41] et, une fois encore, de la Constitution de Bayonne (1808)[42]. Enfin, l’affirmation du bonheur comme fondement et finalité et de la Constitution est, dans certains cas, gravée au niveau des préambules de ces lois fondamentales. C’est le cas, par exemple, de l’Acte de Médiation de la République helvétique (1803)[43] – que l’on se propose d’intégrer au constitutionnalisme napoléonien lato sensu – et, de façon tout à fait explicite, concernant la Constitution de Westphalie dont les premiers mots proclament la volonté de l’Empereur d’ « établir pour le Royaume […] des constitutions fondamentales qui garantissent le bonheur des peuples[44] ».
II. Le constitutionnalisme napoléonien et l’effectivité du droit au bonheur
Une fois constatée la présence d’un « droit au bonheur » au sein des lois fondamentales de l’Empire et de ses Etats satellites, se pose la question de l’effectivité d’un tel droit et, partant, de sa portée juridique. Faut-il, dès lors, considérer que sa seule insertion au sein de la Constitution lui confère la valeur, non d’un simple principe philosophique, mais bien, d’un énoncé normatif ? Au sein du droit constitutionnel napoléonien, le « droit au bonheur » relève, assurément, du champ de la norme au sens où ces dispositions contiennent une prescription qui s’impose aux gouvernants (A) et dont la violation est susceptible de sanction (B).
A) Une prescription opposable aux gouvernants
Sauf à considérer qu’une Constitution puisse contenir des énoncés purement platoniques, il semble, en effet, difficile de dénier au « droit au bonheur » proclamé par les Constitutions napoléoniennes, le statut de norme juridique. Une Constitution ne bavarde pas, elle prescrit. On ne peut ici que partager le point de vue de Burdeau considérant que « la difficulté n’est pas tant d’établir le caractère juridique » des énoncés inspirés par les principes de philosophie politique rencontrés, notamment, au sein des déclarations des droits « que de déterminer le degré leur force obligatoire[45] ». Le propos est parfaitement transposable à la question du « droit au bonheur ».
Le fait qu’un tel principe figure seulement au niveau d’un Préambule ou d’un serment constitutionnel ne retranche rien au raisonnement. Sous la Ve République, le Conseil constitutionnel n’a-t-il pas reconnu la pleine constitutionnalité du Préambule de 1958[46] et même de la devise de la République française, reproduite à l’article 2 de la Constitution, de laquelle il a déduit l’existence d’un principe constitutionnel de « fraternité » opposable au législateur[47] ?
Or, si l’on admet qu’un énoncé constitutionnel est, par nature, un énoncé normatif – ou n’est pas – l’engagement solennel de gouverner « dans la seule vue […] du bonheur du peuple » s’impose, sans conteste, à l’action du chef de l’Etat, clé de voûte du régime, qui dispose non seulement de l’intégralité du pouvoir exécutif, de l’initiative législative et, par-delà les textes, d’une influence considérable – c’est un euphémisme – eu égard au vote de la loi.
En d’autres termes, le « droit au bonheur » se présente donc comme une norme téléologique, ou finaliste, qui prescrit à ce dernier, et par extrapolation aux différents pouvoirs publics constitutionnels, d’agir en vue de la réalisation du bonheur du peuple. Ce faisant, le « droit au bonheur » est une obligation de nature constitutionnelle.
Mais n’est-il pas davantage ? Léon Duguit, évoquant la question des Déclarations des droits dans son Traité de droit constitutionnel considère, à cet égard, que les principes fondamentaux qui y figurent sont « [supérieurs] même […] à la loi constitutionnelle[48] ». Félicien Lemaire pousse le raisonnement plus loin encore lorsqu’il pose, à son tour, la question de la supraconstitutionnalité du « droit au bonheur » et émet l’hypothèse que ce droit puisse être « la norme hypothétique fondamentale[49] », la norma normarum.
Dans le cadre qui nous occupe, il semble bien qu’au sein du constitutionnalisme napoléonien, certains principes constitutionnels découlent directement de l’obligation supérieure d’assurer le bonheur du peuple. C’est le cas, par exemple, de l’ordonnancement des institutions impériales. Sur ce point, le texte de la délibération du Sénat conservateur adoptée le 4 mai 1804, dernière étape du processus constitutionnel ayant conduit à l’avènement de l’Empire et date de naissance officielle du nouveau régime, est particulièrement instructif. Par cet acte, les sénateurs approuvent le sénatus-consulte qui, selon leurs mots, vise à instaurer « le gouvernement héréditaire d’un seul, réglé par la loi pour le bonheur de tous[50] ». Ce pouvoir exécutif fort et dont la stabilité sera garantie par le principe d’hérédité est, toujours au termes du décret sénatorial, le plus sûr moyen de défendre la « liberté publique » et de maintenir l’ « égalité » mais sous la réserve – déterminante – que l’Empereur respecte le principe de souveraineté populaire et « baisse ses faisceaux devant l’expression de la volonté souveraine du peuple qui l’aura proclamé ». Le principe de souveraineté du peuple apparaît comme un impératif constitutionnel indispensable à son bonheur figurait. L’idée figurait d’ailleurs, déjà, dans le serment de l’an X : « je jure […] de n’employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l’aurai reçu ». Et si, malgré le rappel à l’ordre du Sénat conservateur, la formule est absente du texte de l’an XII, le principe au terme duquel le pouvoir impérial repose, en dernier ressort, sur la volonté populaire, demeure et se vérifiera au moment de la destitution de l’Empereur par les mêmes sénateurs en 1814.
Quant à la liberté publique et à l’égalité des droits, caractéristiques d’un « gouvernement libéral », elles impliquent le rejet du « régime féodal ». À cet égard, aux termes de la Constitution de l’an XII, le Sénat, en sa qualité de gardien de la constitutionnalité des normes, est tout particulièrement chargé de veiller à ce que les « décrets du Corps législatif » ne visent pas « au rétablissement du régime féodal » et à la remise en cause de l’ « irrévocabilité de la vente des biens nationaux » qui en est l’une des dimensions[51]. L’irréversible rupture avec l’Ancien Régime que le constitutionnalisme napoléonien entend assurer est exprimé nettement dans la lettre de Napoléon à son frère, le roi Jérôme, par laquelle il lui remet le texte de la Constitution du Royaume de Westphalie qui doit garantir que « les individus qui ne sont point nobles et qui ont des talents aient un égal droit à [la] considération et aux emplois ; […] que toute espèce de servage et de liens intermédiaires entre le souverain et la dernière classe du peuple soit entièrement abolie[52] ». De même, la constitutionnalisation du jury criminel et du Code civil sont d’autres marques du régime nouveau censé assuré le bonheur des peuples. Et, quoique le Code civil, usuellement qualifié de « Constitution civile de la France » à la suite des travaux du doyen Carbonnier[53], ne revête formellement qu’une valeur législative sous le régime des sénatus-consultes propres au territoire de la « République française », il n’en n’est pas moins irrigué par la poursuite du « droit au bonheur ». Il suffit pour s’en convaincre de relire le Discours préliminaire de Portalis ou encore les travaux préparatoires du Conseil d’Etat pour constater combien ces sources sont jalonnés de références au bonheur des individus.
B) Une sanction exercée par le Sénat
L’effectivité réelle du « droit au bonheur » peut légitimement être mise en doute dès lors que les manquements de l’Empereur à ses devoirs constitutionnels, durant son règne, sont patents. À cet égard, ce sont les dispositions constitutionnelles relatives à la liberté politique qui ont été les plus durement malmenées : le dévoiement des plébiscites, la mainmise sur le processus électoral, la suppression du Tribunat ou encore la soumission du Sénat relègueront le principe de souveraineté du peuple à l’état de chimère. Le césarisme impérial tend, in fine, à identifier la réalisation du « droit au bonheur » à la seule personne de l’Empereur. On assiste, à cet égard à une forme de reductio ad personam du bonheur du peuple parfaitement résumée dans cette formule du décret impérial instaurant l’Université : « la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples[54] ».
Cette distorsion entre l’énoncé normatif et sa réalité effective, constatée sous l’Empire, renvoie à une interrogation plus générale, à savoir la possibilité d’une sanction juridictionnelle du droit au bonheur. Sur le terrain de la théorie du droit, rappelons l’importance de cette controverse au sens où pour l’école réaliste « la norme procède de la sanction[55] ». Quant aux penseurs normativistes, à l’instar de Kelsen, s’ils postulent qu’en toute hypothèse « la norme précède la sanction[56] », ils n’en n’admettent pas moins l’impérieuse nécessité d’un mécanisme juridictionnelle qui en garantisse l’effectivité.
Or, la Constitution de l’an XII abritait un embryon de contrôle de constitutionnalité exercé par le Sénat. Celui-ci pouvait théoriquement constater la non-conformité vis-à-vis de l’ordre constitutionnel d’un décret du Corps législatif et, par une délibération motivée transmise à l’Empereur, « exprimer l’opinion qu’il n’y a pas lieu à promulguer la loi[57] ». À ce titre, il aurait pu s’ériger en gardien du droit au bonheur. Il ne le fit jamais. Du moins jusqu’en avril 1814 où il précipita la première abdication de Napoléon Ie en adoptant un décret prononçant sa déchéance du trône impérial.
Tout le réquisitoire des sénateurs repose, alors, sur la démonstration que Napoléon a « déchiré le pacte[58] » constitutionnel duquel il tenait le pouvoir impérial. Pour mieux comprendre la motivation de l’acte de destitution de 1814, il convient de relire le texte de la délibération par laquelle les sénateurs approuvaient, dix ans plus tôt, la Constitution de l’an X et où l’interprétation pactiste du pouvoir impérial était déjà affirmée :
Il faut que la liberté et l’égalité soient sacrées ; que le pacte social ne puisse pas être violé ; que la souveraineté du Peuple ne soit jamais méconnue ; et que, dans les temps les plus reculés, la Nation ne soit jamais forcée de ressaisir sa puissance, et de venger sa majesté outragée[59].
Aussi, la motion d’avril 1814 s’emploie à détailler les nombreux manquements à la Constitution dont celui-ci s’est rendu coupable. Si l’argumentaire des sénateurs « se fondait sur une base juridique crédible, sinon incontestable », « sur le plan moral », on peut partager l’appréciation de Thierry Lentz quant à sa « bassesse[60] », tant le Sénat s’était rendu activement complice des faits dont il se prévalait ici contre Napoléon.
Eu égard au sujet qui nous occupe, le grand intérêt de ce texte est de constater que le « droit au bonheur » sert ici de norme de référence afin de motiver la sanction prononcée à l’encontre du chef de l’Etat par le Sénat. En ce sens, la destitution de l’Empereur est notamment prononcée en « considérant qu’au lieu de régner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français, aux termes de son serment, Napoléon a mis le comble aux malheurs de la patrie[61] ».
Ce faisant, il s’agit potentiellement de la première sanction prononcée au visa d’une disposition constitutionnelle garantissant le bonheur du peuple. Il n’est question ici ni de la reconnaissance d’un droit subjectif et individuel, ni d’un contentieux objectif conduisant à l’abrogation d’une norme mais d’une sanction résultant du principe de responsabilité des gouvernants. Une telle démarche relève, en définitive, d’un syllogisme imparable : si la Constitution dispose que le premier devoir des gouvernants est d’agir au bénéfice du bonheur du peuple, un gouvernant qui, contrevenant aux dispositions constitutionnelles, mènerait une politique de malheur doit être sanctionné par le biais d’un mécanisme constitutionnel idoine. C’est tout le sens de la mise en jeu de la responsabilité de l’Empereur devant la Chambre haute.
Ici, la singularité du décret de 1814 est de s’employer à motiver la défiance exprimée à l’égard du chef de l’Etat en qualifiant juridiquement les incriminations relevées comme des violations de la norme fondamentale, alors que les motions de censures modernes se contentent généralement de justifier la rupture du lien de confiance par des considérations de politique générale. Expression d’une responsabilité de type politico-juridique, elle atteste que la garantie du bonheur public peut bien revêtir la forme d’un principe normatif véritable.
Mais finalement, de façon plus générale, ne suggère-t-elle pas que la mise en jeu de la responsabilité gouvernementale repose toujours, au moins implicitement, sur la sanction d’une politique supposément contraire aux intérêts et au bonheur du peuple ? La question a ici une résonance tout à fait actuelle et une portée concrète.
En guise de conclusion, observons que par un pied de nez de l’Histoire, Napoléon qui fut, en son temps, l’un des promoteurs de la constitutionnalisation du « droit au bonheur », vit finalement le principe appliqué à son détriment, coupable, selon ses opposants, de n’avoir exercé le pouvoir que pour le malheur du monde. Imprégné de la culture constitutionnelle corse et de la pensée des Lumières – de laquelle la première participe à l’évidence –, l’Empereur eût été sans doute bien inspiré de méditer, par réminiscence de ses lectures de jeunesse, ce principe évident : on ne fait pas le bonheur des peuples contre leur gré. C’est sans fard que le Sénat et la cohorte des armées coalisées sont venus le lui rappeler.
[1] On renverra, sur cet aspect, au numéro hors-série publié par le journal Le Monde...
[1] On renverra, sur cet aspect, au numéro hors-série publié par le journal Le Monde et intitulé « Napoléon, l’héritage » (hors-série n° 56, avril 2021, 100 p. Ou encore : Thierry Lentz, « Les 5 procès de Napoléon », Le Figaro, 22 mars 2021 ; Loris Boichot, L'empereur des Français reste une figure controversée dans la classe politique, Le Figaro, 5 mai 2021.
[2] Jean Tulard, L’anti-Napoléon. La légende noire de l’Empereur, Paris, Gallimard, 2013, 343 p.
[2] Jean Tulard, L’anti-Napoléon. La légende noire de l’Empereur, Paris, Gallimard, 2013, 343 p.
[3] Léon Tolstoï, Guerre et paix, t. I, Paris, Hachette, 1901, p. 409.
[3] Léon Tolstoï, Guerre et paix, t. I, Paris, Hachette, 1901, p. 409.
[4] Discours de Napoléon devant le Corps législatif, 17 août 1807.
[4] Discours de Napoléon devant le Corps législatif, 17 août 1807.
[5] Sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), art. 44 : « Le serment est ainsi conçu : - « Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté...
[5] Sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), art. 44 : « Le serment est ainsi conçu : - « Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m'opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n'employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l'aurai reçu » ».
[6] Sénatus-consulte du 28 floréal an XII (, art. 53. Le texte diffère légèrement mais le principe demeure : « Le serment de l'Empereur est ainsi conçu : « Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter...
[6] Sénatus-consulte du 28 floréal an XII (, art. 53. Le texte diffère légèrement mais le principe demeure : « Le serment de l'Empereur est ainsi conçu : « Je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l'égalité des droits, la liberté politique et civile, l'irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ; de maintenir l'institution de la Légion d'honneur ; de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français » ».
[7] L’utilisation de la notion de « droit au bonheur » ne postule pas nécessairement l’existence d’un droit-créance (« droit à ») au sens d’une justiciabilité subjective dudit droit.
[7] L’utilisation de la notion de « droit au bonheur » ne postule pas nécessairement l’existence d’un droit-créance (« droit à ») au sens d’une justiciabilité subjective dudit droit.
[8] Thierry Lentz, « Le régime napoléonien était-il un état de droit ? », Revue du Souvenir napoléonien, n° 497, 2013, p. 12-19
[8] Thierry Lentz, « Le régime napoléonien était-il un état de droit ? », Revue du Souvenir napoléonien, n° 497, 2013, p. 12-19
[9] Napoléon Bonaparte, « Discours sur le bonheur », in Œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte, t. I, Paris, Albert Savine, 1888, p. 21-44
[9] Napoléon Bonaparte, « Discours sur le bonheur », in Œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte, t. I, Paris, Albert Savine, 1888, p. 21-44
[10] Masson note que le manuscrit de Napoléon « fut déclaré en dessous du médiocre », tour à tour qualifié de « songe ...
[10] Masson note que le manuscrit de Napoléon « fut déclaré en dessous du médiocre », tour à tour qualifié de « songe très prononcé » ou jugé « trop décousu et trop mal écrit ». Frédéric Masson, Napoléon dans sa jeunesse. 1769-1793, Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques, 1907, p. 262.
[11] Henri-Gratien Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène. Journal 1818-1819, Manuscrit déchiffré et annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Albin Michel, 1959, p. 321.
[11] Henri-Gratien Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène. Journal 1818-1819, Manuscrit déchiffré et annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Albin Michel, 1959, p. 321.
[12] Frédéric Masson et Guido Biagi, Napoléon inconnu. Papiers inédits (1786-1793), Paris, Paul Ollendorf, 1895, p. 141-144.
[12] Frédéric Masson et Guido Biagi, Napoléon inconnu. Papiers inédits (1786-1793), Paris, Paul Ollendorf, 1895, p. 141-144.
[13] Ibid., p. 142.
[13] Ibid., p. 142.
[14] Ibid., p. 144.
[14] Ibid., p. 144.
[15] Disinganno intorno alla guerra di Corsica. Scoperto da Curzio Tulliano, Corso...
[15] Disinganno intorno alla guerra di Corsica. Scoperto da Curzio Tulliano, Corso, ad un suo amico dimorante nell’isola, Cologne, 1736, 92 p. Il s’agit là de l’édition qui fut en possession du jeune Bonaparte et conservée au Fonds Libri.
[16] [17] Giustificazione della rivoluzione di (...)
[16] Giustificazione della rivoluzione di Corsica, e della ferma risoluzione presa da'Corsi, di non sottomettersi mai più al dominio di Genova, Oletta, 1758, 408 p.
[17] Giustificazione della rivoluzione di Corsica, combattuta dalle Riflessioni di un Genovese e difesa dalle osservazioni di un Corso, Corte, Battini, 1764, 619 p.
[18] Pour le détail des manuscrits de ...
[18] Pour le détail des manuscrits de jeunesse de Bonaparte figurant au Fonds Libri : Frédéric Masson, Napoléon inconnu, op. cit., p. 166-167. V. également : Jean-Dominique Poli, Napoléon inconnu. De la révolution de Corse à l’Europe impériale, Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2024, p. 20-25.
[19] La Giustificazione fit l’objet d’une grande diffusion chez les lettrés du XVIIIe siècle. À cet égard, Jean-Dominique Poli fait observer que « cet ouvrage fut systématiquement ...
[19] La Giustificazione fit l’objet d’une grande diffusion chez les lettrés du XVIIIe siècle. À cet égard, Jean-Dominique Poli fait observer que « cet ouvrage fut systématiquement lu et commenté en Corse, tout en étant destiné au public cultivé européen auprès duquel il connut un réel succès » (op. cit., note n° 6, p. 21). Évoquant son projet de rédaction d’une Histoire de la Corse, le même auteur écrit que « la Giustificazione delle rivoluzione di Corsica de Don Gregorio Salvini […] lui permet de saisir les ressorts de la pensée politique corse » et « inspire largement l’ouvrage du jeune Bonaparte (op. cit., p. 21). L’examen attentif de Sur la Corse renforce la présomption d’intertextualité. Les passages consacrés à l’introduction originelle des Génois en Corse – plus précisément à Bunifaziu et dans le Cap Corse – par la « trahison », la « ruse » ou encore la « perfidie » (op. cit., p. 143), renvoient directement aux pages de la Giustificazione par lesquelles l’auteur s’emploie à convaincre de la tyrannie d’usurpation génoise (Giustificazione della rivoluzione di Corsica, op. cit., 1758, p. 5-6 et p. 56-57 de l’édition de 1764). Or, Bonaparte n’a pas pu puiser ces références dans le Disinganno, dont elles sont absentes.
[20] Disinganno, op. cit., p. 10.
[20] Disinganno, op. cit., p. 10.
[21] Giustificazione, édition de 1758, p. 134 et p. 268 de l’édition de 1764.
[21] Giustificazione, édition de 1758, p. 134 et p. 268 de l’édition de 1764.
[22] Ce sont les mots qui concluent le Préambule de la Constitution corse de 1755...
[22] Ce sont les mots qui concluent le Préambule de la Constitution corse de 1755 (« [una] costituzione tale, che da essa ne derivi la felicità della Nazione ») et constituent l’affirmation pionnière du « droit au bonheur » au sein d’un texte constitutionnel. V. Antonio Trampus, Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, Bari, Laterza, 2008, Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, Ajaccio, Albiana, p. 60-62
[23] Napoléon Bonaparte, « Lettres sur la Corse », in Œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte, op. cit., p. 58.
[23] Napoléon Bonaparte, « Lettres sur la Corse », in Œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte, op. cit., p. 58.
[24] Il y a en effet plus d’une approximation dans le propos de Bonaparte lorsque celui-ci affirme que la Constitution de Paoli était basée...
[24] Il y a en effet plus d’une approximation dans le propos de Bonaparte lorsque celui-ci affirme que la Constitution de Paoli était basée sur les « mêmes divisions administratives » que la Constitution française de 1791ou encore lorsqu’il soutient que Paoli « renversa le clergé ». En outre, faisant l’éloge du système de propriété collective corse, le jeune Bonaparte en attribue à Paoli le mérite, alors même qu’il s’agit là d’un mode gestion séculaire des terres.
[25] Napoléon Bonaparte, « Discours sur le...
[25] Napoléon Bonaparte, « Discours sur le bonheur », op. cit., p 32.
[26] Ibid., p. 25 et 31.
[26] Ibid., p. 25 et 31.
[27] Ibid., p. 23. [28] Jean Tulard décrit...
[27] Ibid., p. 23.
[28] Jean Tulard décrit Rousseau et l’abbé Raynal, comme étant, à cette époque, les « maîtres à penser »de Napoléon (Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 63)… et relève, par ailleurs, que c’est « parce qu’ils ont défendu l’indépendance de la Corse » que ces auteurs ont les faveurs du futur Empereur (ibid., p. 44).
[29] Sur l’influence de Pasquale Paoli et, plus largement, de la tradition politique corse sur la pensée et l’œuvre de Napoléon Bonaparte on renverra à Jean-Guy Talamoni (dir.), Héros de Plutarque, Ajaccio, Alain Piazzola, 2022, 305 p, et plus largement aux nombreux travaux organisés par l’UMR CNRS LISA 6240 de l’Università di Corsica dans le cadre du projet de recherche « Paoli-Napoléon ».
[29]
[1] Sur l’influence de Pasquale Paoli et, plus largement, de la tradition politique corse sur la pensée et l’œuvre de Napoléon Bonaparte on renverra à Jean-Guy Talamoni (dir.), Héros de Plutarque, Ajaccio, Alain Piazzola, 2022, 305 p, et plus largement aux nombreux travaux organisés par l’UMR CNRS LISA 6240 de l’Università di Corsica dans le cadre du projet de recherche « Paoli-Napoléon ».
[30] Lettre de Napoléon à un destinataire...
[30] Lettre de Napoléon à un destinataire non identifié, Corse, 1790, in, Correspondance de Napoléon, CG1-0040.md, napoleonica.org.
[31] Il a, à cette époque, définitivement quitté la Corse et rompu politiquement avec Paoli.
[31] Il a, à cette époque, définitivement quitté la Corse et rompu politiquement avec Paoli.
[32] Lettre de Napoléon à Joseph, Paris, 5 messidor an III (23 août 1795).
[32] Lettre de Napoléon à Joseph, Paris, 5 messidor an III (23 août 1795).
[33] Lettre de Napoléon à Joseph, 14 thermidor an III (1e août 1795).
[33] Lettre de Napoléon à Joseph, 14 thermidor an III (1e août 1795).
[34] Discours de l’Empereur aux collèges électoraux, Paris, Champ-de-Mars,...
[34] Discours de l’Empereur aux collèges électoraux, Paris, Champ-de-Mars, 1e juin 1815, extraits du Moniteur du 2 juin 1815.
[35] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Quant au Statut de Bayonne de 1808 et l’ « espagnolisation du modèle constitutionnel français » : Jean-Baptiste Busaal,...
[36] Quant au Statut de Bayonne de 1808 et l’ « espagnolisation du modèle constitutionnel français » : Jean-Baptiste Busaal, « Révolution et transfert de droit : la portée de la Constitution de Bayonne », Historia Constitucional, n° 9, 2008, p. 6-15. Quant à la part de tradition nationale au sein de la Constitution du Royaume d’Italie : Carlo Capra, « Les collèges électoraux de la République italienne et du royaume d'Italie », Annales historiques de la Révolution française, n° 230, 1977, p. 566-586, Carlo Botta, Histoire des peuples d’Italie, t. 3, Paris, Raymond, 1825, p. 280-283.
[37] Xavier Abeberry Magescas, « Le Royaume de Westphalie napoléonien, tentative d’instauration d’un « Etat-modèle » », Revue du souvenir napoléonien, n° 450, 2004, p. 39-48.
[37] Xavier Abeberry Magescas, « Le Royaume de Westphalie napoléonien, tentative d’instauration d’un « Etat-modèle » », Revue du souvenir napoléonien, n° 450, 2004, p. 39-48.
[38] La Constitution de Bayonne est octroyée formellement par le Roi Joseph...
[38] La Constitution de Bayonne est octroyée formellement par le Roi Joseph, mais il ne fait aucun doute que Napoléon en est l’auteur véritable.
[39] Adresse de l’assemblée de Bayonne à l’empereur Napoléon sur l’acceptation de la...
[39] Adresse de l’assemblée de Bayonne à l’empereur Napoléon sur l’acceptation de la Constitution, 7 juillet 1808.
[40] Second Statut constitutionnel du ...
[40] Second Statut constitutionnel du Royaume d’Italie relatif à la Régence, aux grands officiers du Royaume et au serment, 19 mars 1805, art. 19. L’objectif constitutionnel visant à assurer le bonheur du peuple figure également au sein de la Proclamation de la Consulta di Stato précédant la promulgation du Statut constitutionnel (19 mars 1805) : « [La République] fit certainement un grand pas lorsqu’à l’occasion des comices réunis à Lyon […], elle refondit la Constitution et proclama un chef dont les lumières et la puissance l’auraient conduit plus rapidement au bonheur et à la considération auxquels son destin lui permettait de prétendre ».
[41] Statut constitutionnel... [42] Constitution
[41] Statut constitutionnel de la République de Lucca du 23 juin 1805, art. V. En outre, le Décret additionnel à la nouvelle Constitution, du 12 juin, décidant de demander comme chef du gouvernement lucquois Son Altesse Sérénissime le Prince de Piombino est approuvé par le Gonfalonier et les Anciens de la République « considérant que le bonheur de la République lucquoise sera assuré par ce moyen ».
[42] Constitution de Bayonne du 6 juin 1808, art. 6.
[43] Acte de Médiation, 19 février 1803 : « Ayant […] employé tous les moyens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses,...
[43] Acte de Médiation, 19 février 1803 : « Ayant […] employé tous les moyens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses, nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que celle du bonheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions à prononcer, et sans entendre nuire à l'indépendance de la Suisse, STATUONS ce qui suit ».
[44] Constitution du Royaume de Westphalie du 15 novembre 1811, Préambule.
[44] Constitution du Royaume de Westphalie du 15 novembre 1811, Préambule.
[45] Georges Burdeau, Traité de science politique, t. IV : « Le statut du pouvoir dans l’Etat », 2e éd., Paris, LGDJ, 1983, p. 132.
[45] Georges Burdeau, Traité de science politique, t. IV : « Le statut du pouvoir dans l’Etat », 2e éd., Paris, LGDJ, 1983, p. 132.
[46] Cons. const., 16 juil. 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association.
[46] Cons. const., 16 juil. 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association.
[47] Cons. const., 06 juil. 2018, n° 2018-717/718, M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger].
[47] Cons. const., 06 juil. 2018, n° 2018-717/718, M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger].
[48] Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. III, 3e éd., Paris, Boccard, 1930, p. 607
[48] Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. III, 3e éd., Paris, Boccard, 1930, p. 607
[49] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », RFDA, n° 1, 2015, p. 116.
Il est évident ici que le terme de « norme hypothétique fondamentale », et même celui de « Grundnorm », puisés dans le lexique kelsénien, sont mobilisés pour signifier – ou suggérer – la supériorité du « droit au bonheur » eu égard à la norme constitutionnelle elle-même, et non au sens normativiste des théories de Kelsen. En effet, selon le penseur autrichien, la Grundnorm...
[49] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », RFDA, n° 1, 2015, p. 116.
Il est évident ici que le terme de « norme hypothétique fondamentale », et même celui de « Grundnorm », puisés dans le lexique kelsénien, sont mobilisés pour signifier – ou suggérer – la supériorité du « droit au bonheur » eu égard à la norme constitutionnelle elle-même, et non au sens normativiste des théories de Kelsen. En effet, selon le penseur autrichien, la Grundnorm n’est qu’une « hypothèse logico-transcendantale » lui permettant de fonder la validité de la Constitution et donc d’assurer la cohérence de sa théorie des normes. Elle est, en conséquence, dénuée de toute dimension axiologique. Or, si l’on considère le « droit au bonheur » comme la norma normarum dont résultent toutes les normes de l’ordre juridique, la proposition conduit à la considérer comme une norme de droit naturel.
[50] Délibération du Sénat conservateur du 14 floréal an XII (14 mai 1804).
[50] Délibération du Sénat conservateur du 14 floréal an XII (14 mai 1804).
[51] Constitution de l’an XII, art. 70.
[51] Constitution de l’an XII, art. 70.
[52] Lettre de Napoléon au Roi Jérôme du 15 novembre 1807.
[52] Lettre de Napoléon au Roi Jérôme du 15 novembre 1807.
[53] Jean Carbonnier, « Le Code civil », in Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t. 2, vol 2., Paris, Gallimard, 1986, p.293-315. Selon Jean Carbonnier, du fait de son « aura d’éternité », le Code civil revêt, à tout le moins, une « constitutionnalité […] sociologique ». V. également Yves Gaudemet, « Le code civil, « Constitution civile de la France » », in 1804-2004. Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p. 297-308
[53] Jean Carbonnier, « Le Code civil », in Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t. 2, vol 2., Paris, Gallimard, 1986, p.293-315. Selon Jean Carbonnier, du fait de son « aura d’éternité », le Code civil revêt, à tout le moins, une « constitutionnalité […] sociologique ». V. également Yves Gaudemet, « Le code civil, « Constitution civile de la France » », in 1804-2004. Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p. 297-308
[54] Décret impérial portant organisation de l’Université, 17 mars 1808. Les choses sont peut-être plus claires encore dans cette lettre adressée aux différents chefs d’Etats pour annoncer son retour au pouvoir durant les Cent-Jours ...
[54] Décret impérial portant organisation de l’Université, 17 mars 1808. Les choses sont peut-être plus claires encore dans cette lettre adressée aux différents chefs d’Etats pour annoncer son retour au pouvoir durant les Cent-Jours : « Le rétablissement du trône impérial était nécessaire au bonheur des Français ».
[55] Alexandre Viala, « Qu’est-ce qu’une...
[47] Cons. const., 06 juil. 2018, n° 2018-717/718, M. Cédric H. et autre [Délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger].
[56] Ibid.
[56] Ibid.
[57] Faisant écho à une formule célèbre, les dispositions du Sénatus-consulte de l’an XII brillent ici par leur obscurité tant les prérogatives du Sénat y sont ambigües. En effet, le texte de l’an XII semble limiter son...
[57] Faisant écho à une formule célèbre, les dispositions du Sénatus-consulte de l’an XII brillent ici par leur obscurité tant les prérogatives du Sénat y sont ambigües. En effet, le texte de l’an XII semble limiter son action a un avis de non-conformité et réserver la décision d’inconstitutionnalité de la norme législative à l’Empereur : « l'Empereur, après avoir entendu le Conseil d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi » (art. 72). Cependant, l’article 70 de la Constitution précise que l’office du Sénat, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, s’exerce « sans préjudice de l'exécution [de l’article] 21 » de la Constitution de l’an VIII… qui dispose que le Sénat « maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement ».
[58] Décret du Sénat du 3 avril 1814 portant que Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et que le droit d'hérédité, établi dans sa famille, est aboli.
[58] Décret du Sénat du 3 avril 1814 portant que Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et que le droit d'hérédité, établi dans sa famille, est aboli.
[59] Délibération du Sénat conservateur, op. cit.
[59] Délibération du Sénat conservateur, op. cit.
[60] Thierry Lentz, Napoléon. Dictionnaire historique, Paris, Perrin, 2020, p. 301.
[60] Thierry Lentz, Napoléon. Dictionnaire historique, Paris, Perrin, 2020, p. 301.
[61] Décret du Sénat du 3 avril, op. cit.
[61] Décret du Sénat du 3 avril, op. cit.
[1] On renverra, sur cet aspect, au numéro hors-série publié par le journal Le Monde et intitulé « Napoléon, l’héritage » (hors-série n° 56, avril 2021, 100 p. Ou encore : Thierry Lentz, « Les 5 procès de Napoléon », Le Figaro, 22 mars 2021 ; Loris Boichot, L’empereur des Français reste une figure controversée dans la classe politique, Le Figaro, 5 mai 2021.
[2] Jean Tulard, L’anti-Napoléon. La légende noire de l’Empereur, Paris, Gallimard, 2013, 343 p.
[3] Léon Tolstoï, Guerre et paix, t. I, Paris, Hachette, 1901, p. 409.
[4] Discours de Napoléon devant le Corps législatif, 17 août 1807.
[5] Sénatus-consulte du 16 thermidor an X (4 août 1802), art. 44 : « Le serment est ainsi conçu : – « Je jure de maintenir la Constitution, de respecter la liberté des consciences, de m’opposer au retour des institutions féodales, de ne jamais faire la guerre que pour la défense et la gloire de la République, et de n’employer le pouvoir dont je serai revêtu que pour le bonheur du peuple, de qui et pour qui je l’aurai reçu » ».
[6] Sénatus-consulte du 28 floréal an XII (, art. 53. Le texte diffère légèrement mais le principe demeure : « Le serment de l’Empereur est ainsi conçu : « Je jure de maintenir l’intégrité du territoire de la République, de respecter et de faire respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ; de respecter et faire respecter l’égalité des droits, la liberté politique et civile, l’irrévocabilité des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt, de n’établir aucune taxe qu’en vertu de la loi ; de maintenir l’institution de la Légion d’honneur ; de gouverner dans la seule vue de l’intérêt, du bonheur et de la gloire du peuple français » ».
[7] L’utilisation de la notion de « droit au bonheur » ne postule pas nécessairement l’existence d’un droit-créance (« droit à ») au sens d’une justiciabilité subjective dudit droit.
[8] Thierry Lentz, « Le régime napoléonien était-il un état de droit ? », Revue du Souvenir napoléonien, n° 497, 2013, p. 12-19
[9] Napoléon Bonaparte, « Discours sur le bonheur », in Œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte, t. I, Paris, Albert Savine, 1888, p. 21-44
[10] Masson note que le manuscrit de Napoléon « fut déclaré en dessous du médiocre », tour à tour qualifié de « songe très prononcé » ou jugé « trop décousu et trop mal écrit ». Frédéric Masson, Napoléon dans sa jeunesse. 1769-1793, Paris, Société d’éditions littéraires et artistiques, 1907, p. 262.
[11] Henri-Gratien Bertrand, Cahiers de Sainte-Hélène. Journal 1818-1819, Manuscrit déchiffré et annoté par Paul Fleuriot de Langle, Paris, Albin Michel, 1959, p. 321.
[12] Frédéric Masson et Guido Biagi, Napoléon inconnu. Papiers inédits (1786-1793), Paris, Paul Ollendorf, 1895, p. 141-144.
[13] Ibid., p. 142.
[14] Ibid., p. 144.
[15] Disinganno intorno alla guerra di Corsica. Scoperto da Curzio Tulliano, Corso, ad un suo amico dimorante nell’isola, Cologne, 1736, 92 p. Il s’agit là de l’édition qui fut en possession du jeune Bonaparte et conservée au Fonds Libri.
[16] Giustificazione della rivoluzione di Corsica, e della ferma risoluzione presa da’Corsi, di non sottomettersi mai più al dominio di Genova, Oletta, 1758, 408 p.
[17] Giustificazione della rivoluzione di Corsica, combattuta dalle Riflessioni di un Genovese e difesa dalle osservazioni di un Corso, Corte, Battini, 1764, 619 p.
[18] Pour le détail des manuscrits de jeunesse de Bonaparte figurant au Fonds Libri : Frédéric Masson, Napoléon inconnu, op. cit., p. 166-167. V. également : Jean-Dominique Poli, Napoléon inconnu. De la révolution de Corse à l’Europe impériale, Bordeaux, Le Bord de l’eau, 2024, p. 20-25.
[19] La Giustificazione fit l’objet d’une grande diffusion chez les lettrés du XVIIIe siècle. À cet égard, Jean-Dominique Poli fait observer que « cet ouvrage fut systématiquement lu et commenté en Corse, tout en étant destiné au public cultivé européen auprès duquel il connut un réel succès » (op. cit., note n° 6, p. 21). Évoquant son projet de rédaction d’une Histoire de la Corse, le même auteur écrit que « la Giustificazione delle rivoluzione di Corsica de Don Gregorio Salvini […] lui permet de saisir les ressorts de la pensée politique corse » et « inspire largement l’ouvrage du jeune Bonaparte (op. cit., p. 21). L’examen attentif de Sur la Corse renforce la présomption d’intertextualité. Les passages consacrés à l’introduction originelle des Génois en Corse – plus précisément à Bunifaziu et dans le Cap Corse – par la « trahison », la « ruse » ou encore la « perfidie » (op. cit., p. 143), renvoient directement aux pages de la Giustificazione par lesquelles l’auteur s’emploie à convaincre de la tyrannie d’usurpation génoise (Giustificazione della rivoluzione di Corsica, op. cit., 1758, p. 5-6 et p. 56-57 de l’édition de 1764). Or, Bonaparte n’a pas pu puiser ces références dans le Disinganno, dont elles sont absentes.
[20] Disinganno, op. cit., p. 10.
[21] Giustificazione, édition de 1758, p. 134 et p. 268 de l’édition de 1764.
[22] Ce sont les mots qui concluent le Préambule de la Constitution corse de 1755 (« [una] costituzione tale, che da essa ne derivi la felicità della Nazione ») et constituent l’affirmation pionnière du « droit au bonheur » au sein d’un texte constitutionnel. V. Antonio Trampus, Il diritto alla felicità. Storia di un’idea, Bari, Laterza, 2008, Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, Ajaccio, Albiana, p. 60-62.
[23] Napoléon Bonaparte, « Lettres sur la Corse », in Œuvres littéraires de Napoléon Bonaparte, op. cit., p. 58.
[24] Il y a en effet plus d’une approximation dans le propos de Bonaparte lorsque celui-ci affirme que la Constitution de Paoli était basée sur les « mêmes divisions administratives » que la Constitution française de 1791ou encore lorsqu’il soutient que Paoli « renversa le clergé ». En outre, faisant l’éloge du système de propriété collective corse, le jeune Bonaparte en attribue à Paoli le mérite, alors même qu’il s’agit là d’un mode gestion séculaire des terres.
[25] Napoléon Bonaparte, « Discours sur le bonheur », op. cit., p 32.
[26] Ibid., p. 25 et 31.
[27] Ibid., p. 23.
[28] Jean Tulard décrit Rousseau et l’abbé Raynal, comme étant, à cette époque, les « maîtres à penser »de Napoléon (Napoléon, Paris, Fayard, 1987, p. 63)… et relève, par ailleurs, que c’est « parce qu’ils ont défendu l’indépendance de la Corse » que ces auteurs ont les faveurs du futur Empereur (ibid., p. 44).
[29] Sur l’influence de Pasquale Paoli et, plus largement, de la tradition politique corse sur la pensée et l’œuvre de Napoléon Bonaparte on renverra à Jean-Guy Talamoni (dir.), Héros de Plutarque, Ajaccio, Alain Piazzola, 2022, 305 p, et plus largement aux nombreux travaux organisés par l’UMR CNRS LISA 6240 de l’Università di Corsica dans le cadre du projet de recherche « Paoli-Napoléon ».
[30] Lettre de Napoléon à un destinataire non identifié, Corse, 1790, in, Correspondance de Napoléon, CG1-0040.md, napoleonica.org.
[31] Il a, à cette époque, définitivement quitté la Corse et rompu politiquement avec Paoli.
[32] Lettre de Napoléon à Joseph, Paris, 5 messidor an III (23 août 1795).
[33] Lettre de Napoléon à Joseph, 14 thermidor an III (1e août 1795).
[34] Discours de l’Empereur aux collèges électoraux, Paris, Champ-de-Mars, 1e juin 1815, extraits du Moniteur du 2 juin 1815.
[35] Ibid.
[36] Quant au Statut de Bayonne de 1808 et l’ « espagnolisation du modèle constitutionnel français » : Jean-Baptiste Busaal, « Révolution et transfert de droit : la portée de la Constitution de Bayonne », Historia Constitucional, n° 9, 2008, p. 6-15. Quant à la part de tradition nationale au sein de la Constitution du Royaume d’Italie : Carlo Capra, « Les collèges électoraux de la République italienne et du royaume d’Italie », Annales historiques de la Révolution française, n° 230, 1977, p. 566-586, Carlo Botta, Histoire des peuples d’Italie, t. 3, Paris, Raymond, 1825, p. 280-283.
[37] Xavier Abeberry Magescas, « Le Royaume de Westphalie napoléonien, tentative d’instauration d’un « Etat-modèle » », Revue du souvenir napoléonien, n° 450, 2004, p. 39-48.
[38] La Constitution de Bayonne est octroyée formellement par le Roi Joseph, mais il ne fait aucun doute que Napoléon en est l’auteur véritable.
[39] Adresse de l’assemblée de Bayonne à l’empereur Napoléon sur l’acceptation de la Constitution, 7 juillet 1808.
[40] Second Statut constitutionnel du Royaume d’Italie relatif à la Régence, aux grands officiers du Royaume et au serment, 19 mars 1805, art. 19. L’objectif constitutionnel visant à assurer le bonheur du peuple figure également au sein de la Proclamation de la Consulta di Stato précédant la promulgation du Statut constitutionnel (19 mars 1805) : « [La République] fit certainement un grand pas lorsqu’à l’occasion des comices réunis à Lyon […], elle refondit la Constitution et proclama un chef dont les lumières et la puissance l’auraient conduit plus rapidement au bonheur et à la considération auxquels son destin lui permettait de prétendre ».
[41] Statut constitutionnel de la République de Lucca du 23 juin 1805, art. V. En outre, le Décret additionnel à la nouvelle Constitution, du 12 juin, décidant de demander comme chef du gouvernement lucquois Son Altesse Sérénissime le Prince de Piombino est approuvé par le Gonfalonier et les Anciens de la République « considérant que le bonheur de la République lucquoise sera assuré par ce moyen ».
[42] Constitution de Bayonne du 6 juin 1808, art. 6.
[43] Acte de Médiation, 19 février 1803 : « Ayant […] employé tous les moyens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses, nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que celle du bonheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions à prononcer, et sans entendre nuire à l’indépendance de la Suisse, STATUONS ce qui suit ».
[44] Constitution du Royaume de Westphalie du 15 novembre 1811, Préambule.
[45] Georges Burdeau, Traité de science politique, t. IV : « Le statut du pouvoir dans l’Etat », 2e éd., Paris, LGDJ, 1983, p. 132.
[46] Cons. const., 16 juil. 1971, n° 71-44 DC, Liberté d’association.
[47] Cons. const., 06 juil. 2018, n° 2018-717/718, M. Cédric H. et autre [Délit d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger].
[48] Léon Duguit, Traité de droit constitutionnel, t. III, 3e éd., Paris, Boccard, 1930, p. 607
[49] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », RFDA, n° 1, 2015, p. 116.
Il est évident ici que le terme de « norme hypothétique fondamentale », et même celui de « Grundnorm », puisés dans le lexique kelsénien, sont mobilisés pour signifier – ou suggérer – la supériorité du « droit au bonheur » eu égard à la norme constitutionnelle elle-même, et non au sens normativiste des théories de Kelsen. En effet, selon le penseur autrichien, la Grundnorm n’est qu’une « hypothèse logico-transcendantale » lui permettant de fonder la validité de la Constitution et donc d’assurer la cohérence de sa théorie des normes. Elle est, en conséquence, dénuée de toute dimension axiologique. Or, si l’on considère le « droit au bonheur » comme la norma normarum dont résultent toutes les normes de l’ordre juridique, la proposition conduit à la considérer comme une norme de droit naturel.
[50] Délibération du Sénat conservateur du 14 floréal an XII (14 mai 1804).
[51] Constitution de l’an XII, art. 70.
[52] Lettre de Napoléon au Roi Jérôme du 15 novembre 1807.
[53] Jean Carbonnier, « Le Code civil », in Pierre Nora (dir.), Les lieux de mémoire, t. 2, vol 2., Paris, Gallimard, 1986, p.293-315. Selon Jean Carbonnier, du fait de son « aura d’éternité », le Code civil revêt, à tout le moins, une « constitutionnalité […] sociologique ». V. également Yves Gaudemet, « Le code civil, « Constitution civile de la France » », in 1804-2004. Le Code civil, un passé, un présent, un avenir, Paris, Dalloz, 2004, p. 297-308
[54] Décret impérial portant organisation de l’Université, 17 mars 1808. Les choses sont peut-être plus claires encore dans cette lettre adressée aux différents chefs d’Etats pour annoncer son retour au pouvoir durant les Cent-Jours : « Le rétablissement du trône impérial était nécessaire au bonheur des Français ».
[55] Alexandre Viala, « Qu’est-ce qu’une sanction ? Eléments de théorie du droit », Questions constitutionnelles, 2024, https://questions-constitutionnelles.fr/quest-ce-quune-sanction-elements-de-theorie-du-droit/
[56] Ibid.
[57] Faisant écho à une formule célèbre, les dispositions du Sénatus-consulte de l’an XII brillent ici par leur obscurité tant les prérogatives du Sénat y sont ambigües. En effet, le texte de l’an XII semble limiter son action a un avis de non-conformité et réserver la décision d’inconstitutionnalité de la norme législative à l’Empereur : « l’Empereur, après avoir entendu le Conseil d’Etat, ou déclare par un décret son adhésion à la délibération du Sénat, ou fait promulguer la loi » (art. 72). Cependant, l’article 70 de la Constitution précise que l’office du Sénat, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, s’exerce « sans préjudice de l’exécution [de l’article] 21 » de la Constitution de l’an VIII… qui dispose que le Sénat « maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement ».
[58] Décret du Sénat du 3 avril 1814 portant que Napoléon Bonaparte est déchu du trône, et que le droit d’hérédité, établi dans sa famille, est aboli.
[59] Délibération du Sénat conservateur, op. cit.
[60] Thierry Lentz, Napoléon. Dictionnaire historique, Paris, Perrin, 2020, p. 301.
[61] Décret du Sénat du 3 avril, op. cit.