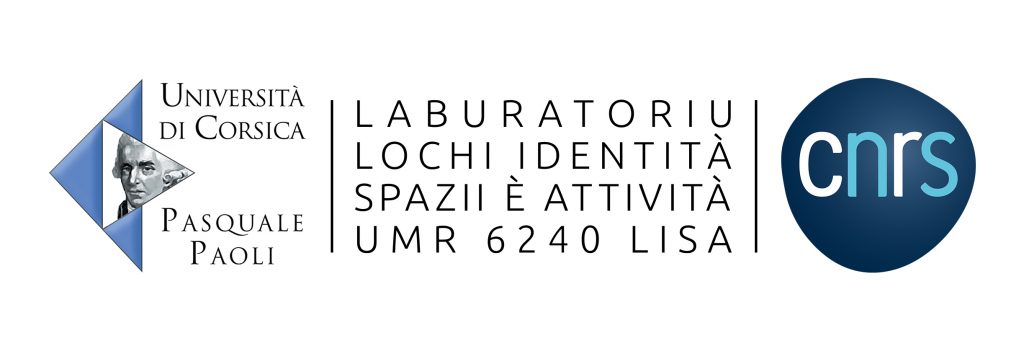L’enseignement doit-il être une affaire d’état ? Réflexions personnelles d’un universitaire Corse
Michel Vergé-Franceschi
Ma réponse est oui. L’enseignement c’est un tout qui repose sur trois piliers : un lieu ; un budget ; un savoir.
L’enseignement, à première vue, c’est tout d’abord un lieu où il faut pouvoir le dispenser. Dans l’Antiquité grecque, c’était sous les portiques du temple d’Apollon, allées couvertes qui laissaient passer la « lumière » d’où le nom de « lycée ». Je vais prendre pour exemple la Première École navale française installée au Havre, par Louis XV, en 1773. Il a fallu avant d’accueillir maîtres et élèves, construire un bâtiment et l’État a dû payer sa construction : l’achat du terrain, les pierres blanches venues et charriées de Basse-Normandie, les ardoises du toit, les poutres de la charpente, les boiseries des parquets, des volets, les huisseries des portes et fenêtres, avec leurs serrures, charnières, poignées de cuivre, les pupitres des élèves, les bureaux ou chaires des professeurs. Louis XV a commandé du verre de Bohême très fin pour éclairer les salles de cours pour que les élèves profitent au mieux de la lumière extérieure grâce à des fenêtres larges et très hautes, faute d’électricité. À Corte, en 1764, Paoli a dû confisquer les biens d’Église pour offrir des salles de cours à ses 25 étudiants (dont le père de Napoléon), contre 33 au Havre. Les bâtiments de Corte étaient donc des bâtiments de fortune qui n’avaient pas été conçus pour cela. Ce n’était pas des salles construites exprès, car cela coûtait très cher et Paoli n’avait que très peu de moyens. Le lieu est la première chose qui nécessite un budget. Celui de l’Éducation nationale est le plus lourd de la République aujourd’hui.
Le lieu qui doit être aménagé coûte en effet de plus en plus cher (salle d’ordinateurs, laboratoires de recherche, bibliothèques universitaires, CDI en collège ou lycée, matériels de projection, appareils, écrans, etc…). Au Havre, Louis XV a tout fourni : des bâtiments neufs, les grandes ardoises noires accrochées au mur (ancêtres des premiers « tableaux noirs »), les premières « éponges », les « bancs fixés au sol » pour les salles de mathématiques (afin d’éviter le bruit), les « chaises pour les salles de dessin » car là, les élèves doivent se lever pour réaliser des cartes et croquis de grands formats, les « livres à laisser dans les salles de classe », dans des pupitres, qui fermaient à clef. Livres à faire « graver aux armes » de l’établissement (ou au nom plus tard du Lycée impérial de Bastia) pour éviter les vols. Louis XV a fourni le tambour pour marquer l’heure des récréations. (Il sera remplacé par la cloche dans les Lycées napoléoniens).
Aux murs il faut ajouter les hommes. Le Roi a fourni la totalité du personnel : le concierge du bâtiment ; le personnel d’entretien qui devait effacer les tableaux chaque soir « avec une éponge mouillée » ; qui devait balayer et aérer les salles de cours et les espaces sportifs (salles d’escrime). Le Roi fournit tout : les fleurets qu’il faut remplacer, les gants, les peaux de mouton pour se protéger, les masques qui recouvrent les visages.
La Marine française a été à l’origine des premiers « emplois du temps » car les matières à étudier, à partir de Richelieu, ont été très nombreuses : astronomie, hydrographie, mathématiques (pour faire le point), étude des courants, des marées, du ciel ; nécessité de connaître la langue de l’adversaire (donc l’anglais, à partir de 1756, et, depuis 1702, l’espagnol). Mais il faut veiller à ce que les professeurs d’anglais ne soient pas des espions à la solde de la Royal Navy. Le Roi engageait donc des enseignants « de nation irlandaise ». L’allemand sera lui préféré plus tard à l’anglais à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr, ou à La Flèche, l’ennemi étant la Prusse, puis l’Allemagne.
Ces « emplois du temps » font débat. Faut-il mettre les mathématiques le matin ? Les élèves ont fait la fête le soir et sont endormis. Faut-il commencer par le sport ? Ils seront fatigués pour apprendre les mathématiques. Pire. Les parents d’élèves ont longtemps eu besoin de leurs fils pour les travaux des champs, juillet-août, pour les moissons ; septembre, pour les vendanges. Ces 3 mois estivaux sont à l’origine des 3 mois de vacances scolaires. Mais les autorités disaient : l’été (c’est vrai) ce sont « les meilleurs mois » pour envoyer étudier les enfants, parfois assez loin de la maison familiale. L’hiver, il y a la pluie, le froid, l’humidité, des journées courtes. Les enfants risquaient de prendre froid. Au XIXe siècle, la tuberculose faisait des ravages (d’où l’affiche interdisant de « cracher par terre » qui passe pour injurieuse aujourd’hui). Donc, les médecins préfèreraient des cours l’été, encore aujourd’hui (ils ont raison, mais personne ne les suit à cause des vacances et de notre « société de loisirs »). Dans la Marine, les autorités de Brest se plaignaient des pluies et du crachin qui exposaient les enfants « dehors, à 7h du matin, l’hiver » pour écouter la messe chaque matin, avant les cours. A Toulon, les autorités se plaignaient de perdre « les 2 plus beaux mois de l’année » propices aux exercices de navigation (juillet-août). Mais les élèves voulaient rentrer chez eux ! À partir de 1775, les premiers poêles sont apparus dans les salles de classe, remplaçant l’hiver les cheminées. Ces poêles existaient toujours en 1930 et les élèves à tour de rôle étaient chargés de les allumer. Le Roi, au Havre, payait le bois et le charbon, comme à Brest, Toulon, Rochefort. Aujourd’hui, il faut payer l’électricité, le chauffage au gaz, au fuel, l’entretien des chaudières, les ramonages, etc…. Instruire la jeunesse est donc un budget énorme pour l’État même si les enseignants ont des « traitements » et non des « salaires » qui ont considérablement baissé aujourd’hui (le CAPES en 1974 rapportait dès la 1ère année 2 fois et ½ le SMIG. On en est bien loin 50 ans plus tard).
Instruire la jeunesse s’est aussi imposé comme le rythme actuel de la vie quotidienne de toute société civilisée. Il faut accompagner tous les matins, à heure fixe, les enfants, à l’école primaire, au collège, au lycée. D’où le dépeuplement des campagnes qui n’ont pas d’infrastructures scolaires et la concentration des habitants dans les villes. L’enseignement a imposé cette extraordinaire mutation géographique. Vivre à Rogliano avec 3 enfants lycéens n’est pas simple.
Page 1
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, notre modèle scolaire était inexistant en dehors de quelques maîtres d’école, religieux (les moines Servites de Marie de Morsiglia) ou laïcs (un Silvagnoli à Rogliano en 1631). Mais le système scolaire s’est mis peu à peu en place : les bancs de bois (que j’ai connus au Lycée de Toulon construit par Napoléon III) ont remplacé la paille médiévale jetée sur le sol. L’université de Salamanque, où je me rends assez souvent, a conservé ses bancs et longs bureaux d’amphi, depuis Charles Quint, avec les portraits de Ferdinand d’Aragon et d’Isabelle la Catholique au mur… Mais c’est rare. Les amphis de la Sorbonne aussi, restent inchangés depuis le XIXe siècle avec leurs moulures, peintures et dorures.
L’enseignement s’est structuré avec le temps. Le niveau scolaire des élèves (tous mélangés aux quatre coins de la salle de cours au Moyen âge) a engendré des concepts nouveaux : de « niveau », donc de « classes » successives, en fonction du niveau de connaissances que chacun devait acquérir et qu’il fallait aussi contrôler.
Ce contrôle est apparu aux beaux jours quand des inspecteurs pouvaient se déplacer fin mai/fin juin sur des routes moins embourbées et ravinées. C’est leur arrivée, annuelle, à la fin du printemps, qui a engendré le concept « d’année scolaire » qui commence à l’automne (début octobre autrefois, début septembre aujourd’hui, les vendanges étant faites par des travailleurs, souvent étrangers) ; ainsi, un inspecteur (arrivé de Bretagne) a fait passer à Bonaparte son concours d’admission à l’École de Brienne (située en Champagne), au lieu de le laisser au collège d’Autun (établi en Bourgogne). L’Armée, la Marine sont à l’origine de ces enseignements étatiques car les connaissances sont communes : la mer, les courants, les vents, l’artillerie.
Les cours se sont donc spécialisés, d’où la création d’Académies militaires (Richelieu sortait de l’Académie de Pluvinel ; Paoli de l’Académie militaire de Naples ; Bonaparte de l’École militaire de Brienne, se distinguant notamment en mathématiques puis en artillerie, celle-ci se substituant à la cavalerie).
Ces inspecteurs annuels étaient des laïcs (l’excellent mathématicien Etienne Bezout par exemple, pour la Marine, dont j’ai encore un exemplaire de son Traité de 1764, hérité de mes ancêtres capitaines marins de Rogliano ; traité utilisé jusqu’en 1864, y compris à l’École d’Hydrographie de Bastia).
Ces laïcs ont, peu à peu, remplacé les clercs qui avaient, depuis le Moyen âge, le monopole de l’enseignement car 90% des gens ne savaient pas écrire. Faire ce geste simple, rapprocher le bout de l’index du bout du pouce, pour tenir une plume d’oie, et la tremper dans un encrier, n’est pas un geste « normal ». Tous les outils, au sein d’une société rurale à 90% et paysanne à 85%, se tiennent avec les deux poings fermés, l’ensemble des doigts repliés sur la paume de la main (râteau, pelle, pioche). Résultat : les premières signatures sur les registres paroissiaux sont souvent deux initiales tremblantes et hautes de plusieurs centimètres ; à la grande fureur du curé car le papier était rare. (Paoli était désespéré de mettre plusieurs jours à trouver une ½ feuille de papier à Corte en 1755-1769 par exemple).
Les clercs ont conservé longtemps ce monopole. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, les Jésuites avaient d’excellents collèges et leur plus ancien établissement (le collège de Clermont créé à Paris en 1562) est devenu le collège Louis le Grand (grâce aux victoires de Louis XIV) à l’issue de la guerre de Hollande (1678), la ville de Paris ayant offert le surnom de « Grand » au roi victorieux. C’est notre actuel Lycée Louis-le-Grand (Lycée depuis Napoléon 1er, fondateur de ceux-ci). Les Jésuites, expulsés de France en 1762-1764, se sont réfugiés en Corse, de 1764 à 1769, puis ont continué souvent à enseigner, mais sans être en « Compagnie » (de Jésus), d’où la nécessité de se loger et de manger à leurs frais, ce qui leur était devenu impossible. L’autre grand ordre religieux, destiné à l’enseignement, était celui des Oratoriens qui ont élevé Montesquieu. Ils étaient proches des jansénistes. À Marseille, les piliers du jansénisme phocéen étaient mes propres ancêtres Porrata (de Morsiglia), plus ouverts que les Jésuites et fondateurs, en 1726, de l’actuelle Académie de Marseille qui existe toujours, créée dans l’actuelle cimetière Saint-Pierre de Marseille, ancienne propriété des Porrata de Morsiglia.
L’enseignement était fort rare, en dehors de quelques maîtres d’école dans les campagnes, sachant écrire, lire et compter, et surtout chanter la messe. Devant être « de bonnes mœurs », ils étaient recrutés par les curés et les élites municipales, et souvent rémunérés par les parents d’élèves et les communautés villageoises. Plusieurs de mes ancêtres de Morsiglia et de Centuri avaient un frère, Père servite, au couvent de l’Annunziata, et maître d’école en même temps. D’autres ancêtres de Rogliano ont financé les maîtres d’école du village (un Silvagnoli, arrivé en 1631 notamment). Les élites, enrichies aux Amériques (les Bettolacce, autres ancêtres), ont financé les premières écoles. La « diaspora » était (alors) plus utile qu’elle n’apparaît aujourd’hui…
Riches, les élites confiaient aussi leurs enfants (garçons essentiellement) à des précepteurs, souvent des religieux ou des vieilles demoiselles terribles qui frappaient de coups de poing Chateaubriand enfant et qu’il décrit dans les Mémoires d’Outre-Tombe.
La quasi-totalité des populations, masculines et féminines, ignoraient notre temps actuel qui est celui de l’école : primaire, secondaire universitaire, vraiment apparu au XIXe siècle seulement. Ce Temps de l’école, votre Temps de l’école, a moins de 200 ans.
Aujourd’hui, deux parents ayant deux enfants, la moitié de la société environ ne fait rien d’autre que d’étudier pendant 20, 25, 30 ans souvent (c’est le cas des étudiants en médecine, en chirurgie, des futurs professeurs, juristes, pharmaciens, avocats, notaires). Il faut se rendre compte de l’énorme poids financier que représente cette jeunesse qui ne produit rien comme autrefois alors qu’elle est au sommet de sa force : Jean Bart de Dunkerque et Robert Surcouf de Saint-Malo embarquaient leurs fils à 10 ans pour Bart, à 14 pour Surcouf. À 20 ans, Duguay-Trouin totalisait 300 prises de navires marchands à l’ennemi. Au siège de Toulon, Bonaparte avait 24 ans.
Page 2
Les filles, enfants et pré-adolescentes, nourrissaient les volailles et récoltaient les pissenlits pour les lapins. Elles aidaient leurs mères qui accouchaient de 12, 14, 18 enfants. Mon arrière-grand-mère Devoti à Bastia, que j’ai connue (née en 1868), était la 19e de 20 enfants. Avec ses sœurs, elle fut élevée au couvent Saint-Joseph. C’était un privilège. Les adolescents de 12 ans, moins favorisés, travaillaient aux champs, dans les vignes, à l’étable. Si le père était mort, le Corse de 14 ans votait.
La création du Temps de l’école est sans doute l’innovation la plus importante de nos sociétés, mais depuis mes arrière-grands-pères seulement, élèves du Lycée Marbeuf, comme le général Graziani, chef d’état-major de l’Armée française en 1914, ou mon arrière-grand-oncle Camille Piccioni, diplomate, qui a fait l’annonce de la mobilisation générale.
Pour enseigner, le lieu est important. Vous l’avez compris. L’argent est indispensable car il est le nerf de la guerre et l’enseignement est un combat face à l’ignorance, à l’intolérance, à l’inculture, aux extrémismes. La culture est essentielle. Pour pouvoir la transmettre, ce qui est le devoir et la mission des enseignants, il faut d’abord l’acquérir. Jusqu’à Diderot, l’Encyclopédisme était encore aux limites du possible. C’est aujourd’hui totalement utopique. À la NASA, je ne pourrais que balayer les couloirs et dans un bloc opératoire j’hésiterais à toucher un simple commutateur.
La culture c’est d’abord une langue maternelle qui, avec les années, se double (chez les élites uniquement) d’une langue parlée par le plus grand nombre. Longtemps, ce fut le latin au point que Charles Quint, élevé à Gand (Pays-Bas) sa ville natale, ne pouvait converser qu’en latin avec ses ministres espagnols à Valladolid (Madrid n’existant pas). Il en fut de même pour Georges 1er d’Angleterre, souverain allemand de la maison de Hanovre, héritier protestant du trône de Londres et de celui d’Édinbourg, au détriment des Stuart catholiques. Ne voyageant pas, sortant peu de chez lui, n’accédant à aucune des responsabilités de son temps, le « peuple » ou « menu peuple » se contentait d’échanger avec ses compatriotes dans la langue acquise, localement, au sortir de son berceau. « Je dois ma naissance au hasard de mon berceau » disait le Breton Chateaubriand.
Dans la péninsule Italienne, quoiqu’elle fût composée d’une dizaine d’États, la langue ne fut jamais un vrai problème car la République de Venise et celle de Gênes, le Grand-duché de Toscane des Médicis, le royaume bourbonien de Naples, la Lombardie (Milan), la principauté du Vatican, les duchés de Parme et de Modène avaient tous une langue plus ou moins commune, héritée du latin, même si le toscan (parlé en Corse) n’est pas le génois (parlé à Bonifacio). Il en était de même dans les États allemands, en Prusse, en Bavière, dans le Schleswig-Holstein, en Hesse, au Wurtemberg avec l’allemand. Ceci a sans doute très largement contribué à l’immense prestige des grandes universités de Bologne, Padoue, La Sapience, Heidelberg, car beaucoup d’étudiants pouvaient s’y retrouver bien qu’éloignés, à leur naissance, de ces illustres pôles universitaires. Il en était de même pour Salamanque qui pouvait recevoir des étudiants venus aussi bien du royaume d’Aragon que de ceux de Castille et du Léon, voire des royaumes de Grenade ou de Navarre, Coimbra trustant ceux du Portugal.
Le particularisme géographique et historique de la France, qui fait sa richesse, fait en revanche qu’un Provençal ne parlait ni le breton, ni l’auvergnat, ni le basque ou l’alsacien, pas plus qu’un Ecossais catholique ne parlait la langue de son ennemi héréditaire, l’Anglais protestant, quoique réuni à celui-ci en vertu de l’Acte d’union de 1707.
Avant de construire des établissements scolaires fort coûteux, avant d’établir des programmes de cours, des contenus, l’État se doit d’abord de former des enseignants et de leur faire passer des concours au plus haut niveau, c’est le cas aujourd’hui (le CAPES, l’agrégation), ou de leur délivrer des diplômes (le baccalauréat, premier diplôme universitaire, des licences, des masters et des doctorats). Beaucoup aujourd’hui confondent le diplôme qui sanctionne un savoir et un concours de recrutement qui ouvre l’accès à un emploi, d’où ma position pendant 45 ans de ne jamais inscrire en thèse un candidat qui n’a pas d’abord un métier alimentaire, sinon, on risque fort de créer des docteurs-chômeurs. J’en ai malheureusement connu des dizaines.
Pour construire un enseignement adapté au maximum d’élèves puis d’étudiants, il a d’abord fallu construire un pays. Certes, il n’y avait pas d’Italie avant Cavour jusque dans les années 1850, mais les habitants avaient cette langue commune de Naples à Venise ou à Milan. Certes, il n’y avait pas d’Allemagne avant que l’existence de celle-ci ne soit proclamée dans la galerie des glaces du château de Versailles, à la chute de Napoléon III en 1870, mais, là aussi, les habitants avaient une langue plus ou moins commune comprise par tous, mais je laisse aux linguistes le soin de vérifier l’authenticité de ce propos, n’ayant aucune compétence dans ce domaine.
En France, nous sommes le seul pays européen à avoir une façade du Levant (avec la Provence française depuis 1482), et une façade du Ponant (avec la Bretagne française depuis 1532), par héritage de sang dans les deux cas, et non par annexion née d’un prétendu jacobinisme. Louis XI a hérité de la Provence de son cousin germain Charles III, dernier comte de Provence. Le futur Henri II a hérité quant à lui de la Bretagne de sa grand-mère Anne, dernière duchesse de Bretagne.
Face à de double héritage, François 1er, le plus grand des Valois, a promulgué, en 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui substitue le français au latin dans trois domaines : l’administration, la justice et l’enseignement. Ce dernier se trouve très tôt (dès 1482/1532) dans la nécessité d’offrir une langue qui soit commune à l’ensemble d’un territoire qui a eu pour objectif non l’annexion volontiers dénoncée mais la protection régulièrement oubliée.
Menacée par l’ensemble de ses voisins (comme la Corse d’ailleurs), la dynastie capétienne a voulu parvenir à l’obtention de frontières dites « naturelles » : pour se protéger des Anglais, il fallut les chasser d’Aquitaine (1346) en leur arrachant Bordeaux et La Rochelle ; puis les chasser de Calais (1558) ; puis leur verser 3 500 000 livres pour leur acheter Dunkerque (1662) par acte d’achat. Pour se protéger des Espagnols, il fallut les rejeter de l’autre côté des Pyrénées (1659, prise du Roussillon et de Perpignan), mais aussi des Flandres (1659, prise d’Arras et de l’Artois), et de la Franche-Comté (prise de Besançon en 1678). Pour résister au Saint-Empire romain germanique, il fallut atteindre le Rhin (1648, prise de l’Alsace, 1683, prise de Strasbourg). Louis XV héritant du duché de Lorraine (1766), les députés corses aux États généraux ont demandé le rattachement de la Corse à « l’imperium » français (30 novembre 1789), qui les accueillait dans ses établissements scolaires de peur de retourner sous la domination de Gênes qui n’avait même pas doté la Corse d’une université en quatre siècles, ce que Paoli fit en neuf ans. Le duché de Savoie et le comté de Nice demandèrent alors à devenir français par plébiscite (1860), et la France a achevé son territoire sous Napoléon III (1860), environ dix ans après l’Italie de Cavour (1850), et dix ans avant l’Allemagne de Bismarck (1870).
Page 3
La IIIe République (1870-1940) a alors pu imposer les articles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts (jamais abolis à ma connaissance) et grâce à une langue commune, et à des programmes identiques, le peuple souverain (qu’il soit basque, breton, corse ou auvergnat) a pu connaître un enseignement quasi homogène sur l’ensemble du territoire national, permettant au « peuple » (au sens de 1789 c’est-à-dire sans aucun adjectif autre que « souverain ») d’accéder à toutes les Grandes Écoles et aux établissements scolaires et universitaires de la République, ce qui n’était pas le cas pour beaucoup de contemporains. Les étudiants russes étudiaient par exemple volontiers la médecine à l’université de Strasbourg, grâce aux cours professés, en allemand, jusqu’au XVIIIe siècle, alors qu’à Paris ils l’étaient uniquement en français. Quand la Russie est devenue Empire, le russe est devenu, en 1887, la seule langue officielle de l’enseignement, non seulement en Russie, mais aussi dans les provinces baltes par exemple. L’université de Dorpat (en Estonie) s’y est vivement opposée. Continuant à professer en allemand, elle fut arbitrairement fermée en 1897. La France n’a jamais connu pareils excès. Ceux-ci n’ont d’ailleurs pas toujours réussi : le projet de russifier l’enseignement en Pologne a par exemple été abandonné, car sur le problème de la langue, s’est greffé celui de l’orthodoxie russe qui ne pouvait être imposée à la Pologne farouchement catholique. C’est du reste l’identité de religion qui a mis fin au royaume anglo-corse, après deux années éphémères (1794-1796) et bénéfiques (car il n’y a pas eu d’échafaud en Corse grâce à Paoli), mais qui ne pouvait perdurer, les femmes Corses, farouchement catholiques, ne pouvant accepter une armée anglaise et protestante sur son sol et préférant rappeler les prêtres et évêques réfractaires, en chassant les religieux jureurs.
La communauté de langue et de programmes, de rythmes scolaires et de contenus d’enseignement a abouti à notre Éducation nationale, avec des professeurs recrutés par concours nationaux (j’ai été membre puis président de jury du CAPES d’Histoire et Géographie pendant 8 ans) de très haut niveau, mais fort mal rémunérés par l’Etat, puisqu’un professeur certifié en 1974 gagnait à 23 ans 2 fois ½ le SMIG (2500 francs pour un SMIG à 1000 francs) ce qui n’est plus du tout le cas.
À noter que tout enseignant, à grade et à échelon égal, reçoit aujourd’hui de l’État le même traitement, alors qu’un professeur de mathématiques, à l’École royale de Marine du Havre, recevait de Louis XV des appointements égaux à la solde d’un capitaine de vaisseau (2400 livres) ; un professeur d’anglais 1000 livres (soit la solde d’un lieutenant de vaisseau) et un professeur de dessin 6000 livres (soit la solde d’un enseigne de vaisseau). Si ceci peut ouvrir des pistes « régionales » qui, à mon humble avis, ne seront pas du goût de tout le monde (ce que je comprends !), sur un plan plus sérieux je tiens à affirmer mon attachement à l’universalisme de l’enseignement dispensé dans nos universités dont le nom seul contient le mot « univers ».
Je suis heureux que Sampiero Corso ait été élevé à Florence, comme « enfant d’honneur du cardinal Hippolyte de Médicis ». Que ses fils Alphonse et Jean-Baptiste d’Ornano aient été élevés au Louvre, comme « enfants d’honneur » des futurs Charles IX et Henri III. Que Charles Bonaparte soit allé consulter les médecins à Versailles puis, en vain malheureusement, les praticiens de la Faculté de médecine de Montpellier.
Je tiens à affirmer mon attachement à l’égalité des chances offerte à tout jeune citoyen de la République, quel que soit son lieu de naissance, ses origines familiales, sa couleur ou sa religion et bien évidemment son sexe : Mary Stuart, Christine de Suède (1626-1692), Catherine II de Russie (1729-1796) ont notamment eu des éducations particulièrement soignées, aussi bien dans les matières littéraires que scientifiques, sans oublier l’escrime, la danse et des cours d’équitation.
Les enseignants, en argent, on reçoit il est vrai peu de reconnaissance. Mais je reçois des mots fort gentils de mes anciens élèves de Normandie de 1974, de Savoie de 1986, de Touraine de 1999 et de Paris, et c’est cela la plus belle des récompenses depuis 50 ans.
BIBLIOGRAPHIE
– « Le jeune marin (1626-1792), de l’enfant soldat à l’enfant surprotégé », Lorsque l’enfant grandit. Entre dépendance et autonomie, PUPS, Paris, 2003, p. 585-602.
– « Gardes de la marine et officiers de vaisseau à Toulon au XVIIIe siècle », Cahiers de la Méditerranée moderne et contemporaine, Nice, 1975, p. 37-67.
– « Un enseignement éclairé au XVIIIe siècle : l’enseignement maritime dispensé aux gardes de la marine (1686-1786) », Revue historique, 1986, n° 559, p. 29-55.
– « L’École royale de marine du Havre au XVIIIe siècle », Études normandes, 1986, n° 2, p. 53-67.
– « L’École royale de la Marine du Havre au XVIIIe siècle », p. 375-381, in Actes du colloque Révolution et mouvements révolutionnaires en Normandie, XXIVe congrès des Sociétés historiques et archéologiques de Normandie, Cherbourg, 1989.
– « L’enseignement dans la marine du Roi aux XVIIe et XVIIIe siècles : l’enseignement dispensé aux gardes de la marine (1626-1786) », Mélanges offerts à B. Grosperrin, Université de Savoie, 1994, p. 119-135.
– « Actualité de l’Histoire maritime », Planète océane, L’essentiel de la Mer, Choiseul, 2006, p. 495-503, avant-propos du chef d’État-major.
Page 4
D'autres articles

L’enseignement doit-il être une affaire d’état ? Réflexions personnelles d’un universitaire Corse
Ma réponse est oui. L’enseignement c’est un tout qui repose sur trois piliers : un lieu ; un budget ; un savoir. L’enseignement, à première vue, c’est tout d’abord un lieu où il faut pouvoir le dispenser. Dans l’Antiquité grecque, c’était sous les portiques du temple d’Apollon, allées couvertes qui laissaient passer la « lumière » d’où le nom de « lycée ». Je…

Annexe, Extraits des pages 141 à 151 du Testament politique d’Alberoni
« L’aveugle prévention des Anglois, ne laisse aucun espoir de leur retour vers leur Souverain naturel. C’est à lui de se faire, par sa valeur & sa conduite, le rang qu’ils lui refusent, & de se bâtir à leurs dépens un trône, qui lui tienne lieu de celui où ils ne veulent pas le faire monter.
La postérité ne pardonnera point au Prince Edouard, d’avoir…

Théodore, l’Angleterre et le projet d’Alberoni pour la Corse
Au cours du XVIIIe siècle, la Corse a fait l’objet de bien des spéculations de la part des États européens. Les nationaux, dans leur combat pour venir à bout de l’occupant génois, ont tenté en permanence de s’appuyer sur ces ambitions, afin de trouver des alliés de circonstance : non sans de nombreuses désillusions. De ce point de vue, l’épisode qui…