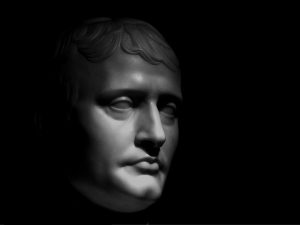Page 1
[1] En italiques dans le texte.
Chef corse du XVIe siècle. Il est l’une des principales figures historiques de l’île.
[2] Mémoires de Napoléon, écrits...
Mémoires de Napoléon, écrits sous sa dictée à Sainte-Hélène, par un de ses valets de chambre, Paris, Philippe Librairie, 1829, page 2, disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6151195z/f7.item.texteImage
[3] Napoléon en débat, 1840 : La mémoire...
Napoléon en débat, 1840 : La mémoire de Napoléon Ier en en discussion dans l’hémicycle, publication de l’Assemblée nationale, disponible sur le site https://www2.assemblee-nationale.fr/15/evenements/2021/napoleon-en-debat
I. L’autorité du chef imposée en amont
Page 2
[4] À propos de la Constitution de l’an VIII...
À propos de la Constitution de l’an VIII, Jacques Godechot écrit qu’elle « laissait, en fait, beaucoup de latitude au Pouvoir exécutif, il n’allait pas manquer d’en user pour instaurer en France une véritable dictature militaire », Les constitutions de la France depuis 1789 (présentation par), Paris, GF Flammarion, 1979, p. 150.
[5] Georges Lescuyer emploie les deux...
Georges Lescuyer emploie les deux termes, « absolutisme éclairé » et « despotisme éclairé », Histoire des idées politiques, Dalloz, 14ème édition, 2001, p. 417.
[6] C’est ainsi que Georges...
C’est ainsi que Georges Lescuyer intitule son chapitre sur l’ère napoléonienne, Ibid.
[7] Marcel Morabito, Histoire constitutionnelle...
Marcel Morabito, Histoire constitutionnelle de la France (1789-1958), Paris, Montchrestien, collection Domat droit public, 8ème édition, 2004, p. 153.
[8] Ibid., p. 137 et Jean Tulard...
Ibid., p. 137 et Jean Tulard, « L’Empire entre monarchie et dictature », Revue du Souvenir Napoléonien, n°400, 1995, p. 21-25.
[9] Elisabeth Zoller et Wanda...
Elisabeth Zoller et Wanda Mastor, Droit constitutionnel, collection Droit fondamental, Paris, PUF, 2021, p. 483.
[10] Voir, dans ce sens, Alain Rouquier...
Voir, dans ce sens, Alain Rouquier, « L’hypothèse « bonapartiste » et l’émergence des systèmes politiques semi-compétitifs », Revue française de science politique, 1975, n°25-6, pp. 1077-1111.
[11] Louis-Napoléon Bonaparte, Des...
Louis-Napoléon Bonaparte, Des idées napoléoniennes, Paris, Paulin libraire éditeur, 1839, p. 39, disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5577365p/f54.item
[12] Nous nous permettons de renvoyer...
Nous nous permettons de renvoyer à notre commentaire de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment à son introduction, Paris, Dalloz, collection À savoir, 2021, 144 pages.
[13] Archives parlementaires de 1787 à 1860...
Archives parlementaires de 1787 à 1860, Première série (1789-1799), Tome VIII, Assemblée nationale Constituante, du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, sous la direction de M. J. Mavidal et de M. E. Laurent et E. Clavel, Paris, Librairie administrative de Paul Dupont, 1875, p. 138.
[14] Mémoires de Napoléon, écrits...
Mémoires de Napoléon, écrits sous sa dictée à Sainte-Hélène, op. cit., p. 8.
[15] Ibid., p. 13.
Napoléon en débat, 1840 : La mémoire de Napoléon Ier en en discussion dans l’hémicycle, publication de l’Assemblée nationale, disponible sur le site https://www2.assemblee-nationale.fr/15/evenements/2021/napoleon-en-debat
[16] Ibid., p. 19.
Napoléon en débat, 1840 : La mémoire de Napoléon Ier en en discussion dans l’hémicycle, publication de l’Assemblée nationale, disponible sur le site https://www2.assemblee-nationale.fr/15/evenements/2021/napoleon-en-debat
A. « L’impérieuse nécessité » du coup d’État
B. Du renforcement de l’autorité à la personnalisation du pouvoir
Page 3
[17] Emmanuel de Las Cases, Mémorial...
Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, tome premier, Paris, Ernest Bourdin éditeur, 1842, p. 774. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k411228n.texteImage
[18] Le fac-similé de ladite proclamation est...
Le fac-similé de ladite proclamation est disponible sur le site des musées de Paris ou de la Fondation Napoléon : https://www.napoleon.org/histoire-des-2-empires/articles/document-proclamation-du-19-brumaire-de-bonaparte/
[19] Antoine-Jacques-Claude-Joseph Boulay...
Antoine-Jacques-Claude-Joseph Boulay de la Meurthe, Théorie constitutionnelle de Sieyès ; Constitution de l’an VIII : extraits des mémoires inédits, Paris, Paul Renouard éditeur, 1836, p. 3. Disponible sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k730453/f6.item.texteImage
[20] Mémoires de Napoléon, écrits...
Mémoires de Napoléon, écrits sous sa dictée à Sainte-Hélène, op. cit., p. 38.
Page 4
[21] Wanda Mastor, Déclaration des droits de...
Wanda Mastor, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, op. cit., pp. 100-106.
[22] Mémoires de Napoléon, écrits sous...
Mémoires de Napoléon, écrits sous sa dictée à Sainte-Hélène, op. cit., p. 56.
[23] Emmanuel de Las Cases, Mémorial...
Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, op. cit., p. 363.
[24] Voir Napoléon Bonaparte...
Voir Napoléon Bonaparte, Correspondance générale publiée par la Fondation Napoléon, Tome XV : Les chutes, 1814-1821. Supplément 1788-1813, Paris, Fayard, 2018, 1488 pages.
[25] Correspondance de Napoléon Ier...
Correspondance de Napoléon Ier publiée par ordre de l’Empereur Napoléon III, t. XXVIII, n° 21682.
[26] Les constitutions de la France depuis...
Les constitutions de la France depuis 1789, op. cit.
II. La légitimation populaire recherchée en aval
A. L’approbation plébiscitaire
B. L’assentiment populaire
Page 5
[27] Marcel Morabito, Histoire...
Marcel Morabito, Histoire constitutionnelle, op. cit., p. 149. Voir aussi Claude Langlois, « Le plébiscite de l’an VIII, ou le coup d’État du 18 pluviôse an VIII », Annales historiques de la Révolution française, n°207, 1972. pp. 43-65.
[28] Mémoires de Napoléon, écrits sous...
Mémoires de Napoléon, écrits sous sa dictée à Sainte-Hélène, op. cit., p. 150.
[29] Emmanuel de Las Cases, Mémorial...
Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, op. cit., p. 364.
[30] Emmanuel de Las Cases, Mémorial...
Emmanuel de Las Cases, Mémorial de Sainte-Hélène, op. cit., p. 364-365.