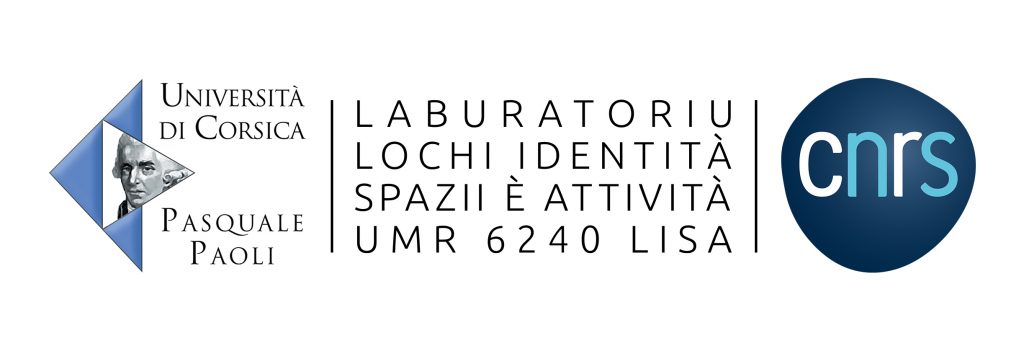De la conquête à la pacification
En 1830, la conquête du territoire algérien – et sans revenir ici, ni sur les motifs politiques de l’opération militaire ni sur les opportunités pour l’Etat français de s’engager dans cette entreprise – s’accompagne de pratiques de conquête des populations. On va retrouver dans le discours de l’époque une inversion sémantique inhérente à l’entreprise coloniale à partir de laquelle conquérir par la force ne serait pas, pour le colon, faire la guerre, mais au contraire « pacifier ». Le pouvoir colonial dissout ainsi le rapport de force pourtant irréductible que constitue le fait de conquête dans un discours de la pacification, c’est à dire d’une action par laquelle cesserait l’état de violence endémique propre à des populations « barbares » ou « non-civilisées ». La colonisation ne serait donc pas un acte de guerre, mais un acte d’établissement de la paix. Or, cette dissolution de la violence contenue dans le principe de pacification va se reconduire dans toutes les étapes de la colonisation et bien au-delà de l’acte de conquête lui-même.
Tout l’enjeu des premières années de conquête consiste donc pour les autorités coloniales à « pacifier » les territoires conquis à partir d’une administration des populations confiée au pouvoir militaire, et qui s’inscrit dans un projet général de « civilisation ». Le premier dispositif que j’évoquerai pour parler de cette conquête des populations est celui des Bureaux arabes. À l’initiative du Général Bugeaud – rendu célèbre par sa doctrine de la tabula rasa –, ces services vont constituer à partir de 1844 la première forme d’administration des habitants des territoires nouvellement « pacifiés ». Il s’agit en outre de poursuivre les désastres matériels et humains de la conquête militaire par la déstructuration de l’ensemble de l’organisation sociale algérienne visant à fonder une société nouvelle à l’image d’une France « moderne » et « civilisée ».
Ces services s’articulent autour d’une figure personnifiée et totalisante du pouvoir colonial : l’officier-administrateur, qui réunit entre ses mains les pouvoirs civil, policier, judiciaire, militaire et administratif couplés à l’exercice de missions d’instruction ou d’assistances sociale et sanitaire. C’est ainsi que les dépeint le juriste Victor Fouché en 1848 :
« Composés d’hommes versés dans la langue arabe, connaissant les mœurs et les usages des populations placées sous leur direction, il permet de tenir au courant des besoins et des menées de ces populations, de les guider, de les conseiller, de leur donner une direction et répandre parmi elles tous les sentiments que nous avons tant d’intérêts à propager. »[3]
Cette citation renvoie à deux dimensions fondamentales du geste de conquête : les officiers des Bureaux arabes produisent à la fois des renseignements stratégiques et policiers destinés à être communiqués à une administration centralisée et un savoir situé, d’ordre ethnographique, sur les populations placées sous leur autorité. Ces régimes de production de savoirs gouvernementaux, dont rendent notamment compte les productions monographiques des officiers, doivent être replacées dans leur historicité. En 1848, si la sociologie ne connaît pas d’existence institutionnelle, on voit néanmoins s’amorcer au cours du XIXe siècle une production d’un ensemble d’outils analytiques qui vont accompagner tout le processus d’institutionnalisation des sciences sociales. Un certain nombre de ces officiers étaient saint-simoniens, formés pour la plupart à l’Ecole polytechnique où Saint-Simon finit sa carrière[4]. Il ne faut donc pas minimiser la part d’utopie sociale dans les imaginaires qui soutenaient l’action de ces hommes portés par le mirage d’une régénération des possibles de l’autre côté de la Méditerranée.
L’action des Bureaux arabes rassemble un répertoire de pratiques gouvernementales articulées autour du discours de « l’action civilisatrice ». Ils déploient un ensemble de technologies qui participent à l’édification d’un dispositif civilisationnel. Par mon travail d’archives, alors que je partais plutôt du postulat que « l’œuvre civilisatrice » constituait un discours de justification de l’action coloniale, j’ai pu me rendre compte qu’au-delà de sa dimension discursive, elle avait conduit à la production d’une toute une gouvernementalité proprement coloniale. Cela doit, me semble-t-il, être souligné, car on pourrait sinon être tenté de penser la justification de l’action coloniale par le thème civilisateur, comme une forme de relégitimation morale de la conquête. Or, la mission de civilisation, dans la manière dont elle est conçue et théorisée et depuis l’universalisme qu’elle transporte – puisque c’est aussi la question de la légitimité de la colonisation au travers de la pensée des Lumières qui se joue ici –, porte en elle les germes de la domination coloniale. L’action civilisatrice constitue une matrice épistémologique fondamentale en ce qu’elle fonctionne avant tout sur le refus de reconnaître aux populations dominées la capacité de se connaître elles-mêmes. Il y a, contenu dans l’idée d’« œuvre civilisatrice », le postulat que le savoir moderne et l’apparition des sciences de l’homme, donneraient au colonisateur la légitimité politique de connaître « l’indigène » mieux que lui-même n’en serait capable, et donc la légitimité de pouvoir déterminer verticalement ce qui serait « bon » pour lui. On voit donc bien comment cette dimension épistémologique structure la domination coloniale jusque dans ses dispositifs les plus concrets.
L’encadrement des populations par les Bureaux arabes renvoie exactement à ce que Michel Foucault décrivait dans son analyse relationnelle du savoir et du pouvoir. Cela illustre précisément la manière dont certains régimes de savoir vont déterminer les pratiques de pouvoir exercées par ces officiers coloniaux et comment, dans le même temps, se joue une sorte de circularité entre des régimes de savoir qui déterminent des pratiques de pouvoir, dont l’exercice fait émerger des nouveaux régimes de savoir. On ne peut donc pas réduire l’action de ces officiers à un cadre juridico-légal. Ce qui se joue, c’est une réelle expérimentation politique, où la concentration des pouvoirs entre les mains d’un officier qui est à la fois juge, policier, militaire, assistant social et instituteur, oblige à une adaptation des formes de gouvernement qui vont se réajuster au fur à mesure de leur exercice dans une sorte de pragmatique coloniale du pouvoir.
Il est important de relever ici le phénomène de personnification qui se joue dans ce dispositif. Si l’on regarde en effet l’organisation du pouvoir militaire à travers les Bureaux arabes, par ces officiers sociaux tout-puissants, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un rapport très personnifié. Il y a une forme d’incarnation du pouvoir qui est très loin de l’image d’un pouvoir et d’une administration modernes qui se définirait par une sorte d’anonymat. Cette personnification vient ainsi agir sur deux formes d’action relatives au geste de conquête. D’une part, il s’agit de ce qu’on a pu qualifier de doctrines du « contact » et, d’une autre part, de doctrines de la « confiance ». Le contact renvoie à la manière dont l’action administrative va permettre de produire des situations de face-à-face entre l’incarnation personnifiée du pouvoir colonial et les populations colonisées et la confiance, qui renvoie à tout un imaginaire de la dévotion, à l’image d’un officier qui se donnerait corps et âme à sa mission, avec toute la force de son abnégation en permettant ainsi de construire un lien affectif de dépendance entre l’officier et la population qu’il administre.
[3] V. Foucher, Les Bureaux arabes en Algérie, Paris, Librairie internationale de l’agriculture et de la colonisation, 1858, p.17.
[4] Voir V. Monteil, « Les bureaux arabes au Maghreb (1833-1961) », in Esprit, « Nouvelle série », n°300 (II), novembre 1961, p. 580 ; 595.