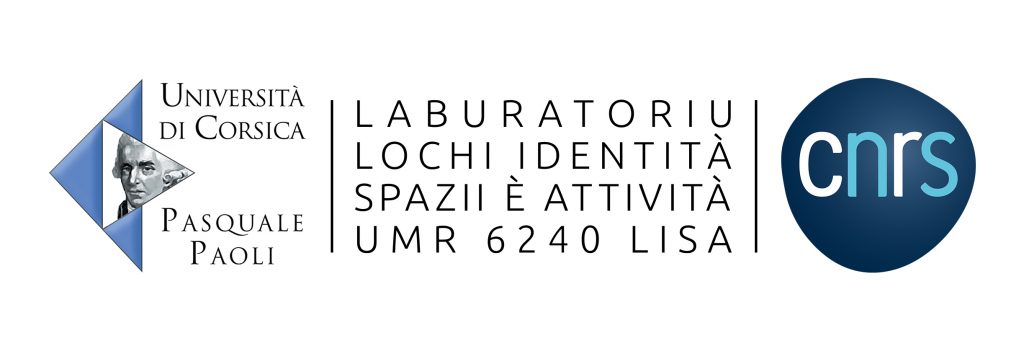L’école française en Algérie, une déclinaison singulière de l’institution républicaine 1944-1962
Christine Mussard
Résumé :
Cet article concerne la thématique de l’État éducateur en contexte colonial, et plus précisément l’école primaire française abordée dans ses marges – l’Algérie colonisée depuis le plan de scolarisation de 1944 jusqu’à l’indépendance – mais depuis une région qui était un centre en Algérie, autour de la région de Blida, au sein du département d’Alger, partiellement inscrite dans la plaine de la Mitidja, espace vitrine de la colonisation française. L’approche se situe aux portes de la classe, et interroge davantage sur ce que l’on peut faire de l’école plutôt que ce que l’on y fait, alors que le territoire prend « les chemins de la décolonisation ».
Tandis que l’État colonial français s’essouffle, affaibli par les revendications nationalistes et les atteintes qui conduisent ses représentants à manier dans l’urgence répression et réformes, l’État algérien est en germe dans la structuration progressive de groupes politiques concurrents et l’engagement croissant des populations. Les autorités françaises utilisent tous les vecteurs possibles pour affirmer la légitimité de leur maintien, et l’école en est un. Le projet d’une couverture scolaire étendue à toute une population scolarisable jusque-là majoritairement tenue à l’écart, jusqu’aux contrées les plus isolées du monde rural, vise ainsi à matérialiser la présence française là où elle a manqué. Mais ce déploiement n’est pas le seul moyen de s’affirmer. L’école publique française a ainsi à faire avec des structures scolaires autres, concurrentes, vectrices d’une contre-offensive culturelle pour les promoteurs d’une souveraineté algérienne. Les écoles coraniques pourtant surveillées par les autorités françaises connaissent en effet des développements nouveaux avec l’essaimage croissant des classes ouvertes par l’association des oulémas, tandis que les formations politiques nationalistes créent à leur tour des structures scolaires qui se multiplient avant et pendant la guerre d’indépendance. Toutes incarnent le désir d’une autre souveraineté, dont les caractères – langue, enseignement religieux- s’affirment dans les classes que les acteurs de l’Éducation nationale et de l’administration s’emploient à autoriser, tolérer mais aussi interdire.
Mots-clés : Ecole républicaine, Algérie coloniale, Blida, réformes, inégalités.
Résumé
Introduction
L’action éducative de la France en Algérie a souvent laissé dans le sens commun une image positive qui viendrait faire contrepoids à un « bilan » jugé globalement négatif de la domination française. Les nombreuses photos de classe qui émaillent les sites web portés par d’anciens Français d’Algérie et leurs descendants sont souvent brandies comme les traces des apprentissages transmis au sein des écoles françaises et des liens d’amitié noués dans les années de l’enfance et de l’adolescence entre les différentes populations. Les Algériens sont en effet présents sur les clichés, mais ils représentent une faible part d’une population scolarisable qui n’a pas accès à la classe et à la veille de l’indépendance, seuls 31% d’entre eux ont bénéficié de l’instruction française[1]. Les réalisations médiocres de la colonisation française en matière scolaire caractérisent l’ensemble de l’Empire et les thèses et publications qui se multiplient dans les années 1970 battent en brèche la réussite d’une « mission civilisatrice » tant au Maghreb qu’en Afrique subsaharienne[2].
Pour les Algériens, largement majoritaires par le nombre et sujets plutôt que citoyens, l’accès à l’école est soumis à des conditions particulières, dans la lignée d’autres droits repensés, aménagés, rabotés. La période dite des rattachements, entre 1881 et 1896, pendant laquelle les grands services algériens sont directement rattachés aux ministères parisiens, voit se multiplier les mesures officiellement assimilationnistes mais en réalité destructrices et imposées à un peuple vaincu[3]. Les lois scolaires aménagées prennent alors leur place entre les lois foncières qui accélèrent la dépossession des populations locales au profit de la mise en place de villages de colonisation[4], l’instauration du régime de l’indigénat en 1881[5] ou encore la confiscation de la justice traditionnelle[6]. Le système qui se développe en Algérie est néanmoins bien celui de l’école républicaine, avec ses fondements législatifs hérités des lois Ferry. Gratuité, laïcité, obligation scolaire, ces trois piliers qui font l’identité de l’école républicaine sont ainsi exportés, mais leurs profonds éloignements du modèle, in situ, au sein de cette possession française font de cette « école aux colonies » un objet qui renvoie davantage à l’exceptionnalité de la situation coloniale[7]. Écoles spéciales, programmes distincts, inspection spécifique, l’école française en Algérie se distingue par les formes particulières qu’elle revêt lorsqu’elle concerne la population dite indigène, alors que la scolarisation des élèves français et de ceux relevant des « races sœurs[8]» adopte les atours de celle développée en métropole. Les choix budgétaires, sous la pression des colons, ont ainsi guidé une mise en œuvre de la scolarisation à deux vitesses, une séparation scolaire[9] ancrée dans le territoire par un semis des structures éducatives d’abord calqué sur les besoins des enfants de colons. L’absence de scolarisation qui est absentéisme pour les enfants français et plus généralement d’origine européenne[10], combattu, traqué et sanctionné, est pour les jeunes Algériens acceptable, tolérable, institué. Le différencialisme marque donc le traitement des élèves par rapport à l’école. Il ne relève pas que des pratiques et des réalités du terrain : il est inscrit dans la loi.
L’inégale injonction permet alors le report systématique d’une prise à bras le corps de l’éducation pour tous. Tandis que les élèves d’origine européenne connaissent une scolarité très semblable à celle de leurs camarades métropolitains, les élèves algériens sont pour leur immense majorité, étrangers à la classe où se font les premiers pas du lire et de l’écrire. Le refus des familles algériennes de confier leurs enfants à un système tournant le dos à l’islam et à la langue arabe a sans nul doute contribué à limiter cette scolarisation. Mais à partir des années 1920, la demande scolaire des familles s’est affirmée, exprimée, passant par la voix des élus aux Délégations Financières[11] ou par celle des représentants de djemaa[12] et prend sa place dans l’inventaire croissant des contestations, qui réclament l’école autant que l’accès aux services postaux[13]. La revendication est puissante aux lendemains de la Seconde Guerre mondiale, et met l’État en demeure de mettre en œuvre le droit. Elle accompagne la contestation du colonialisme, qui motive autant qu’elle complexifie les réformes qu’engage l’État colonial, exprimée et durement réprimée lors des soulèvements de mai 1945, puis déferlante avec la guerre d’indépendance. C’est depuis Alger qu’un programme de réformes engagé par le Comité français de Libération nationale (CFLN) constitue un tournant majeur dans l’histoire de l’école française en Algérie. L’abrogation de l’indigénat en mars 1944, l’accès à la citoyenneté par la loi du 7 mai 1946, le statut de l’Algérie en 1947 qui instaure l’Assemblée algérienne[14], sont au moins symboliquement des actes forts qui ouvrent la porte à plus d’égalité et d’accès aux droits, alors qu’aucune force politique française, y compris le parti communiste, n’envisage l’indépendance des territoires coloniaux[15]. L’école prend sa part dans le train des changements et le plan de 1944 engage un processus de massification, promettant des ouvertures annuelles de classe sur tout le territoire au rythme de la croissance démographique, jusqu’à la complète intégration des élèves, espérée au milieu des années 1960[16]. Le développement scolaire compte alors parmi les réformes de la dernière chance, attendu par les Algériens mais scruté aussi par les instances internationales comme une manifestation de l’égalité à établir.
Notre étude appréhende ce temps de l’école primaire républicaine dans la région de Blida portion de l’empire français, marge géographique, hors de l’hexagone, mais pôle économique au sein de l’Algérie colonisée, dont le chef-lieu concentre une population importante, soit 246 815 habitants dont 199 739 Algériens selon le recensement de 1954[17]. La région choisie est sise dans le département d’Alger et forme une bande de 150 km de long, limitée à l’ouest par les reliefs de la Dahra et le douar de Beni Mileuk et à l’est par les localités de Bouinan et Chebli. Elle doit sa richesse à la plaine de la Mitidja, qui a façonné le mythe de la réussite du projet colonial français. Les exploitations d’importance, les domaines, les fermes nombreuses y organisent un territoire où l’activité agricole prospère entre les vignes et les orangeraies. Les entreprises qui ont nourri la renommée de l’industrie française s’y sont développées : Orangina, née dans les années 1930 à Boufarik, et Bastos, développée depuis Oran, comptent parmi les plus célèbres, mais aussi le domaine Sainte-Marguerite où se cultivent les plantes à parfum. La présence française y est significative, mêlée aux Algériens dans la pratique des activités économiques, et formant un « monde du contact[18]» dense. La richesse de la plaine alimente les mobilités quotidiennes de journaliers venant travailler depuis les montagnes environnantes dans les fermes européennes, mais aussi des courants migratoires extérieurs que l’on retrouve dans l’ensemble de la Mitidja[19]. Le territoire est en effet constitué des montagnes de l’Atlas blidéen, du Chenoua et de nombreux douars épars comme dans la commune mixte de Cherchell où la présence française en hommes et en équipements est plus rare. Dans ce territoire composite se mêlent des populations algériennes de langue arabe et berbère.

Les limites du territoire sont celles d’un maillage administratif, celui d’un arrondissement du département d’Alger dont Blida est sous-préfecture, et elles définissent aussi les contours d’un fonds d’archive conservé aux Archives nationales d’outre-mer (ANOM). Le choix de Blida et de sa région relève en effet d’une opportunité documentaire, saisie après le sondage de cartons issus des fonds de sous-préfecture. Le fonds de la sous-préfecture de Blida retient particulièrement notre attention. Le fait scolaire y prend sa place dans une chronologie plus étendue que celle de la guerre d’indépendance, embrassant la décennie qui la précède, et avec elle le temps de la mise en œuvre du plan de scolarisation de1944. L’administration soucieuse de rendre compte des avancées liées aux plans de constructions successifs, et de l’effectivité de son pouvoir, donne à voir une école en chiffres et en tableaux, en listes d’établissements, en nombre de classes à ouvrir sous la pression d’une demande parentale forte. Les écoles coraniques dans leur diversité, ainsi que les composantes d’un tissu associatif vivace qui leur est fortement arrimé, nourrissent également la documentation de ce fonds. Des fonds secondaires et quelques enquêtes orales menées sur le terrain complètent ces matériaux.
Page 1
[3] COLONNA Fanny, Instituteurs algériens1883-1939, Presses de la fondation…
[4] GUIGNARD Didier, “Conservatoire ou révolutionnaire ? Le sénatus-consulte de…
[5] MANN Gregory, « What Was the “Indigénat”? The “Empire of Law” in…
[6] LEKÉAL Farid, « Justice et pacification : de la Régence d’Alger à l’Algérie…
[7] SALAÜN Marie, « Passer par l’« école » pour penser le colonialisme…
[8]. Cette expression du gouverneur général Tirman est extraite de la…
[9] KATEB Kamel, « les séparations scolaires dans l’Algérie coloniale »…
[10] CHAPOULIE Jean-Michel, « Une question débattue au début du XXe…
[11] Les Délégations financières ont été créées en 1898 pour à gérer le budget…
[12] Assemblée de notables dans un douar.
[13] LACROIX Annick, « La poste au douar. Usagers non citoyens et État…
Cette étude ambitionne de saisir selon une approche régionale, la façon dont l’école primaire française se déploie pendant les vingt dernières années de la présence française, dynamisée par les projets et les promesses formulées « d’en haut », mais finalement empêchée, bien éloignée de la massification espérée par le projet de Capitant. Une approche au plus près des terroirs mettra en lumière les obstacles et les réticences à son développement liés d’une part à la prise à bras le corps tardive d’une scolarisation pour tous (I), aux obstacles introduits par la guerre indépendance bien que celle-ci puisse aussi la stimuler (II), ainsi qu’au dynamisme des structures coraniques qui concurrencent l’école française (III).
I. Une prise en charge tardive
- Une obligation scolaire sous conditions
Au printemps 1944, à la suite de la décision du CFLN (Comité Français de Libération Nationale) prise à Alger le 11 décembre 1943 d’« élever la condition politique, sociale, économique des Français musulmans », un plan de scolarisation voit progressivement le jour et se concrétise par la signature de plusieurs ordonnances et décrets le 27 novembre 1944[20]. L’obligation scolaire, texte pivot de ces réformes, prévoit désormais que « l’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus » est applicable « à tous les enfants sans distinction[21] ». Avec ces nouveaux contours, ce droit semble renouer avec la promesse qu’il portait lors de sa promulgation à la fin du XIXe siècle par Jules Ferry, celle d’une « insertion politique et sociale, sinon professionnelle, en échange d’une soumission à l’ordre scolaire[22] ». Cette mesure ne peut néanmoins être mise en acte sans l’instauration d’un projet d’envergure qui prévoit la multiplication des structures scolaires et le recrutement d’enseignants. Le ministre de l’Éducation nationale René Capitant envisage ainsi en vingt ans la création de 20 000 classes pouvant accueillir un million d’élèves[23]. L’application du texte est donc conditionnée par l’avancée progressive des constructions et l’article 4 stipule que les modalités d’application du décret seront fixées selon les arrêtés du gouverneur général[24]. La demande d’école des familles, affirmée depuis les années 1920, et relayée en 1943 par les revendications du Manifeste du peuple algérien, a influencé ces nouvelles orientations. La parole des Algériens a en effet été audible le 10 février 1943, lorsque Ferhat Abbas a remis aux autorités un texte, le Manifeste du Peuple algérien, signé par 28 élus musulmans. Les rédacteurs demandent notamment l’abolition du régime colonial et l’élaboration d’une constitution propre à l’Algérie dans un texte qui dénonce « la subordination de tout le pays avec son humanité, ses richesses (…) à cet élément français et européen[25] ». La question scolaire compte parmi les revendications exprimées. Les rédacteurs évoquent la création de l’enseignement français pour les « indigènes », ne profitant qu’à une petite élite, empêché par des colons hostiles à sa plus large diffusion. Les revendications qui clôturent le manifeste réclament une constitution garantissant notamment « l’instruction gratuite et obligatoire pour les enfants des deux sexes[26] ».
Plus de soixante ans séparent le décret de 1944 de l’obligation scolaire instaurée par les lois Ferry, dont il se réfère à l’article 4, qui stipule notamment que « L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes âgés de six ans révolus à treize ans révolus[27] ». Pour en saisir toute la portée, il est nécessaire de revenir aux textes fondateurs de l’obligation scolaire : celui de mars 1882, mais surtout ceux de 1883 et 1892, qui en aménagent les exigences et placent les écoles des Algériens dans un régime spécial. En effet, jusqu’au décret de 1944, cette obligation ne concernait dans les textes que les élèves d’origine européenne, « quelle que soit la nationalité des parents[28] », la scolarisation de la population dite algérienne musulmane relevant de l’article 34 du décret de 1883, stipulant que « des arrêtés du gouverneur général détermineront à mesure que le nombre des locaux scolaires le permettra, les communes ou les fractions de communes dans lesquelles les prescriptions du titre III seront applicables aux indigènes[29] ». Les élèves d’origine espagnole, italienne, maltaise, … sont en revanche, inclus dans ce principe d’obligation. Le 15 octobre 1892, un nouveau décret vient entériner la fracture entre ces élèves obligés et les jeunes algériens. L’obligation, soumise à des arrêtés, n’est désormais plus applicable qu’aux garçons selon l’article 5[30]. Par ailleurs, cette obligation est instituée dans les écoles primaires publiques, mais surtout au sein d’ « écoles spécialement créées pour eux » (art. 1), « spécialement destinées aux indigènes » (art. 12)[31]. La séparation scolaire dans des structures éducatives distinctes est ainsi établie et légalisée[32]. En 1897, le non- respect de l’obligation scolaire constitue par ailleurs une nouvelle infraction au code de l’indigénat. La 21ème infraction prévoit en effet des sanctions en cas de « négligence ou refus d’envoyer un enfant d’âge scolaire à l’école primaire, quand l’école est située à moins de 3 kilomètres et qu’il n’est pas présenté d’excuse valable[33] ».
- Un besoin d’écoles croissant dans la ville de Blida
Dans la commune de Blida, la période à l’étude est marquée par une croissance importante de la population algérienne ainsi que dans les centres alentour, nourrie par une immigration lointaine, facilitée par le déploiement de réseaux de transports : les infrastructures routières entreprises dès le milieu du XIXème siècle, relient la ville à Alger, à Boufarik, et à certains petits centres alentour[34], et avant les années 1930, les entreprises de transport se développent, particulièrement les Autocars Blidéens et Transports Maury[35]. Plus proches, les populations quittant les douars de montagne situés au sud, Sidi Kebir, Sidi Fodhil et Ghellaïe alimentent également l’augmentation de la population[36]. Dans ces territoires de l’Atlas blidéen adjoints à la commune en 1876, la population qui comptait alors 5902 habitants a presque triplé, et alimente des mobilités selon une dynamique que connaissent l’ensemble des villes algériennes. Blida, au contact d’une région montagneuse pauvre et d’une plaine agricole étendue et fertile est l’espace privilégié de l’accueil de ces ruraux motivés par l’espoir d’un emploi souvent agricole[37]. Ces arrivées de familles au sein de la commune renforcent la demande scolaire au sein des établissements. Elle sera accrue avec les déplacements qui videront les montagnes environnantes pour occuper les camps de regroupement à partir du printemps 1957.
Les écoles primaires à Blida en 1956. (Source : auteure, d’après ANOM 917 36)

Page 2
L’implantation des écoles s’est constituée en différentes étapes. Deux groupes scolaires rassemblant maternelle et primaire voient le jour dans une première période, entre 1876 et 1880: Lavigerie pour les garçons, et l’Orangerie, évoquée précédemment, pour les filles. Ces établissements sont situés dans ce qu’on appellerait aujourd’hui l’hyper centre de la commune. Édifiés pour des publics européens, ces établissements accueillent peut-être, dès leur ouverture, aussi quelques élèves algériens, comme la loi le permet, mais nous ne disposons pas de statistiques permettant de l’affirmer. Avant la Grande Guerre, ceux-ci peuvent être instruits dans deux établissements. L’école dite Tirman (6) du nom de la rue éponyme, dénommée aussi dans les sources « écoles de garçons indigènes » est ouverte en 1901, non loin de la place du Marché indigène. Les écoles Lavigerie (5) et Tirman sont proches l’une de l’autre mais les élèves algériens sont jusqu’à la fin des années 1930 scolarisés exclusivement à Tirman. Les filles sont accueillies à partir de 1913 dans l’école dite « Ouvroir » (3), dite aussi écoles des « filles indigènes », et les enseignements se font d’abord dans les sous-sols des Halles aux Tabacs avant d’être déplacés rue de Dalmatie, plus à l’écart du centre[38]. Des établissements ouvrent à la fin des années 1950, plus éloignés du centre, comme le groupe scolaire « Cité musulmane ». Situé à l’est de la ville, au-delà du boulevard extérieur, il accueille surtout des élèves algériens souvent domiciliés dans l’habitat collectif alentour. Ceux-ci constituent le public majoritaire d’une autre école en 1930, dite Beauprêtre (9) du nom du boulevard où elle se situe ; ils fréquentent également l’école Cazenave (7), ouverte en 1937, fréquentée néanmoins majoritairement par des élèves européens.
Ces derniers sont surtout présents à l’école Bonnier (1), érigée en 1916 dans la partie ouest de la ville, sur le boulevard du même nom. Jusqu’en 1946, cette école primaire de garçons est la seule à n’accueillir que des élèves européens, mais trois ans plus tard, sur 503 élèves scolarisés, dans les 16 classes ouvertes, 95 sont d’après la catégorisation proposée, « Français musulmans ». Ils seront deux fois plus nombreux à s’inscrire à la rentrée 1956. Les diverses sources, archives coloniales et témoignages issus de sites web, convergent sur l’effectif raisonnable des classes de cette école, maintenu à 30 élèves au lieu des 50 couramment rassemblés. Elles s’accordent aussi sur l’ouverture de classes dites annexées pour faire face à la croissance des effectifs. Comme à Bonnier, la fin des années 1940 est marquée par un afflux d’élèves dans toutes les écoles primaires de la commune.
II. Ce que la guerre fait à l’institution scolaire française en Algérie
- La grève de 1956 : empêcher l’école française de fonctionner
Quelques jours avant la rentrée des classes de 1956, et deux ans après le début de la guerre d’indépendance algérienne, un tract exhortant les familles algériennes à boycotter l’école française est découvert dans plusieurs établissements du territoire. Le conflit s’est alors intensifié dans la région de Blida et l’agitation sociale touche un nombre croissant de secteurs. Cet appel à la grève y entraîne l’école et fait l’objet d’une véritable enquête où de multiples acteurs coopèrent, à la demande de la hiérarchie préfectorale. Le tract du FLN a vraisemblablement circulé ailleurs sur le territoire, apposé dans d’autres villes, devant d’autres entrées d’écoles, sous d’autres préaux. Dans cette guerre pour la souveraineté, le soutien des populations algériennes est une clé fondamentale pour l’ensemble des forces en présence, mais elle était déjà un ressort des actions menées bien avant le conflit. Dès 1947, le mouvement nationaliste algérien avait mis en place une guérilla révolutionnaire, en « exploitant le potentiel révolutionnaire des masses rurales[39] », et par la suite, après la nuit de la Toussaint 1954, l’ALN a besoin du soutien populaire pour survivre et se déployer[40]. Pénétrer « l’état d’esprit des populations[41] » est également une préoccupation permanente de l’administration coloniale, et elle devient obsession avec la montée des tensions qui précèdent l’insurrection de l’automne 1954.
Le 24 septembre 1956 à 17h, le préfet d’Alger François Collaveri fait transmettre à tous les sous-préfets du département un télégramme les invitant à prendre les mesures nécessaires. Ceux-ci doivent solliciter les maires des communes et l’administrateur des communes mixtes, et attirer leur attention sur des « consignes accompagnées menaces lancées [sic] par rebelles en vue interdire aux enfants français musulmans fréquenter nos écoles[42] ». Les destinataires sont alors invités à évaluer les effets de cette menace en contactant notamment les chefs d’établissements pour connaître les inscriptions, les achats de fournitures, la présence des élèves dans les classes, et d’adresser quotidiennement ces éléments entre le 1er et le 15 octobre. Collecter des renseignements d’un côté, convaincre voire sanctionner de l’autre : les pratiques sont diverses, visiblement non concertées. Les dégâts matériels avaient déjà emporté l’école dans le conflit, la comptant parmi les dommages collatéraux, à moins qu’elle ne soit, dès 1955, un symbole cible de l’action des « rebelles ». En septembre 1956, le tract du FLN en fait un enjeu explicite, et l’administration locale le prend au sérieux, invente des moyens de contenir et de contrôler les formes et les effets de la menace. Cet espace-temps – le moment de la rentrée scolaire – est ainsi révélateur de l’extension du champ d’action du FLN et de l’investissement en réaction par les cabinets des préfets puis par l’ensemble de la chaîne administrative.
- L’école française comme cible dans la guerre
Quelques jours avant le télégramme relatif au tract, le sous-préfet adresse à son supérieur une « situation des écoles » qui met en évidence l’inégal impact du conflit sur le territoire scolaire, près de deux années après le début de l’insurrection[43]. L’ouest de l’arrondissement a été la cible, certainement pendant l’été, de plusieurs incendies qui ont détruit les écoles des douars de la commune mixte de Cherchell. Nommées Tala Djerbal, Bouyamine et Sidi Abdelli, construites ou remises en état peu avant la guerre, elles étaient les rares structures scolaires de cette région montagneuse et enclavée, où la population éparse soutient souvent les combattants indépendantistes. Les enfants, associés à l’activité économique de la famille comme bergers, fréquentaient peu ces établissements français implantés sur le tard. Avec le début du conflit, certaines n’accueillent plus aucun élève, fermées par les autorités françaises car trop isolées, peu accessibles[44]. Les atteintes portées aux établissements scolaires attribuées aux combattants de l’ALN ne changent donc pas vraiment le quotidien des enfants. En revanche, dans ce contexte de guérilla menée dans des contrées isolées, leur destruction ne peut pas être comprise comme un dommage collatéral, mais bien comme un acte sciemment dirigé contre l’école française, qui matérialise la colonisation et l’imposition linguistique et culturelle qu’elle véhicule. L’école apparaît bien plus comme un marqueur de pouvoir dans des terres isolées dont la connaissance et la maîtrise sont un défi pour les troupes françaises. L’administration civile, en promouvant le remplacement à la hâte d’établissements endommagés, se fait en quelque sorte le relai de l’action militaire, l’accompagne, la soutient.
- Construire des écoles pendant le conflit
Les atteintes portées à l’école cohabitent avec l’accélération des constructions scolaires. Les chantiers issus des projets des années 1940 se poursuivent, et plus encore la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs du plan de 1944, revus par la commission Le Gorgeu en 1953. Plus tard, en août 1958, le plan de Constantine propose de nouvelles réformes destinées à accélérer la scolarisation des élèves algériens qui deviennent ici une cible de la propagande et un enjeu majeur pour la France et sa présence. Sa mise en œuvre accomplit en 2 ans ce que le plan de scolarisation de 1944 a produit en une décennie. Pour le seul département d’Alger, l’accroissement des effectifs scolaires algériens est ainsi de 60%. Nous ne possédons pas de données permettant de montrer sa mise en œuvre dans l’arrondissement de Blida. Deux nouvelles écoles de garçons implantées à Blida même – école Jean de la Fontaine et école de la Cité Gauthier, semble néanmoins relever de ce nouveau plan. Concernant la région de Cherchell, la « situation scolaire » présentée par le sous-préfet en 1956 fait état des destructions mais aussi des « établissements scolaires en projet ». Treize écoles sont mentionnées, dont 4 dans la commune mixte. La plupart sont en cours d’exécution, comme à Marengo ou à Novi, tandis que celle de Tipaza est presque achevée. À Koléa, des constructions commencent. Le conflit n’entrave donc pas la poursuite des constructions, il l’accélère, la stimule même, sous la pression de la maîtrise du terrain. La singularité de la situation algérienne est néanmoins le maintien et même le développement de la scolarisation au cœur du danger, dans une carte scolaire instable, mouvante, en train de se faire. Si certains établissements restent fermés, la plupart sont maintenus, ou aménagés pour fonctionner par l’action de l’administration locale qui prend le risque, pour les élèves, les familles et les personnels. Quelques mesures de sécurisation sont mises en place, et la proximité d’un poste de commandement est régulièrement évoquée pour rassurer enseignants inquiets et familles. Mais l’important est que l’école existe et les différents acteurs de l’administration civile et militaire y travaillent en collaboration, bien plus préoccupés pour ce qui relève des écoles dans les douars, d’emprise sur le territoire que de continuité pédagogique.
Page 3
III. Une institution concurrencée
- Une surveillance ancienne…
Pendant la période étudiée, le paysage scolaire se complexifie et se fragmente en Algérie. Les revendications nationalistes puis la guerre d’indépendance qui caractérisent les vingt dernières années de la présence française favorisent le développement de structures scolaires à destination des élèves algériens, espaces d’instruction alternatifs à un système public qui peine à s’étendre. L’affirmation du mouvement des oulémas multiplie ainsi les écoles dénommées « medersas libres » par l’administration coloniale, distinctes des écoles coraniques traditionnelles, antérieures à la présence française, et qui se multiplient également. Dès le début de la présence française, les écoles coraniques sont perçues comme autant de refuges de la résistance algérienne, et déclinent rapidement en nombre et en moyens, décimés par la suppression de leurs ressources matérielles et par le contrôle exercé sur les maîtres, engagé avec le décret du 30 septembre 1850[45]. Alger aurait ainsi compté 80 mçid en 1830 et seulement 15 en 1850[46]. Le décret de 1892 propose des dispositions qui étendent à l’Algérie la loi de 1886 pour « les écoles privées musulmanes dites écoles coraniques, mçid, zaouia, medersa », les distinguant des écoles dirigées par les Européens par un certain nombre de spécificités qui rendent ce régime de l’autorisation discriminatoire. L’ouverture de ces établissements est en effet soumise à l’accord d’une hiérarchie de fonctionnaires, sur présentation spécifique d’un certificat de moralité et d’une liste des lieux d’enseignements où le directeur a exercé. En cas d’infraction, la fermeture est prononcée, doublée de peines d’amande et d’emprisonnement. L’article 55 du décret de 1892 précise par ailleurs que ces écoles « ne pourront recevoir d’enfants d’âge scolaire pendant les heures de classe de l’école publique », si une école primaire publique est présente dans une distance de moins de 3 kilomètres[47]. Cette restriction est complétée en 1900 par une circulaire invitant les mouderrès[48] à modifier les horaires de leurs cours pour permettre la fréquentation des écoles primaires françaises[49]. Elle ne concerne pas les écoles privées catholiques, et montre bien que les écoles coraniques sont perçues comme concurrentes des établissements français. L’école française publique, fortement liée au projet colonial en Algérie et dans de nombreux territoires de l’empire, doit être le lieu de l’acculturation et de l’apprentissage de la langue française. Son rôle s’affirme avec le début de la Troisième République, qui tourne la page des écoles arabes-françaises et relègue l’apprentissage de la langue arabe aux seules écoles coraniques. L’influence de celle-ci doit donc être limitée et l’article 55 en est un instrument important. Il définit, pour tout le temps de la période française, et surtout dans les villes et communes où l’école française est présente, le cadre de la fréquentation par les élèves algériens. Ceux-ci sont en effet nombreux à suivre quotidiennement les deux formations, et se rendent à l’école coranique avant 8h et après 17h[50]. Le corollaire de cette limitation horaire est la sanction au manquement à l’obligation scolaire là où elle est effective, selon l’infraction 21, en application du code de l’indigénat. Jusqu’à son abrogation en mars 1944, ce régime juridique d’exception vient doubler les sanctions de fermeture envisagées par le décret de 1892, en y ajoutant peines d’amendes et d’emprisonnement. Relégué au dernier rang, limité et combattu, l’enseignement coranique traditionnel résiste néanmoins, comme l’attestent les nombreuses écoles ouvertes sans autorisation[51].
- …réaffirmée dans le temps du conflit
Le développement des écoles coraniques dans les années 1930 est généralement attribué à l’ouverture des nombreuses medersas de l’Association des oulémas musulmans algériens (AOMA), depuis le département de Constantine, foyer de développement de ces structures[52]. Elles s’y développent, puis essaiment sur l’ensemble du territoire : 800 écoles sont ouvertes dans le département de Constantine en 1932, 1573 en 1937 et 3000 en 1950. Elles sont en nombre moins important dans les départements d’Oran et d’Alger, mais y connaissent tout de même un croît significatif. Selon un état des écoles coraniques daté du 3 octobre 1941, on dénombre pour la seule agglomération d’Alger 52 écoles dont 34 sont situées dans la capitale, le reste étant réparti à travers la banlieue[53]. Régulièrement surveillées, ces écoles deviennent des cibles particulières pour les renseignements généraux après les événements du 8 mai 1945 du fait de l’engagement politique des dirigeants de l’AOMA et des enseignants qui y travaillent. Ceux si sont en effet nombreux à cumuler des engagements multiples, proches dans un premier temps de la formation légaliste de l’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA), puis progressivement plus en accord avec les nationalistes indépendantistes du Parti du peuple algérien-Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques (PPA-MTLD)[54]. Plusieurs responsables nationaux sont arrêtés et emprisonnés jusqu’à l’amnistie générale de mars 1946[55]. Ils affirment ensuite, jusqu’en 1957, une position neutre, religieuse, à l’écart du positionnement politique nationaliste, avant de soutenir l’action du FLN[56]. L’arrestation des cadres de l’association des oulémas s’est accompagnée de fermetures de medersas, puis de réouverture pour certaines. Suite à cette crise de 1945, l’administration préfectorale est soucieuse d’être au fait de la situation de ces établissements et requiert régulièrement un état des lieux auprès des maires, ainsi que des rapports produits par les commissaires ou les commandants de gendarmerie selon la taille de la commune concernée. Les documents produits par ce travail de quantification abondent, comme autant d’attestations du semis de ces établissements sur le territoire. En 1951, 1298 écoles sont ouvertes à l’ouest du territoire et 888 dans le département autour de la capitale[57]. Cinq écoles relevant de ce réseau accueillent des élèves dans l’arrondissement de Blida, nous y reviendrons. Le développement d’écoles coraniques que l’on peut qualifier de traditionnelles sur ce territoire est également notable : en 1950, une liste produite par le commissariat de Blida révèle que la commune en regroupe 26, dont 7 situées dans les douars rattachés à la commune, ouvertes majoritairement après 1940 (17 sur 26) et surtout après 1945[58].
- Un compromis ?
Le rapport de l’administration coloniale aux écoles coraniques, quelle que soit leur obédience, n’en est pas moins complexe, voire ambiguë et les correspondances entre le gouverneur général et les acteurs en prise avec les réalités du terrain font apparaitre des divergences d’appréciation. En juin 1949, le gouverneur général Edmond Naegelen transmet au préfet d’Alger des consignes relatives à l’ouverture des écoles coraniques sans autorisation. Ce vade mecum consiste à assouplir la position de l’administration, à l’engager à faire preuve de discernement à l’encontre de ces établissements qui ont fait l’objet de nombreuses fermetures. L’enseignement de la langue arabe et du Coran ne doit « en aucun cas être brimé », et les tolba[59]« qui font œuvre utile méritent d’être encouragés », guidés dans la régularisation de l’école. Les sanctions ne doivent concerner que ceux qui se « livrent à une propagande tendancieuse ». Le gouverneur général veut ainsi limiter de nouvelles sources de tensions qui émaneraient de ceux qui restent « nos adversaires » dont ne s’agit pas de faire des « martyrs de la foi[60] ». La clairvoyance requise nécessite, selon le gouverneur, les compétences du préfet plutôt que celles des « chefs de commune ».
En 1953, le préfet d’Alger s’adresse au sous-préfet de Blida, joignant à sa missive le courrier que Naegelen avait envoyé à son prédécesseur. Il rappelle le cadre légal en vigueur, mais précise « qu’une exacte connaissance des textes ne suffit pas toujours », et qu’il est parfois nécessaire de « tenir compte des raisons d’opportunité qui peuvent amener à suspendre ou du moins à différer la mise en œuvre rigoureuse des exigences de la loi[61] ».
Trois ans plus tard, quelques semaines avant la grève scolaire, le ministre résidant Robert Lacoste se saisit à son tour de la lettre de Naegelen et en étoffe le sens dans un contexte différent[62]. L’engagement dans le conflit a intensifié la répression à l’encontre de l’enseignement privé et Lacoste insiste sur l’action des autorités locales en la matière. Reprenant les termes de Naegelen avec insistance, et le nécessaire respect de cet enseignement « malgré ses lacunes », il réaffirme la bienveillance stratégique qui doit guider les décisions. Un nouvel argument est brandi alors que le plan de scolarisation peine à accueillir le plus grand nombre : celui du défaut de scolarisation par l’école publique française, « idéal encore lointain », que ces écoles compensent en partie en accueillant des élèves qui sans elles seraient désœuvrés, dans la rue. Les critiques contre un enseignement jugé jusque- là archaïque à défaut d’être « subversif » s’estompent alors devant la reconnaissance de l’utilité de ces établissements « qui sauvent de l’analphabétisme complet et des dangers de la rue un nombre appréciable d’enfants, et rend à cet égard d’indéniables services [63]».
Car c’est bien la peur de la rue qui motive ces propos de Lacoste, bien plus que les finalités éducatives. La scolarisation, même dans des lieux perçus comme moins performants, est toujours préférable pour l’administration française au risque d’enrôlement des élèves dans des formes de contestation. Les jeunes élèves sont certes moins concernés par l’engagement politique, mais l’assurance de leur fréquentation scolaire est un moyen de les contrôler, de savoir où ils sont. Plus largement, Lacoste craint les réactions des Algériens face aux fermetures d’école, si sensibles « au mesures prises, soit en faveur des écoles privées, soit contre elles ». La peur du désœuvrement des élèves et du mécontentement des familles conduit le gouverneur général à tolérer ces structures, considérées comme des lieux complémentaires à la scolarisation publique, partenaires dans la prise en charge des enfants. La guerre adoucit ici le rapport répressif, à doser finement pour ne pas se mettre à dos une population dont l’adhésion est précieuse. Là encore, les décisions à prendre requièrent selon Lacoste une certaine habileté, qui nécessite l’expertise des préfets eux-mêmes plutôt que l’intervention des « agents chargés du maintien de l’ordre ».
Page 4
[1] DESVAGES Hubert, « La scolarisation des musulmans en Algérie (1882-1962) dans l’enseignement primaire public français. Étude statistique », Cahiers de la Méditerranée, n°4, 1972, p. 63. Ces chiffres sont proposés par l’auteur à partir des données du Ministère algérien de l’orientation nationale, service statistique.
[2] BARTHELEMY Pascale, « L’enseignement dans l’Empire colonial français : une vieille histoire ? », Histoire de l’éducation, n°128, 2010, p. 6.
[3] COLONNA Fanny, Instituteurs algériens1883-1939, Presses de la fondation nationale des sciences politiques, Paris, 1975, p. 22, AGERON Charles-Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine, Paris, PUF, 1964, p. 45-71.
[4] GUIGNARD Didier, “Conservatoire ou révolutionnaire ? Le sénatus-consulte de 1863 appliqué au régime foncier d’Algérie”, Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 41, 2010, p. 81-95 ; MUSSARD Christine, L’obsession communale, La Calle, un territoire de colonisation dans l’Est algérien (1884-1957), Aix-en-Provence, PUP, Collection Le temps de l’histoire, 2018 ; SIFOU Fatiha, « La protestation algérienne contre la domination française : plaintes et pétitions (1830-1914) », thèse d’histoire sous la direction de Jean-Louis Triaud, Université de Provence, 2004.
[5] MANN Gregory, « What Was the “Indigénat”? The “Empire of Law” in French West Africa », The Journal of African History, n° 50, vol. 3, 2009, p. 331‑353 ; MERLE Isabelle, « Retour sur le régime de l’indigénat : Genèse et contradictions des principes répressifs dans l’empire français », French Politics, Culture & Society, n° 20, vol. 2, 2002, p. 77‑97 ; THENAULT Sylvie, « L’indigénat dans l’Empire français : Algérie/Cochinchine, une double matrice », Monde(s), n° 12, vol. 2, 2017, p. 21‑40.
[6] LEKÉAL Farid, « Justice et pacification : de la Régence d’Alger à l’Algérie : 1830-1839 », Histoire de la justice, 2005, n° 16, p. 13-30.
[7] SALAÜN Marie, « Passer par l’« école » pour penser le colonialisme autrement », Genèses, n°15, 2019, p. 146. 8
[8]. Cette expression du gouverneur général Tirman est extraite de la circulaire qui accompagne le décret du 13 février 1883, citée par REYNAUD -PALIGOT Carole, op. cit., p. 75
[9] KATEB Kamel, « les séparations scolaires dans l’Algérie coloniale », Insaniyat n°25-26, 2004, p. 65-100.
[10] CHAPOULIE Jean-Michel, « Une question débattue au début du XXe siècle : le respect de l’obligation scolaire », L’école d’État conquiert la France : Deux siècles de politique scolaire, PUR, 2010, p. 201.
[11] Les Délégations financières ont été créées en 1898 pour à gérer le budget de la colonie, et prendre en compte les divers intérêts présents grâce à la mise en place de trois assemblées : la Délégation indigène comprenant 21 membres, la Délégation des colons, composée de 24 délégués français élus par les colons (huit par département), et la Délégation des non-colons, organisée de la même manière et élue par les Français non colons.
[12] Assemblée de notables dans un douar.
[13] LACROIX Annick, « La poste au douar. Usagers non citoyens et État colonial dans les campagnes algériennes de la fin du XIXème siècle à la Seconde Guerre mondiale », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2016 n°71, p. 722.
[14] CHENNTOUF Tayeb, « L’assemblée algérienne et l’application des réformes prévues par le statut du 20 septembre 1947 », Les chemins de la décolonisation de l’empire colonial français, 1936-1956 : Colloque organisé par l’IHTP les 4 et 5 octobre 1984, Paris, CNRS Éditions, 1986, p.367-375.
[15] THENAULT Sylvie, Histoire de la guerre d’indépendance algérienne, Paris, Flammarion, 2012, p.70.
[16] LEON Antoine, Colonisation, enseignement et éducation. Étude historique et comparative, L’Harmattan, 1991, p.223-225.
[17] D’après la Statistique générale de l’Algérie. Résultats statistiques du recensement de la population du 31 octobre 1954. https://octaviana.fr/document/FJDNM101#?c=&m=&s=&cv= .
[18] BLANCHARD, Emmanuel, et THENAULT Sylvie, « Quel « monde du contact » ? Pour une histoire sociale de l’Algérie pendant la période coloniale », Le Mouvement Social, vol. 236, no. 3, 2011, pp. 3-7.
[19] DELUZ- LABRUYERE Joëlle, Urbanisation en Algérie : Blida. Processus et formes, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux, 1988, p. 49
[20] LEON Antoine, op. cit., p. 220.
[21] Décret du 27 novembre 1944 instituant l’obligation scolaire en Algérie, article 1er.
[22] MONJO Roger, » L’école peut-elle être, à la fois, libératrice et obligatoire ? », Le Télémaque 43, no 1,2013, p.91.
[23] Ibid.
[24] Décret du 27 novembre 1944 instituant l’obligation scolaire en Algérie, article 4.
[25] AN AG 3(1) 282 283, Manifeste du Peuple Algérien 10 février 1943 et Projet de Réformes de juin 1943.
[26] Ibidem.
[27] JORF, 29 mars 1882, n°87, quatorzième année, loi sur l’enseignement primaire obligatoire, article 4.
[28] JORF, 15 février 1883, n°45, quinzième année, décret du 13 février 1883, titre III, art.15.
[29] JORF, 15 février 1883, n°45, quinzième année, décret du 13 février 1883, titre IV, art.34.
[30] JORF du 20 octobre 1892, décret du 15 octobre 1892.
[31] Idem.
[32] KATEB Kamel, « Les séparations scolaires dans l’Algérie coloniale », Insaniyat, no 25‑26, p. 65‑100.
[33] Bulletin officiel du ministère de l’Intérieur, 1er janvier 1897, n°12.
[34] FRANC Julien, Le chef d’œuvre colonial de la France en Algérie : la colonisation de la Mitidja, Champion, Paris, 1929, p. 626.
[35] DELUZ-LABRUYERE Joëlle, op. cit., p.52.
[36] Idem., p. 46.
[37] Idem, p. 58
[38] Le Tell : journal des intérêts coloniaux, 15 novembre 1918.
[39] MACMASTER Neil, « Constitution d’une base paysanne : comparaison des guérillas au Vietnam et en Algérie, entre 1940 et 1962 », 2017, Monde(s), vol. 12, n°. 2, p. 123.
[40] BRANCHE Raphaëlle, « Combattants indépendantistes et société rurale dans l’Algérie colonisée », 20&21. Revue d’histoire, n° 141, 2019, p.115.
[41] Cette expression est une rubrique du rapport mensuel que le sous-préfet doit transmettre mensuellement à sa hiérarchie, ANOM 917 48.
[42] ANOM 917/ 37, télégramme du 25 septembre 1956, préfecture d’Alger, service des transmissions.
[43] ANOM 917 36, lettre du sous-préfet de l’arrondissement de Blida au préfet, 19 septembre 1956
[44] KATEB et al., op. cit., p.99. Le témoin précise qu’à 6 ans, il s’occupait de 6 taureaux. Les enfants un peu plus grands gardaient des chèvres et ceux de 10 ans s’occupaient des vaches. À l’adolescence, ils étaient chargés des labours et des travaux du champ.
[45] Décret du 30 septembre 1850.
[46] COLLOT Claude, Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), Paris, Éditions du CNRS, 1987, p. 314.
[47] Décret du 18 octobre 1892, article 55.
[48] Enseignant en arabe.
[49] COLLOT Claude, op. cit., p. 321.
[50] KATEB (2012), p. 42
[51] KADRI Aïssa, « Les autorités coloniales, les écoles coraniques et la langue arabe en Algérie », Regards français sur l’Islam. Des Croisades à l’ère coloniale. Vulaines-sur-Seine, Éditions du Croquant, « Sociétés et politiques en Méditerranée », 2021, p. 261.
[52] KATEB (2012), p.42.
[53] SIARI TENGOUR Ouanassa, op. cit., p.89.
[54] COURREYE Charlotte, op. cit., p.77
[55] PEYROULOU Jean-Pierre, Guelma, 1945 : une subversion française dans l’Algérie coloniale, Paris, La découverte, 2009, p. 280.
[56] COURREYE Charlotte, op. cit. p. 77.
[57] Idem, p. 43.
[58] ANOM 917 77, liste des écoles coraniques de Blida, 1er janvier 1950.
[59] Les tolba (pluriel de taleb) sont les directeurs de petites écoles coraniques.
[60] ANOM 917 80, lettre du gouverneur général au préfet d’Alger, le 17 juin 1949.
[61] ANOM 917 80, lettre du préfet d’Alger au sous-préfet de Blida, le 2 mars 1953.
[62] ANOM, 917 80, lettre de Robert Lacoste, gouverneur général et ministre résident en Algérie aux préfets, le 31 août 1956. Les extraits qui suivent sont issus de cette correspondance.
[63] Idem.
D'autres articles

L’enseignement doit-il être une affaire d’état ? Réflexions personnelles d’un universitaire Corse
Ma réponse est oui. L’enseignement c’est un tout qui repose sur trois piliers : un lieu ; un budget ; un savoir. L’enseignement, à première vue, c’est tout d’abord un lieu où il faut pouvoir le dispenser. Dans l’Antiquité grecque, c’était sous les portiques du temple d’Apollon, allées couvertes qui laissaient passer la « lumière » d’où le nom de « lycée ». Je…

Annexe, Extraits des pages 141 à 151 du Testament politique d’Alberoni
« L’aveugle prévention des Anglois, ne laisse aucun espoir de leur retour vers leur Souverain naturel. C’est à lui de se faire, par sa valeur & sa conduite, le rang qu’ils lui refusent, & de se bâtir à leurs dépens un trône, qui lui tienne lieu de celui où ils ne veulent pas le faire monter.
La postérité ne pardonnera point au Prince Edouard, d’avoir…

Théodore, l’Angleterre et le projet d’Alberoni pour la Corse
Au cours du XVIIIe siècle, la Corse a fait l’objet de bien des spéculations de la part des États européens. Les nationaux, dans leur combat pour venir à bout de l’occupant génois, ont tenté en permanence de s’appuyer sur ces ambitions, afin de trouver des alliés de circonstance : non sans de nombreuses désillusions. De ce point de vue, l’épisode qui…