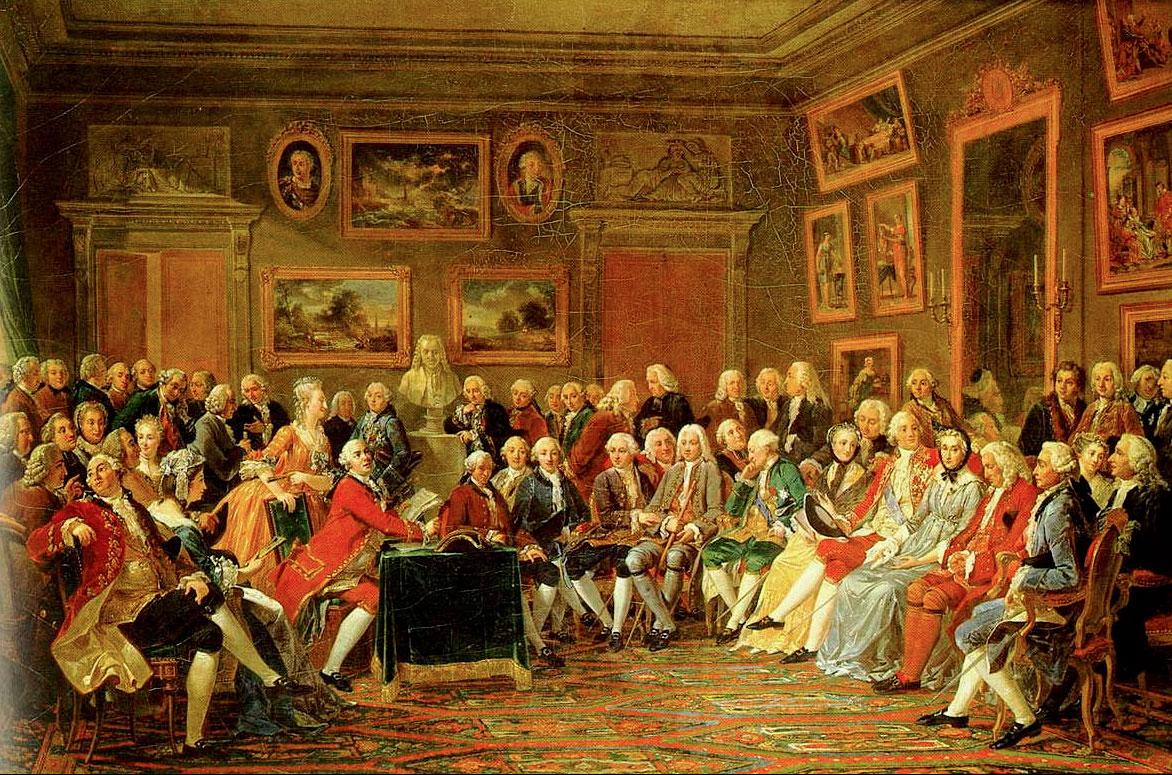Résumé : Cet article s’interroge tout d’abord sur les fondements normatifs du droit au bonheur, en lui attribuant le statut d’intérêt constitutionnel : la lecture systématique et téléologique des libertés et droits constitutionnels implique la mise en place des conditions nécessaires pour que l’individu détermine et poursuive de manière autonome les fins par lesquelles il entend rechercher son bonheur et conférer un sens à sa vie. Ensuite, l’article, en se basant sur la reconnaissance de la centralité actuelle du travail en tant que domaine crucial de la réalisation personnelle, analyse le lien entre le travail et l’intérêt constitutionnel pour le bonheur, en mobilisant le concept aristotélicien d’eudaimonia – le bonheur à travers l’exercice de ses capacités et la cultivation de ses vertus – et en soulignant la portée émancipatrice inscrite en ce sens dans le développement du droit du travail. Dans le même temps, la réorganisation économico-concurrentielle du travail et du droit du travail sur la base de catégories telles que la ‘flexibilité’, l’‘employabilité’, ‘l’activation’, etc., affaiblit progressivement la normativité émancipatrice mentionnée ci-dessus, produisant des formes généralisées de marchandisation. Pourtant, ces catégories présentent des potentiels d’autodétermination individuelle qui ne sont pas ou peu exploités et qui pourraient favoriser la libre construction des capacités et la recherche individuelle du bonheur au travail. Ainsi, dans les dernières sections, l’article propose une réactualisation de la normativité émancipatrice du droit du travail à travers une reconceptualisation sur des bases hégéliennes et honnethiennes du travail susceptible d’élargir les marges de la liberté dans et du travail et de construire un concept juridique de professionnalité interprétable comme autoconstitution et appropriation de soi du sujet et comme transition vers un droit pour le travail propice à la recherche du bonheur personnel.
Abstract: This article begins by examining the normative foundations of the right to happiness, attributing to it the status of a constitutional interest: a systematic and teleological reading of constitutional rights and freedoms implies the establishment of the conditions necessary for individuals to determine and pursue autonomously the ends by which they intend to seek happiness and give meaning to their lives. Based on the recognition of the current centrality of work as a crucial area of personal fulfilment, the article then analyses the link between work and the constitutional interest in happiness, drawing on the Aristotelian concept ofeudaimonia – happiness through the exercise of one’s abilities and the cultivation of one’s virtues – and highlighting the emancipatory scope inscribed in this sense in the development of labour law. At the same time, the economic-competitive reorganisation of work and labour law on the basis of categories such as “flexibility”, “employability”, “activation”, etc., is gradually weakening the emancipatory normativity mentioned above, producing widespread forms of commodification. And yet these categories offer potential for individual self-determination that is little or never exploited, and which could foster the free construction of capabilities and the individual pursuit of happiness at work. Thus, in the final sections, the article proposes an update of the emancipatory normativity of labour law through a reconceptualisation of work on Hegelian and Honnethian foundations that could widen the margins of freedom in and of work and construct a legal concept of professionality that can be interpreted as the subject’s self-constitution and self-appropriation, and as a transition towards a right to work that is propitious to the pursuit of personal happiness.
Mots-clés : Bonheur – Travail – Eudaimonia – Hegel – Émancipation
L’affirmation d’un ‘intérêt constitutionnel’ au bonheur
Le bonheur, en tant que « réalité ontologique pérenne de l’être humain[1] », désigne un concept polysémique, largement débattu au cours de l’histoire de la pensée religieuse, philosophique, politique, etc. Il fait son entrée dans la dimension juridique à travers les premières constitutions modernes du XVIIIe siècle, qui se caractérisent par la reconnaissance de la centralité de l’individu et de ses droits fondamentaux : la Constitution corse de 1755 et les Déclarations des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 1793 font du bonheur une mission des pouvoirs publics, tandis que la Déclaration d’indépendance américaine de 1776 consacre le caractère inaliénable du droit à la recherche du bonheur.
De toute évidence, les formulations constitutionnelles du bonheur véhiculent « une vision idéalisée[2] » dans laquelle il apparaît comme « un absolu formel, […] soumis aux contingences de la réalité aussi bien qu’à la subjectivité des individus[3] » ; un absolu formel dont la véritable consistance juridique est difficilement discernable. En effet, d’un point de vue juridique conceptualiser le bonheur comme un droit subjectif fondamental et opposable semble insoutenable car ce dernier ne peut disposer d’aucun moyen pour garantir que son contenu puisse effectivement se concrétiser et qu’il puisse le faire de la même manière pour tous. Par conséquent, il faut se demander comment saisir la normativité exprimée par cette « idée neuve[4] », intrinsèquement liée à une dimension phénoménologique de l’existence humaine – être heureux – complexe et subjectivement différenciée ainsi qu’à la ratio essendi du constitutionnalisme moderne, c’est-à-dire le « rachat de l’humain[5] », la libre réalisation de ce dernier dans les domaines fondamentaux de l’existence.
À la lumière des principes et des valeurs – liberté, dignité, égalité, solidarité, etc. – structurant le tissu éthico-normatif de l’être en société considéré comme coessentiel à l’accès de tous à cette libre réalisation, dans l’évolution du constitutionnalisme moderne le ‘rachat de l’humain’ se traduit en l’affirmation progressive des droits et libertés fondamentaux (civils, politiques, sociaux, etc.) qui développent et approfondissent synergiquement[6] les dimensions normatives de la citoyenneté afin de mettre en place les conditions – matérielles, culturelles, politiques, etc. – nécessaires pour que chaque citoyen puisse rechercher son épanouissement indépendamment de sa provenance sociale, de sa richesse, de son appartenance ethnico-culturelle, etc. C’est ainsi que sont reconnues (en particulier dans les constitutions européennes de l’après Seconde Guerre mondiale) non seulement les libertés civiles et politiques fondamentales mais aussi le droit à l’éducation, à la sécurité sociale, au travail, à un revenu décent, à la santé, au logement, etc., c’est-à-dire un ensemble de droits-créances visant à inscrire les conditions de possibilité de l’autoréalisation dans la concrétude de l’action des institutions existantes. En ce sens, par le biais de ces droits, des dimensions de l’existence individuelle indispensables à toute recherche du bonheur acquièrent reconnaissance et consistance juridique et conduisent à l’élargissement des missions des pouvoirs publics, appelés désormais à intervenir au nom d’objectifs de justice sociale dans les domaines – comme les domaines économiques et sociaux – dont dépend la concrétisation de ces droits.
Au-delà de la présence/absence de son explicitation constitutionnelle, la dimension juridique et normative du bonheur peut ainsi être reconstruite à travers l’articulation des droits et libertés fondamentaux reconnus aux individus et que les institutions publiques s’engagent à garantir en tant qu’objectifs constitutionnels. De cette articulation, le droit au bonheur émerge « comme une revendication du plus sacro-saint des droits de la personnalité, celui d’être soi-même et d’être libre de réaliser ses ambitions[7] » ; il émerge donc moins comme un droit au bonheur que comme un droit à la poursuite du bonheur que les institutions publiques doivent rendre concrètement possible et qui devient pleinement intelligible par la lecture systématique et téléologique[8] des différentes formes de liberté et de droits constitutionnellement jugés nécessaires à cette poursuite. Sur la base du développement constitutionnel européen, il est possible de conférer à la normativité contenue dans la formule ‘droit au bonheur’ le statut d’ « intérêt constitutionnel[9] », résultant « de l’ensemble de […] droits constitutionnels de telle sorte qu’il est possible d’identifier des protections d’attentes[10] » générant pour l’État plusieurs obligations comportementales.
Le bonheur comme eudaimonia et la centralité de la dimension éthico-normative du travail
Cet intérêt constitutionnel pour le bonheur, centré sur la personne humaine et son épanouissement, peut être interprété comme la positivisation juridico-empirique, a-métaphysique, du concept aristotélicien d’eudaimonia. Dans l’Éthique[11], le bonheur « nécessite de cultiver et d’exercer certaines habiletés et capacités, notamment ce qu’Aristote appelle les vertus[12] ». Le bonheur dépend de la satisfaction extraite de l’exercice correct, continu et de plus en plus complexe de capacités innées et/ou acquises ; ces dernières deviennent des vertus 1) dans la mesure où elles permettent à l’individu de devenir capable dans le domaine concerné et d’être objectivement reconnu comme tel et 2) dans la mesure où elles permettent le « développement de caractéristiques (cognitives, sociales, morales, etc.) favorisant des actions satisfaisantes dans la vie en général[13] », susceptibles d’engendrer l’estime de soi.
Le travail peut être inclus dans les domaines dont dépend la réalisation concrète de cette manière de concevoir le bonheur, bien qu’Aristote ne le fasse pas[14]. En effet, le travail peut contribuer à donner corps au droit à la recherche du bonheur car dans le travail les individus peuvent exercer des activités suffisamment complexes et stimulantes pour développer des capacités, caractéristiques, etc. innées ou construites par l’exercice continu d’un travail et ainsi se développer et s’épanouir non seulement professionnellement, mais aussi dans les autres sphères de la vie par l’acquisition de qualités relationnelles, sociales, cognitives, etc. complexes et fondées sur une solide confiance en soi.
En ce sens, le développement du droit du travail constitue l’un des points normatifs clés des projets constitutionnels d’émancipation et de promotion de la personne humaine. Dans le développement moderne de nos sociétés, son articulation progressive au sein d’une organisation du travail principalement fordiste se déroule comme un « ensemble de normes ordonnatrices du travail salarié, par priorité […] ; et de normes qui […] tendent globalement à protéger le travailleur salarié en tant que partie faible au rapport avec son employeur[15] ». Le droit du travail – principalement à travers la forme standard du CDI à temps plein – est ainsi ce qui, dans la relation de travail, réduit la portée de l’exploitation économique en conférant au travailleur un status, un contre-pouvoir normatif qui se compose de droits et de garanties de stabilité visant à améliorer sa qualité de vie au sein et en dehors de la relation de travail. Ainsi, au-delà des configurations contingentes des rapports économiques de production à ordonner juridiquement de manière compatible avec la protection du travailleur, le droit du travail se fonde sur une base de valeurs autonome qui, renvoyant au projet constitutionnel de défense et promotion de la dignité et de la liberté de l’individu comme fin en soi, ne considère pas le travail uniquement « comme un bien d’échange ayant un prix de marché, mais aussi comme une manifestation de la personnalité du travailleur[16] », comme l’une des activités fondamentales de libre construction et expression de sa personnalité. Bien qu’au sein d’un rapport juridique, économique et organisationnel de subordination, la dimension éthico-normative qui fonde la préservation « de la dimension humaine de la prestation[17] » manifeste progressivement sa force émancipatrice – à travers les législations sociales, l’activité syndicale, les constitutionnalisations nationales et internationales des droits sociaux et du travail – conduisant à la structuration d’un concept de travail doté aussi « de caractéristiques étrangères au rapport d’échange et liées à des profils existentiels (liberté et dignité) qui impliquent des droits exprimant la personnalité humaine[18] » saisie dans la globalité de son parcours existentiel de construction et de réalisation de soi (eudaimonia). La fonction fondamentale du droit du travail est de rendre cette perspective axiologique compatible avec les objectifs économiques indissociables du rapport de travail ; en ce sens, « abandonner le terrain des valeurs et la perspective axiologique […] reviendrait à renoncer à l’autonomie du droit du travail[19] ».
Cette reconstruction conceptuelle permet de comprendre le lien entre le droit du travail et l’intérêt constitutionnel au bonheur et offre une perspective pour évaluer normativement les rapports existant entre la personne et le travail.
La crise du droit du travail
S’intéresser aux relations de travail actuelles revient à constater la régression des fondements axiologiques du droit du travail. Les causes – historiques, économiques, idéologiques, etc. – de cette régression font l’objet d’un vaste débat académique et dépassent le cadre de cet article. Le point qui nous intéresse est le consensus substantiel quant à la réduction significative de la capacité du droit du travail « à se confirmer comme modèle de réglementation guidé par une rationalité axiologique[20] » autonome : le processus de néolibéralisation de la société[21] intervenu au cours des dernières décennies et l’affirmation/diffusion conséquente de la primauté de la rationalité économico-concurrentielle semblent avoir transformé le droit du travail en « droit du marché du travail[22] », en un dispositif juridique dont la fonction n’est plus de rendre compatible la profondeur normative structurant la dimension humaine du travail avec les raisons économiques mais de se mettre au service de ces dernières. Dans un contexte marqué par une concurrence globale accrue, le droit du travail est appelé à reformuler ses catégories – formes contractuelles, modalités de licenciement, allocations chômage, négociations collectives, etc. – en fonction de l’objectif prioritaire d’adapter qualitativement et quantitativement la force et l’organisation du travail à la nécessité de dynamiser constamment le système économique afin de le rendre de plus en plus capable de répondre aux fluctuations du marché et d’améliorer constamment les performances économiques, soit au niveau macro[23] que micro[24].
Au centre de ce processus transformateur se trouve le principe de flexibilité. À cet égard, la théorisation par l’OCDE (1994) de l’indice de rigidité du marché du travail est emblématique : plus un marché du travail est rigide, c’est-à-dire qu’il offre un large éventail de protections aux travailleurs, moins il est performant sur le plan économique. Adoptée par de grandes institutions telles que la BCE, le FMI et la Commission européenne et conduisant à de nombreuses réformes nationales[25], cette approche contribue de manière décisive à la marginalisation progressive de l’autonomie normative exprimée par la structure axiologique du droit du travail. Elle s’impose de moins en moins comme instance réglementaire « sur les employeurs et les travailleurs en tant qu’employeurs et travailleurs[26] », c’est-à-dire à partir de l’asymétrie de pouvoir de négociation entre ces deux classes à combler en fonction de valeurs allant au-delà de la sphère économique, au profit d’ « une grande variété d’arrangements contractuels, conçus pour s’adapter aux circonstances particulières dans lesquelles ils sont conclus et façonnés par le rapport de force particulier entre les parties concernées[27] », ces dernières étant principalement considérées comme des entités singulières participant au marché au nom de leur propre intérêt individuel.
Redéfini par la pervasivité du principe de flexibilité, le droit du travail, en tant que régime juridique définissant et protégeant un status collectif dans lequel la dimension économique de la relation de travail doit être rendue compatible avec la centralité de la personne, « perd ses caractéristiques spéciales, devenant de plus en plus [semblable] au contrat de fourniture ou de service[28] », c’est-à-dire à une technicité normative à caractère économico-concurrentielle. L’adéquation fonctionnelle du droit du travail à la ratio du marché implique ainsi une reconfiguration de la manière de concevoir la personne au travail. La régression axiologique du droit du travail ne présuppose plus la défense de la centralité de la personne et de sa réalisation, mais plutôt un individu capable de sécuriser son parcours existentiel et professionnel grâce à sa capacité à s’adapter aux demandes oscillatoires du marché, c’est-à-dire à augmenter constamment son taux d’employabilité sur le marché en élargissant et en modelant sur celui-ci ses compétences, ses initiatives, ses choix, etc. L’économisation du droit du travail en fait ainsi un dispositif fonctionnel à la diffusion d’un « pression disciplinaire illimitée[29] » qui encapsule l’expérience professionnelle dans l’impératif marchand de l’employabilité. Dans ce cadre, le glissement conceptuel concernant la personne au travail résulte manifeste dans la traduction de valeurs telles que la liberté et la dignité du travailleur en « coûts de production[30] » à minimiser et de « l’ensemble des qualités individuelles théoriques et pratiques nécessaires à l’exécution de la prestation et à travers lesquelles s’exprime sa personnalité [en] un instrument de division du travail visant à maximiser l’efficacité organisationnelle[31] ». La recherche du bonheur au travail comme développement et réalisation personnels semble sortir du cadre des critères régissant la relation de travail, rendant manifeste la fragilisation de la normativité et de l’axiologie du projet constitutionnel moderne.
Le retrait progressif des composantes normatives du droit du travail irréductibles à la raison économico-concurrentielle et inhérentes à l’intérêt constitutionnel pour le bonheur alimente un vaste débat académique quant à la nécessité de récupérer et de réactualiser les fondements axiologiques du droit du travail afin de lui réattribuer sa fonction fondamentale, celle de fournir une rationalisation juridique des activités professionnelles qui ne se limite pas à défendre et à promouvoir les libertés économiques et les intérêts qui y sont liés mais aussi « le système de valeurs et de principes constitutionnels[32] » sous-tendant « la valorisation de la personne, de ses désirs de bonheur et de ses capacités[33] ». Sur le plan théorique, mener cette opération signifie ne pas réduire le droit du travail « à un simple produit des rapports de force économiques et sociaux changeants[34] », mais replacer le discours sur le droit du travail dans le cadre de l’élaboration d’une perspective philosophique plus large capable de proposer une « idée d’un droit du travail à même de produire libertas et non necessitas, liberté et non soumission à la domination[35] », des possibilités concrètes d’épanouissement et non de marchandisation ultérieure. Cet article vise à réaffirmer l’actualité de la force émancipatrice de la structure axiologique du droit du travail en proposant une perspective philosophico-normative dans laquelle l’idée du travail en tant qu’activité fondamentale pour la construction et la réalisation de soi se combine avec le principe hégélien/honnethien de la reconnaissance du sujet et de ses capacités. L’objectif est d’agir sur ce qui existe – une organisation du travail qui exige flexibilité et employabilité – de manière à élargir les marges de liberté du travail et de construire un concept juridique de professionnalité propice à la recherche du bonheur personnel.
La liberté sociale comme instance éthique fondamentale de la sphère économique
Hegel affirme que « le droit à la liberté subjective constitue le point critique et central dans la différence de l’antiquité et des temps modernes[36] ». Le droit à cette liberté – comme le montre l’évolution constitutionnelle européenne – se situe au centre de projets juridico-normatifs de plus en plus complexes dans lesquels il ne se développe pas seulement en termes négatifs, garanti par les droits individuels de non-interférence visant à protéger les libertés fondamentales et par la considération kantienne de chaque sujet comme sujet moral également digne et libre de s’autodéterminer ; il acquiert également un caractère positif dans la mesure où il « concerne les conditions et les relations objectives qui permettent la réalisation individuelle[37] » et que les institutions doivent garantir dans les différentes sphères de l’existence sociale. Ces dernières « possèdent une factualité morale[38] » historiquement déterminée et enracinée dans un horizon de valeurs reconnu et affirmé par la société en question comme centre normatif partagé – l’ ‘esprit objectif’ – auquel les institutions, au travers de leur action, doivent donner une réalité concrète.
La ‘société civile’ – la sphère économique et ses structures juridiques (donc aussi le droit du travail) – fait partie de l’appareil institutionnel appelé à assurer le respect de « certaines conditions normatives[39] », respect dont dépend sa capacité à se légitimer et à se perpétuer. Ces conditions normatives s’articulent autour d’une valeur éthique centrale, la ‘liberté sociale’, comprise comme le résultat concret que la praxis institutionnelle est censée produire. Cette forme de liberté exprime une disposition éthique précise des membres de la société civile selon laquelle chacun entend participer à cette dernière par sa « détermination individuelle, par son activité, son application et ses aptitudes [et ainsi être] reconnu aussi bien dans sa représentation que dans la représentation d’autrui[40] ». En participant aux activités économiques de la société civile, les sujets n’entendent pas seulement poursuivre leurs propres intérêts économiques, mais sont également porteurs d’une injonction normative complexe et partagée selon laquelle ils doivent pouvoir choisir librement comment contribuer à ces activités et doivent pouvoir se reconnaître mutuellement dans leurs qualités et objectifs spécifiques. La réalisation des attentes inscrites dans cette injonction normative est ce qui permet aux individus de « se concevoir comme des membres qui contribuent activement au bien commun, […] sans renoncer à leur autonomie individuelle, mais en la ressentant au contraire préservée et valorisée[41] ». La liberté sociale indique donc une conception intersubjective de la liberté fondée sur la « dépendance [de la personne] à l’égard de l’expérience de la reconnaissance[42] » ; ainsi, « les institutions économiques sont embedded dans un cadre de référence éthico-normatif[43] » qui leur impose comme nécessité d’autolégitimation celle de garantir les conditions de la réalisation de la personne humaine et de ses capacités ainsi que de leur reconnaissance.
La pensée hégélienne permet de ce fait d’identifier le droit du travail comme l’un des vecteurs de la réalisation subjective et de sa reconnaissance. Dans ses œuvres, Hegel reconnaît l’importance de situer dans le travail l’un des moments clés de ‘l’actualisation de l’esprit’ où le sujet ne parvient pas seulement à assurer sa propre subsistance matérielle, mais se voit également reconnu dans ses qualités spécifiques et comme participant à égalité aux activités par lesquelles la société satisfait les besoins de tous et garantit sa reproduction. Ainsi, le droit du travail fait partie intégrante des structures juridiques qui constituent et organisent le marché du travail comme institution économique dans laquelle les exigences d’efficacité et de profit sont surdéterminées par un projet juridico-normatif plus complexe visant à créer les conditions objectives pour la réalisation des individus dans un contexte solidaire de reconnaissance mutuelle. Les dispositifs dont dispose le droit du travail pour réguler les intérêts opposés au sein du conflit capital/travail sur la base de cet encadrement axiologique sont multiples : des droits tels que ceux de défense et d’amélioration des conditions salariales, de protection contre discriminations et abus, de négociation collective, de participation à la définition des modalités organisationnelles et des objectifs des entreprises, etc. peuvent être interprétés non seulement comme « droits subjectifs […] mais aussi comme droits de liberté sociale […] la liberté de créer ensemble une société plus juste et plus équitable […] basée sur la reconnaissance mutuelle des sujets[44] ».
La pensée hégélienne permet ainsi de lire les enjeux liés à la fonctionnalisation économique du droit du travail à partir des éléments éthico-normatifs qui informent la sphère économique et qui se reflètent – de manière toujours perfectible – dans « la constitutionnalisation des droits, de la personne, du travail[45] ». Il s’agit maintenant de les mobiliser pour repenser les catégories dominantes d’un droit du travail en crise à la lumière du bonheur comme intérêt constitutionnel : en effet, tout « discours métajuridique sur le travail libre est nécessairement aussi un discours juridique sur les formes historiques[46] », les catégories juridiques et les implications anthropologiques du travail et de son organisation.
Le travail comme das Tun et capture des potentialités émancipatrices de la flexibilité et l’employabilité
Face à l’aplatissement du droit du travail sur l’horizontalité de la logique économique, il s’agit d’en faire réémerger la profondeur normative et axiologique, interprétée de manière hegelienne à la fois comme paramètre de « justification des institutions existantes et comme standard critique à l’aune duquel les juger[47] ».
Il existe de nombreuses propositions académiques de réforme de l’organisation et des conditions de travail au sein du marché visant à accroître l’autonomie subjective et les formes de reconnaissance de l’individu. Afin d’apporter un complément original à ce débat, nous proposons de réfléchir à nouveau sur les fondements philosophiques et anthropologiques du concept de travail en tant que tel, au-delà de sa déclinaison productiviste/marchande. En ce sens, dans la pensée hegelienne le travail ne se réduit pas aux activités effectuées en relation avec la satisfaction des besoins, mais renvoie en premier lieu à un ‘faire’ fondamental (Tun) qui ne désigne pas une activité spécifique, mais un mode d’être du sujet qui est à la base de toute activité et par lequel, en participant concrètement à la production de la réalité effective, il affirme son existence et « devient pour lui-même ce qu’il est[48] », il s’auto-approprie. Le travail identifie la totalité des expressions des forces vitales du sujet par lesquelles ce dernier détermine sa particularité en agissant dans les différentes sphères sociales, institutionnelles, etc. qui composent la dimension historico-concrète de son existence en société. Révélateur des existences en soi des sujets et de leurs interactions, ce ‘faire’ se donne dialectiquement comme production, façonnement, transformation de la réalité historico-concrète par le biais d’un agĕre collectif dans lequel s’inscrit dans le même temps « le besoin primaire et profond de la personne[49] » de réaliser sa propre existence dans un horizon de sens consciemment voulu. Dans cette caractérisation du travail, la poursuite de « l’accomplissement réel de l’existence humaine[50] » qu’il rend possible est ainsi inséparablement liée à la production par la rencontre et l’articulation des agĕre individuels d’une réalité qui se donne par là même comme « système de dépendance réciproque qui fait que la subsistance, le bien-être et l’existence juridique de l’individu sont mêlés á la subsistance, au bien-être et à l’existence de tous […] et ne sont réels et assurés que dans cette liaison[51] ». C’est cette dialectique découlant du travail comme ‘faire’ fondamental qui informe normativement – par la disposition éthique susmentionnée – l’émergence « du travail […] de l’économie politique, de la production et de l’échange en tant qu’institutions sociogénétiques[52] » centrées sur la reconnaissance mutuelle et visant à satisfaire le besoin d’expression du sujet et de ses qualités. La pensée hegelienne permet ainsi de comprendre le travail comme un mode d’être qui ne se réduit pas à sa déclinaison économique mais implique l’interaction productive de réalité partagée entre des sujets saisis dans l’urgence existentielle de la réalisation de soi.
Dans cette perspective, une piste pour réactualiser la structure axiologique du droit du travail peut être l’élargissement du concept de travail et des modalités juridiques de sa reconnaissance à des activités qui ne relèvent pas de la production économique de marché mais qui constituent néanmoins des ressources de sens auxquelles les individus attribuent une valeur pertinente pour la réalisation de leur subjectivité et qui remplissent des fonctions fondamentales pour la société. À cet égard, Honneth élabore dans son dernier ouvrage[53] comme critère d’identification des activités pouvant être incluses dans le concept élargi de travail toutes les activités – matérielles, culturelles, sociales, etc. – qu’une collectivité spécifique considère comme nécessaires à la reproduction et à la réalisation des composantes fondamentales de son mode d’existence « en fonction des valeurs auxquelles elle adhère[54] ». Répondant à des intérêts communs situés en dehors du marché et que de nombreuses études identifient comme la satisfaction de « besoins non satisfaits dans le domaine de la culture, de l’éducation, du soin des personnes et du tissu social, et de la préservation de l’environnement et de la nature[55] » caractérisant les sociétés européennes actuelles, l’encadrement juridique de ces activités permettrait en même temps d’élargir les marges de réalisation subjective et de reconnaissance au travail car il permettrait aux individus d’accéder concrètement à un éventail de choix de détermination et de valorisation sociale de leur propre parcours de vie plus large que celui qui découle uniquement du marché. Cela permettrait de revigorer la fonction fondamentale du droit du travail, à savoir « la reconnaissance juridique […] de la personne du travailleur[56] » et de « valeurs non-marchandes[57] » comme contrepoids à la marchandisation du travail humain : face à l’élargissement actuel de la liberté du travail dans le sens de la déréglementation du marché du travail, cette opération offrirait l’alternative de resignifier la diversification/individualisation du statut juridique des travailleurs selon un concept de liberté du travail centré sur la valorisation « juridique [et anthropologique] […] du travail en soi[58] », c’est-à-dire d’un concept de travail comme faire fondamental par lequel les sujets se déterminent en fonction de leur particularité tout en coopérant pour façonner une réalité objective susceptible de permettre une telle auto-détermination.
Cette approche au travail non réductible à l’ « ontologie économiciste[59] » dominante poserait ainsi les bases philosophiques et anthropologiques d’une reformulation du droit du travail comme droit de la professionnalité[60] des individus organisé avant tout sur la centralité normative-constitutionnelle de la personne et de sa recherche du bonheur par le travail. Englobant non seulement les activités exercées sur le marché mais également « les activités d’intérêt collectif[61] » susmentionnées ainsi que les activités connectées à la formation, à la reconversion professionnelle et à la recherche d’emploi dans ces secteurs non-marchands, dans ce droit du travail reconceptualisé « l’insertion et le maintien dans la sphère du travail[62] » de l’individu ne serait plus justifiée uniquement par sa participation au marché mais par une perspective normative plus large axée sur une plus grande ‘liberté sociale’ du sujet de choisir comment contribuer à l’agĕre collectif et comment y être reconnu en fonction de la réalisation de ses capacités.
Cette opération permettrait ainsi de démarchandiser partiellement la flexibilité et l’employabilité requises par le fonctionnement actuel du marché, en faisant ressortir leurs éléments potentiellement émancipateurs. Pouvoir exercer une activité incluse dans le champ sémantique ainsi élargi du travail – c’est-à-dire à travers la reconnaissance et la valorisation juridique d’activités hors marché – permettrait au sujet de se ménager des espaces de liberté concrète puisqu’il lui donnerait un plus grand pouvoir de déterminer, selon sa propre volonté, les transitions toujours plus nombreuses dictées par la flexibilisation du marché du travail. Dans ce cadre, par rapport à l’encadrement juridique statique du travail dans les structures productives du capitalisme réalisé par le droit du travail classique, la flexibilité pourrait se présenter comme un régime juridique moins subi et plus agi et comme un instrument permettant de favoriser des transitions juridiquement protégées de secteurs productifs vers des secteurs répondant à d’autres ordres de valeurs. En ce sens, elle pourrait agir comme operateur de réactualisation émancipatrice du droit du travail en réorganisant son objet d’étude à partir de la recomposition sur un plan unitaire des activités – productives et reproductives, économiques et sociales, etc. – à travers lesquelles les individus poursuivent leur propre réalisation et de réintroduire des vecteurs de démarchandisation centraux pour la réactivation de la structure axiologique du droit du travail. Le concept même d’employabilité ne renverrait plus seulement à la marchandisation des qualités du sujet, mais aussi à l’extension, au-delà de la sphère économique, des possibilités de choix offertes au sujet pour construire sa professionnalité et rechercher ainsi le bonheur au travail par la réalisation et la reconnaissance de ses qualités. Dans ce contexte, l’impératif de ‘se rendre employable’ élargirait son champ sémantique en direction d’aspirations à la réalisation personnelle plus centrées sur la personne du travailleur et son autonomie et tracerait ainsi de nouvelles voies de connexion avec les instances normatives composant la structure axiologique du droit du travail ; en réduisant l’emprise du marché sur les choix individuels, cette employabilité réduirait également « la vulnérabilité individuelle et collective à l’aléa[63] » renforçant non seulement la fonction promotionnelle du droit du travail mais aussi sa fonction protectrice.
Conclusion. Vers une ‘garantie de l’être de la personne’
Suivant Hegel, « la modernité présente une normativité sociale intrinsèque de la sphère économique[64] ». Dans cet article, la mobilisation de la théorie hegelienne de la liberté sociale et du travail comme das tun entend ouvrir une piste « pour repenser à la fois le champ de la domination économique à la lumière de ses prérequis moraux […] et la structure institutionnelle et juridique du marché du travail[65] » afin de réactualiser « le projet normatif du droit du travail en promouvant une revisitation du paradigme classique[66] ».
Le droit du travail classique se caractérise par « une forte orientation vers l’avoir[67] » : le sujet, en travaillant, entre en possession d’une « garantie de stabilité […] qui peut également être exprimée en termes de property jobs[68] ». Au contraire, repenser le droit du travail à partir du concept de travail comme ‘faire fondamental’ qui relève constitutivement de l’existence de la personne, et donc en élargissant au-delà du marché la sémantique du travail juridiquement reconnaissable et des droits de protection et promotion sociales qui en découleraient, signifierait offrir un vecteur de réorientation de « sa valeur axiologique et prescriptive vers l’être, c’est-à-dire vers les personnes[69] », signifierait ouvrir une perspective de renouvellement de sa fonction constitutionnelle basée sur le passage de la property in job à la « garantie de l’être[70] » de la personne. Cette garantie de l’être de la personne pourrait constituer un facteur important de concrétisation de l’ ‘intérêt constitutionnel au bonheur’, compris dans ce domaine comme le résultat de la combinaison de l’eudaimonia et de la reconnaissance[71].
Dans cette combinaison, la recherche du bonheur au travail ne réside pas seulement dans la réalisation et la reconnaissance du sujet et de ses qualités ; pour faire de ce « bien une réalité concrète et vivante[72] » il est nécessaire de préserver et de renouveler constamment la tension transformatrice inscrite dans l’injonction éthico-normative dont la personne au travail est porteuse et qui pousse à la création d’ « une société plus juste et plus rationnelle, une société qui assure la liberté et la réalisation de tous[73] ». De ce fait, le bonheur, bien qu’il ne puisse être considéré comme une idée neuve, maintient tout son potentiel transformateur, toute son actualité.
[1] Marius Andreescu, Andra Puran, « From ontological happiness to the right to happiness », Conference paper, Supplement of Valahia University, Bibliotheca Târgovişte, 2024, p. 53-72.
[1] Marius Andreescu, Andra Puran, « From ontological happiness to the right to happiness », Conference paper, Supplement of Valahia University, Bibliotheca Târgovişte, 2024, p. 53-72.
[2] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », Aux confins du droit...
[2] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », Aux confins du droit : Mélanges-Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ, 2015, p. 271-284.
[3] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Discours du 3 mars 1794, Convention au nom du Comité de salut public.
[4] Discours du 3 mars 1794, Convention au nom du Comité de salut public.
[5] Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Rome-Bari, Laterza, 2012, 142.
[5] Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Rome-Bari, Laterza, 2012, 142.
[6] Voir Thomas H. Marshall, Citizenship and Social Class : And Other Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1950.
[6] Voir Thomas H. Marshall, Citizenship and Social Class : And Other Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1950.
[7] Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », Diritto e Religioni, n. 1, 2021, p. 461-483.
[7] Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », Diritto e Religioni, n. 1, 2021, p. 461-483.
[8] Voir Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », art. cit.
[8] Voir Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », art. cit.
[9] Gladio Gemma, « Esiste un diritto costituzionale alla felicità ? »...
[9] Gladio Gemma, « Esiste un diritto costituzionale alla felicità ? », AFDUC, n. 12, 2008, p. 519-531.
[10] Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », art. cit.
[10] Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », art. cit.
[11] Aristote, Éthique de Nicomaque,...
[11] Aristote, Éthique de Nicomaque, Paris, Flammarion, 2004.
[12] Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », in Christiana Bagusat, William J. F. Keenan, Clemens Sedmak (dir.), Decent Work and Unemployment, Londres, LIT Verlag, p. 203-216.
[12] Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », in Christiana Bagusat, William J. F. Keenan, Clemens Sedmak (dir.), Decent Work and Unemployment, Londres, LIT Verlag, p. 203-216.
[13] Ibid.
[13] Ibid.
[14] Son refus repose sur sa distinction entre praxis et poïesis, c'est-à-dire entre les activités productives dont le but est extérieur à l'activité elle-même - c'est le cas du travail - et les activités dont le but est interne.
[14] Son refus repose sur sa distinction entre praxis et poïesis, c'est-à-dire entre les activités productives dont le but est extérieur à l'activité elle-même - c'est le cas du travail - et les activités dont le but est interne.
[15] Antoine Jeammaud, « Le droit du travail dans le capitalisme, question de fonctions et de fonctionnement », Biblioteca ‘20 Maggio’, n. 2, 2005, p. 203-223.
[15] Antoine Jeammaud, « Le droit du travail dans le capitalisme, question de fonctions et de fonctionnement », Biblioteca ‘20 Maggio’, n. 2, 2005, p. 203-223.
[16] Luigi Mengoni, Il lavoro nella dottrina sociale della chiesa, Milan, V&P, 2004, p. 23.
[16] Luigi Mengoni, Il lavoro nella dottrina sociale della chiesa, Milan, V&P, 2004, p. 23.
[17] Ibid., p. 52.
[17] Ibid., p. 52.
[18] Valerio Speziale, « La mutazione genetica del diritto del lavoro », Biblioteca ‘20 Maggio’, n. 1, 2017, 112-160.
[18] Valerio Speziale, « La mutazione genetica del diritto del lavoro », Biblioteca ‘20 Maggio’, n. 1, 2017, 112-160.
[19] Giorgio Fontana, « Il diritto del lavoro e i valori nella crisi », in Valori e tecniche nel diritto del lavoro, Riccardo del Punta (dir.), Florence, Firenze University Press, 2022, p. 93.
[19] Giorgio Fontana, « Il diritto del lavoro e i valori nella crisi », in Valori e tecniche nel diritto del lavoro, Riccardo del Punta (dir.), Florence, Firenze University Press, 2022, p. 93.
[20] Adalberto Perulli, « Per una filosofia...
[20] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », Lavoro e Diritto, année XXXIV, n. 4, 2020, p. 773-811.
[21] Voir Pierre Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris, 2016.
[21] Voir Pierre Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris, 2016.
[22] Ruth Duke, The Labour Constitution : The Enduring Idea of Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2014.
[22] Ruth Duke, The Labour Constitution : The Enduring Idea of Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2014.
[23] En matière de distribution ...
[23] En matière de distribution des revenus, d'inflation, de PIB, de consommation, de fiscalité, etc.
[24] En matière de coûts de production pour les entreprises, d'organisation du travail, de compétitivité, etc.
[24] En matière de coûts de production pour les entreprises, d'organisation du travail, de compétitivité, etc.
[25] Voir les réformes Harz en Allemagne, la Loi Travail en France, le Jobs Act en Italie, etc.
[25] Voir les réformes Harz en Allemagne, la Loi Travail en France, le Jobs Act en Italie, etc.
[26] Ruth Dukes, Wolfgang Streeck, Democracy at Work. Contract, Status and Post-Industrial Justice, Polity Press, Cambridge, 2023, p. 59.
[26] Ruth Dukes, Wolfgang Streeck, Democracy at Work. Contract, Status and Post-Industrial Justice, Polity Press, Cambridge, 2023, p. 59.
[27] Ibid., p. 63.
[27] Ibid., p. 63.
[28] Ibid., p. 61.
[28] Ibid., p. 61.
[29] Pierre Dardot, Christian Laval, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, ...
[29] Pierre Dardot, Christian Laval, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, 2016, p. 87-88.
[30] Valerio Speziale, « La mutazione genetica del diritto del lavoro », art. cit.
[30] Valerio Speziale, « La mutazione genetica del diritto del lavoro », art. cit.
[31] Ibid.
[31] Ibid.
[32] Michele Tiraboschi, Persona e...
[32] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra tutele e mercato, Rome, ADAPT University Press, 2019, p. 34.
[33] Ibid., p. 46.
[33] Ibid., p. 46.
[34] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[34] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[35] Ibid.
[35] Ibid.
[36] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1940, p. 145.
[36] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1940, p. 145.
[37] Adalberto Perulli, « Per una filosofia...
[37] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[38] Axel Honneth, Le droit de la liberté. Esquisse d’une éthicité démocratique, Paris, Gallimard, 2015, p. 17.
[38] Axel Honneth, Le droit de la liberté. Esquisse d’une éthicité démocratique, Paris, Gallimard, 2015, p. 17.
[39] Axel Honneth, Capitalismo e riconoscimento, M. Solinas (dir.), Florence, Firenze University Press, 2010, ed. dig., 28%.
[39] Axel Honneth, Capitalismo e riconoscimento, M. Solinas (dir.), Florence, Firenze University Press, 2010, ed. dig., 28%.
[40] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., p. 219.
[40] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., p. 219.
[41] Armando Manchisi, « The Logic of ...
[41] Armando Manchisi, « The Logic of Self-Realization in Hegel’s Philosophy of Right », Studia Hegeliana, vol. VIII, 2022, pp. 211-222.
[42] Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », op. cit.
[42] Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », op. cit.
[43] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[43] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[44] Ibid.
[44] Ibid.
[45] Laura Pennacchi, De valoribus disputandum est. Sui valori dopo il neoliberismo, Milan, Mimesis, 2019, p. 162.
[45] Laura Pennacchi, De valoribus disputandum est. Sui valori dopo il neoliberismo, Milan, Mimesis, 2019, p. 162.
[46] Vincenzo Bavaro, « Su lavoro e libertà. Appunti per una critica del diritto su quattro preposizioni », in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (dir.), Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta, Florence, Firenze University Press, 2024, p. 111-130.
[46] Vincenzo Bavaro, « Su lavoro e libertà. Appunti per una critica del diritto su quattro preposizioni », in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (dir.), Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta, Florence, Firenze University Press, 2024, p. 111-130.
[47] Wilhelm F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Florence, La Nuova Italia, 1970, p. 148.
[47] Wilhelm F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Florence, La Nuova Italia, 1970, p. 148.
[48] Herbert Marcuse, « On the philosophical foundation of the concept of labour in economics », Telos, n. 16,1965, p. 9-37.
[48] Herbert Marcuse, « On the philosophical foundation of the concept of labour in economics », Telos, n. 16,1965, p. 9-37.
[49] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra...
[49] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra tutele e mercato, op. cit., p. 195.
[50] Herbert Marcuse, « On the philosophical foundation of the concept of labour in economics », art. cit.
[50] Herbert Marcuse, « On the philosophical foundation of the concept of labour in economics », art. cit.
[51] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., p. 203.
[51] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., p. 203.
[52] Geminello Preterossi, « Il lavoro della superiore liberazione. A partire dall’antropologia del lavoro in Hegel », Filosofia politica, n.3, 2021, p. 393-410.
[52] Geminello Preterossi, « Il lavoro della superiore liberazione. A partire dall’antropologia del lavoro in Hegel », Filosofia politica, n.3, 2021, p. 393-410.
[53] Axel Honneth, Le Souverain Laborieux. Une théorie normative du travail, Paris, Gallimard, 2024, p. 78.
[53] Axel Honneth, Le Souverain Laborieux. Une théorie normative du travail, Paris, Gallimard, 2024, p. 78.
[54] Ibid., p. 81.
[54] Ibid., p. 81.
[55] Giorgio Lunghini, L’età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali, Turin, Bollati Boringhieri, 1995, p. 15.
[55] Giorgio Lunghini, L’età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali, Turin, Bollati Boringhieri, 1995, p. 15.
[56] Alain Supiot, Critique du droit du travail...
[56] Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2011, Concl., par. 1.
[57] Ibid.
[57] Ibid.
[58] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico, op. cit., p. 167.
[58] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico, op. cit., p. 167.
[59] Ibid., p. 188.
[59] Ibid., p. 188.
[60] Formulation et élaboration que j'emprunte aux textes d'A. Supiot.
[60] Formulation et élaboration que j'emprunte aux textes d'A. Supiot.
[61] Alain Supiot, Il futuro del lavoro. Trasformazioni dell’occupazione e prospettive della regolazione del lavoro, Rome, Carocci, 2003, p. 90.
[61] Alain Supiot, Il futuro del lavoro. Trasformazioni dell’occupazione e prospettive della regolazione del lavoro, Rome, Carocci, 2003, p. 90.
[62] Alain Supiot, Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris, Flammarion, 1999, cha. 7, par. 35.
[62] Alain Supiot, Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris, Flammarion, 1999, cha. 7, par. 35.
[63] Ibid., par. 42.
[63] Ibid., par. 42.
[64] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[64] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[65] Ibid.
[65] Ibid.
[66] Ibid.
[66] Ibid.
[67] Antonio Cantaro, Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea, Rome, Ediesse, 2006, 90.
[67] Antonio Cantaro, Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea, Rome, Ediesse, 2006, 90.
[68] Massimo D’Antona, «Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comunitario», Rivista giuridica del lavoro, n. 3, 1999, 9-24
[68] Massimo D’Antona, «Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comunitario», Rivista giuridica del lavoro, n. 3, 1999, 9-24
[69] Ibid.
[69] Ibid.
[70] Ibid.
[70] Ibid.
[71] À ce propos, voir encore Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », in Christiana Bagusat, William J. F. Keenan, Clemens Sedmak (dir.),....
[71] À ce propos, voir encore Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », in Christiana Bagusat, William J. F. Keenan, Clemens Sedmak (dir.), Decent Work and Unemployment, Londres, LIT Verlag, p. 203-216.
[72] Armando Manchisi, « The Logic of Self-Realization in Hegel’s Philosophy of Right », art. cit.
[72] Armando Manchisi, « The Logic of Self-Realization in Hegel’s Philosophy of Right », art. cit.
[73] Ibid.
[73] Ibid.
[1] Marius Andreescu, Andra Puran, « From ontological happiness to the right to happiness », Conference paper, Supplement of Valahia University, Bibliotheca Târgovişte, 2024, p. 53-72.
[2] Félicien Lemaire, « Le bonheur, un principe constitutionnel ? », Aux confins du droit : Mélanges-Hommage amical à Xavier Martin, Presses universitaires juridiques de Poitiers, LGDJ, 2015, p. 271-284.
[3] Ibid.
[4] Discours du 3 mars 1794, Convention au nom du Comité de salut public.
[5] Stefano Rodotà, Il diritto di avere diritti, Rome-Bari, Laterza, 2012, 142.
[6] Voir Thomas H. Marshall, Citizenship and Social Class : And Other Essays, Cambridge, Cambridge University Press, 1950.
[7] Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », Diritto e Religioni, n. 1, 2021, p. 461-483.
[8] Voir Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », art. cit.
[9] Gladio Gemma, « Esiste un diritto costituzionale alla felicità ? », AFDUC, n. 12, 2008, p. 519-531.
[10] Raffaella Losurdo, « Il diritto alla felicità tra valori costituzionali e religiosi », art. cit.
[11] Aristote, Éthique de Nicomaque, Paris, Flammarion, 2004.
[12] Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », in Christiana Bagusat, William J. F. Keenan, Clemens Sedmak (dir.), Decent Work and Unemployment, Londres, LIT Verlag, p. 203-216.
[13] Ibid.
[14] Son refus repose sur sa distinction entre praxis et poïesis, c’est-à-dire entre les activités productives dont le but est extérieur à l’activité elle-même – c’est le cas du travail – et les activités dont le but est interne.
[15] Antoine Jeammaud, « Le droit du travail dans le capitalisme, question de fonctions et de fonctionnement », Biblioteca ‘20 Maggio’, n. 2, 2005, p. 203-223.
[16] Luigi Mengoni, Il lavoro nella dottrina sociale della chiesa, Milan, V&P, 2004, p. 23.
[17] Ibid., p. 52.
[18] Valerio Speziale, « La mutazione genetica del diritto del lavoro », Biblioteca ‘20 Maggio’, n. 1, 2017, 112-160.
[19] Giorgio Fontana, « Il diritto del lavoro e i valori nella crisi », in Valori e tecniche nel diritto del lavoro, Riccardo del Punta (dir.), Florence, Firenze University Press, 2022, p. 93.
[20] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », Lavoro e Diritto, année XXXIV, n. 4, 2020, p. 773-811.
[21] Voir Pierre Dardot, Christian Laval, La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La Découverte, Paris, 2016.
[22] Ruth Duke, The Labour Constitution : The Enduring Idea of Labour Law, Oxford, Oxford University Press, 2014.
[23] En matière de distribution des revenus, d’inflation, de PIB, de consommation, de fiscalité, etc.
[24] En matière de coûts de production pour les entreprises, d’organisation du travail, de compétitivité, etc.
[25] Voir les réformes Harz en Allemagne, la Loi Travail en France, le Jobs Act en Italie, etc.
[26] Ruth Dukes, Wolfgang Streeck, Democracy at Work. Contract, Status and Post-Industrial Justice, Polity Press, Cambridge, 2023, p. 59.
[27] Ibid., p. 63.
[28] Ibid., p. 61.
[29] Pierre Dardot, Christian Laval, Ce cauchemar qui n’en finit pas. Comment le néolibéralisme défait la démocratie, Paris, La Découverte, 2016, p. 87-88.
[30] Valerio Speziale, « La mutazione genetica del diritto del lavoro », art. cit.
[31] Ibid.
[32] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra tutele e mercato, Rome, ADAPT University Press, 2019, p. 34.
[33] Ibid., p. 46.
[34] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[35] Ibid.
[36] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, Paris, Gallimard, 1940, p. 145.
[37] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[38] Axel Honneth, Le droit de la liberté. Esquisse d’une éthicité démocratique, Paris, Gallimard, 2015, p. 17.
[39] Axel Honneth, Capitalismo e riconoscimento, M. Solinas (dir.), Florence, Firenze University Press, 2010, ed. dig., 28%.
[40] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., p. 219.
[41] Armando Manchisi, « The Logic of Self-Realization in Hegel’s Philosophy of Right », Studia Hegeliana, vol. VIII, 2022, pp. 211-222.
[42] Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », op. cit.
[43] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[44] Ibid.
[45] Laura Pennacchi, De valoribus disputandum est. Sui valori dopo il neoliberismo, Milan, Mimesis, 2019, p. 162.
[46] Vincenzo Bavaro, « Su lavoro e libertà. Appunti per una critica del diritto su quattro preposizioni », in William Chiaromonte, Maria Luisa Vallauri (dir.), Trasformazioni, valori e regole del lavoro. Scritti per Riccardo Del Punta, Florence, Firenze University Press, 2024, p. 111-130.
[47] Wilhelm F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, Florence, La Nuova Italia, 1970, p. 148.
[48] Herbert Marcuse, « On the philosophical foundation of the concept of labour in economics », Telos, n. 16,1965, p. 9-37.
[49] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra tutele e mercato, op. cit., p. 195.
[50] Herbert Marcuse, « On the philosophical foundation of the concept of labour in economics », art. cit.
[51] Wilhelm F. Hegel, Principes de la philosophie du droit, op. cit., p. 203.
[52] Geminello Preterossi, « Il lavoro della superiore liberazione. A partire dall’antropologia del lavoro in Hegel », Filosofia politica, n.3, 2021, p. 393-410.
[53] Axel Honneth, Le Souverain Laborieux. Une théorie normative du travail, Paris, Gallimard, 2024, p. 78.
[54] Ibid., p. 81.
[55] Giorgio Lunghini, L’età dello spreco. Disoccupazione e bisogni sociali, Turin, Bollati Boringhieri, 1995, p. 15.
[56] Alain Supiot, Critique du droit du travail, Paris, PUF, 2011, Concl., par. 1.
[57] Ibid.
[58] Michele Tiraboschi, Persona e lavoro fra tutele e mercato. Per una nuova ontologia del lavoro nel discorso giuslavoristico, op. cit., p. 167.
[59] Ibid., p. 188.
[60] Formulation et élaboration que j’emprunte aux textes d’A. Supiot.
[61] Alain Supiot, Il futuro del lavoro. Trasformazioni dell’occupazione e prospettive della regolazione del lavoro, Rome, Carocci, 2003, p. 90.
[62] Alain Supiot, Au-delà de l’emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Paris, Flammarion, 1999, cha. 7, par. 35.
[63] Ibid., par. 42.
[64] Adalberto Perulli, « Per una filosofia politica del diritto del lavoro : neo-repubblicanesimo e libertà sociale », art. cit.
[65] Ibid.
[66] Ibid.
[67] Antonio Cantaro, Il diritto dimenticato. Il lavoro nella costituzione europea, Rome, Ediesse, 2006, 90.
[68] Massimo D’Antona, «Il diritto al lavoro nella Costituzione e nell’ordinamento comunitario», Rivista giuridica del lavoro, n. 3, 1999, 9-24
[69] Ibid.
[70] Ibid.
[71] À ce propos, voir encore Dale Tweedie, « Recognising Skills and Capacities », in Christiana Bagusat, William J. F. Keenan, Clemens Sedmak (dir.), Decent Work and Unemployment, Londres, LIT Verlag, p. 203-216.
[72] Armando Manchisi, « The Logic of Self-Realization in Hegel’s Philosophy of Right », art. cit.
[73] Ibid.