L’épopée du film Napoléon vu par Abel Gance
David Chanteranne
Napoléon reste un personnage à part de l’histoire. Par son irrésistible ascension puis sa chute, il a connu une destinée hors du commun.
Héros aux plus de mille films[1], il bénéficie dans cette immense série d’une pléiade d’interprètes les plus étonnants et différents, de Charles Vanel à Joaquin Phoenix, en passant par Émile Drain, Marlon Brando, Rod Steiger, Christian Clavier ou Philippe Torreton[2]. Mais celui qui continue, dans l’imaginaire collectif, à incarner le général puis l’Empereur comme personne reste à n’en pas douter Albert Dieudonné.
Le 7 avril 1927, au moment de la présentation du film d’Abel Gance à la première de l’Opéra, il crève l’écran, dans des scènes hypnotiques[3]. Après la bataille de boules de neige (où Napoléon est interprété par le jeune Vladimir Roudenko), on retrouve Dieudonné en jeune officier à Paris au temps de la Révolution, puis à Toulon et en Italie. Entre-temps, les visites en Corse et la rencontre de Joséphine apportent une note intimiste à un contexte révolutionnaire particulièrement enflammé.
La narration débute en Champagne, à Brienne-le-Château, dans le collège royal militaire. Les premières images permettent de rappeler les humiliations subies par le jeune insulaire et les inimitiés de certains camarades. Elles démontrent aussi la force de caractère du jeune adolescent qui parvient à s’imposer face à l’adversité, en particulier lors de violentes bagarres dans la cour enneigée ou le dortoir.
Au temps de la Révolution, après avoir assisté à la première de la Marseillaise au couvent des Cordeliers, Bonaparte comprend que les massacres perpétrés et les dissensions à la Convention entre Robespierre, Danton et Marat (joué par Antonin Artaud) nécessitent une reprise en main. Saint-Just (interprété par Gance lui-même) prend aussi toute sa part au drame. L’histoire qui s’écrit attend un sauveur et Napoléon devine que son « aigle », qui l’avait accompagné à Brienne, sera sa bonne étoile et veillera sur lui à chaque moment important de son parcours. L’heure de s’emparer du pouvoir n’est pas encore venue.
Rentré à Ajaccio, il retrouve sa mère entourée de sa fratrie. Dans le reste de l’île, il n’est pas accueilli comme il l’imaginait, comprenant que Pascal Paoli et Pozzo di Borgo cherchent à négocier une alliance avec l’Angleterre au détriment de la France républicaine dont il est l’un des représentants. L’opposition est frontale. Après avoir pris la mesure de la situation, le départ est inéluctable. Après une épique poursuite à cheval, qui offre un tableau saisissant et criant de réalisme, Napoléon parvient alors à échapper à ses poursuivants en prenant une barque salvatrice, dont la voile est en réalité le drapeau tricolore subtilisé avant de quitter l’île. Le film est ensuite rythmé par trois grandes séquences militaires.
Nommé à Toulon, Napoléon parvient à appliquer sa stratégie en utilisant la puissance de feu de l’artillerie. Il repousse l’adversaire britannique qui s’est emparé de la ville.
Rentré à Paris après avoir été mis aux arrêts pour sa proximité avec les jacobins, il se met au service du Directoire et mate le soulèvement royaliste devant l’église Saint-Roch en vendémiaire. Une rencontre change alors sa vie : il tombe sous le charme de la veuve Beauharnais qui avait été emprisonnée aux Carmes, puis l’épouse avant de prendre la tête de l’armée d’Italie.
Au milieu de généraux plus expérimentés, il impose ses vues, donne ses ordres et parvient à galvaniser des troupes qui manquaient cruellement de discipline et de moyens. Le film s’achève par des vues prophétiques sur la victoire dans les plaines italiennes.
Prévu à l’origine en six voire huit épisodes, le projet d’Abel Gance n’aura finalement que deux autres avatars, le premier avec l’adaptation du scénario de Sainte-Hélène par Lupu-Pick dès 1929 puis à travers son propre Austerlitz de 1960 avec dans le rôle principal Pierre Mondy[4].
Mais cette épopée cinématographique d’Abel Gance, envisagée comme une réponse française à la Naissance d’une nation de Griffith, vaut essentiellement pour les inventions du premier opus : triple écran, superpositions d’images, caméras embarquées à dos de cheval ou sur des balançoires, le tout accompagné de la musique envoûtante d’Arthur Honegger… On imagine ce que le spectateur aurait pu découvrir si les quelques rares images en couleur, prévues pour le départ de la campagne en Italie, avaient été projetées…
Autre intuition géniale : le réalisateur avait prévu l’arrivée du parlant, faisant articuler tous ses acteurs pendant le tournage du film muet, à commencer par Albert Dieudonné. Aussi, dès l’arrivée du son, il lui aura suffi d’ajouter en postsynchronisation les dialogues, ce qui permit au film de connaître en 1935 une seconde jeunesse, avec plusieurs scènes complémentaires.
Malgré cette version sonore, la première édition reste la plus homogène de toutes. Les quelque sept heures et vingt-sept minutes présentées à la presse en mai 1927, dites version longue Apollo, s’apprêtent ainsi à être remontées et, après une ultime restauration, seront de nouveau projetées lors de deux séances en juillet 2024 à la Seine musicale.
Malgré le nombre pléthorique de films plus récents, le film d’Abel Gance demeure à n’en pas douter un chef-d’œuvre. En cette année du 220e anniversaire du sacre, le réalisateur conserve la stature de « commandeur » du 7e art napoléonien qu’il avait tant espérée[5].
Page 1
[1] Hervé Dumont, Napoléon, l’épopée en 1000 films, Lausanne, Cinémathèque suisse / Ides et Caldendes, 2015.
[2] David Chanteranne et Isabelle Veyrat-Masson, Napoléon à l’écran. Cinéma et télévision, Paris, Nouveau Monde Éditions / Fondation Napoléon, 2003.
[3] Kevin Brownlow, Napoléon. Le grand classique d’Abel Gance, Paris, Armand Colin, 2012.
[4] Jean Tulard (dir.), Dictionnaire Napoléon, Paris, Fayard, 1987.
[5] Jean-Pierre Mattei, Napoléon et le cinéma, un siècle d’images, Ajaccio, Alain Piazzola, 2004.
D'autres articles
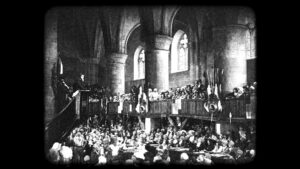
La « séquence Corse » du film Napoléon vu par Abel Gance
Napoléon cumule la particularité d’être un personnage historique exceptionnel devenu un mythe universel toujours actif, capable de susciter de grandes images collectives et d’intenses mythologies personnelles ; il ne pouvait devenir qu’un sujet de choix pour l’art cinématographique. Ainsi, occupe-t-il la première place des personnages…

Napoléon et Paoli
On a souvent l’habitude d’opposer Napoléon et Pascal Paoli. C’est une erreur. Napoléon est né en 1769. Son père Charles Bonaparte en 1746. Et la grand-mère de l’Empereur, née Pietrasanta[1], veuve Ramolino, puis veuve Fesch, est née à Ajaccio le 26 octobre 1725, c’est-à-dire après la naissance de Paoli à Morosaglia, le vendredi 6 avril 1725…
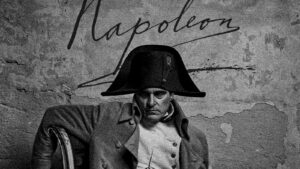
Abel Gance et Ridley Scott
La fiction historique, qu’elle soit écrite ou filmée, a plus d’un point commun avec l’art de la traduction. Comme une traduction, elle ne peut jamais être entièrement fidèle à la source originale. Dans les deux cas, la licence artistique est une nécessité, pas une option. Mais la nature et l’étendue de la licence artistique peuvent énormément varier. Il existe de…




