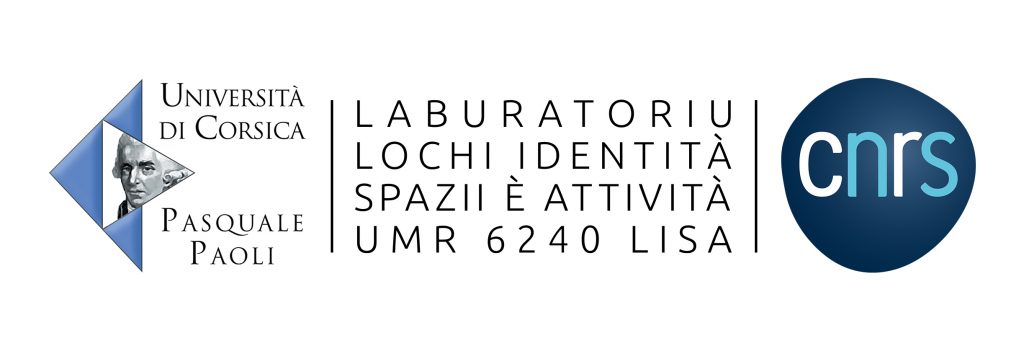M. Thierry DOMINICI (Université de Bordeaux),
Ma question concerne tout ce que vous avez développé, ainsi que vos travaux. S’agissant aujourd’hui de cette idée de « décoloniser la mémoire » – parce que je sais que vous participez à ce travail –, finalement, ce travail de décolonisation de la mémoire ne devrait-il pas vraiment fonctionner des deux côtés ? Le problème, c’est que lorsqu’on pense à la décolonisation de la mémoire, on se met côté colonisé. Mais, ayant lu vos travaux, je crois que ça devrait se passer des deux côtés, c’est à dire un travail du colonisateur vers le colonisé et du colonisé vers le colonisateur. Pour que l’État, je dirais, en place, sorte de cette idée d’État colonial par rapport au colonisé. C’est ça ma question, monsieur Stora. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire de plus ? Parce que vous ne l’avez pas abordé et je sais que ça fait partie de cette idée de « décolonisation de la mémoire ». Je vous remercie.
M. Benjamin STORA,
Oui. C’est une question, très importante et compliquée. Il y a deux attitudes possibles par rapport à ce qu’on a appelé « la décolonisation de la mémoire ». La première, ce serait de dire qu’il suffirait que le chef de l’État français prononce un seul discours, dise « Nous avons été des colonisateurs injustes. Et nous présentons nos excuses ». Et puis c’est fini. La messe est dite, la chose est réglée. La France reconnaît les erreurs graves et impardonnables qu’elle a commises. C’est une première solution, une possibilité qui m’a été proposée lorsque j’ai rédigé, par exemple, mon rapport. Ce rapport établissait qu’il fallait parvenir, bien sûr, à la reconnaissance de toutes les tragédies vécues – ça je l’ai écrit –, mais de manière plus élaborée. Il est difficile par un seul discours, par un seul acte – je parle de la France –, de régler la question coloniale qui a duré plusieurs siècles. Au cours des siècles passés, cette question de la colonisation a pénétré profondément les imaginaires dans la société française.
Tout un travail de pédagogie doit être engagé, un travail d’identification possible à travers des objets, des personnages, des dates, des commémorations. Un travail qu’il faut commencer pour mettre en œuvre, aborder le problème de la décolonisation mémorielle. C’est ma démarche : par exemple, dans le fait que la France reconnaisse l’assassinat de dirigeants nationalistes algériens comme Ali Boumendjel, érige une statue à Amboise à la mémoire de l’émir Abd el-Kader où il a été retenu captif, ouvre plus largement ses archives, transforme les programmes de l’Education nationale – ce qui doit se faire d’ailleurs, par des propositions de sujets pour le baccalauréat, au concours d’agrégation. C’est une mise en branle de tout un dispositif pédagogique et culturel pour traiter de la question coloniale, et donc se situer dans un mouvement pratique de décolonisation mémorielle, et non pas simplement dans un discours de type idéologique.
Les discours idéologiques sur la colonisation sont nombreux. De Aimé Césaire à Frantz Fanon… Les livres de dénonciation de la colonisation, de Jaurès à Sartre, également sont nombreux. Mais tout un travail reste à faire, celui d’une « bataille culturelle ». La bataille culturelle sur la question coloniale est très longue. Il faut être très patient. La bataille est difficile et très longue parce que ce qui s’est imprimé et imposé dans la société française colonisatrice, c’est l’idée que la France avait exclusivement apporté les Lumières. La France était généreuse et elle avait des visées tout à fait en harmonie avec la Révolution française, et la question des libertés. Cette idée-là reste très forte. Elle est présente, prégnante à l’intérieur de la société française. De manière pédagogique, par toute une série de faits, de personnages, de situations, d’éclaircissements, de pédagogie, il faut montrer d’autres éclairages de mémoires plurielles. Aujourd’hui, nous ne pouvons plus regarder la « révolution comme un bloc » comme le préconisait Clémenceau. Elle a aussi ses côtés sombres.
Maintenant, vous avez raison sur le fait que du côté de l’ancien colonisé, celui qui a accédé à son indépendance politique, tout un travail reste à accomplir. J’ai travaillé aussi sur la fabrication nécessaire d’un discours critique sur le nationalisme algérien. Lorsque j’ai publié les biographies, par exemple, de Messali Hadj, qui a été écarté de l’histoire officielle algérienne ; de Ferhat Abbas, premier leader du GPRA, lui aussi écarté après l’indépendance de 1962. Ou lorsque j’’ai rédigé également une biographie de Abane Ramdane, organisateur du premier congrès du FLN en 1956 dans la vallée de la Soummam, lui aussi assassiné par ses compagnons du FLN. Tous ces dirigeants du nationalisme algérien ont été mis au secret de l’histoire officielle. Ils n’ont pas existé pendant très longtemps, pendant 30 ans, 40 ans. Il a fallu toute une série de batailles pour que leurs noms, leurs figures, leurs visées, leurs programmes reviennent sur le devant de la scène. Donc, je suis d’accord avec vous, tout un travail reste à faire de l’autre côté de la Méditerranée. Mais d’un côté comme de l’autre, le travail d’écriture de l’histoire ou de décolonisation des mémoires ne peut pas se faire en dehors, selon moi, des « mobilisations citoyennes » sur les questions culturelles. Je prendrai un exemple : lorsque j’ai proposé la panthéonisation de Gisèle Halimi dans mon rapport, je me suis heurté à des oppositions dans des secteurs de la société française qui étaient contre cette panthéonisation parce qu’elle avait été une militante anticolonialiste. Son combat anticolonialiste ne pouvait pas la faire entrer au Panthéon, même si elle avait ensuite joué un très grand rôle sur la question de l’IVG, du viol, de l’abolition de la peine de mort. Ce recul sur le refus opposé à Gisèle Halimi m’a fait beaucoup réfléchir. La bataille culturelle n’est pas finie. Et de l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie, pour parvenir au fait de reconnaissance qu’un des grands dirigeants du nationalisme algérien a été assassiné, non pas par l’armée française, mais par ses compagnons du FLN, c’est-à-dire Abane Ramdane, il a fallu toute une mobilisation de la jeunesse algérienne, qu’on a vue notamment pendant le « Hirak », les grandes marches qui ont chassé A. Bouteflika du pouvoir. Remettre en lumière la vérité historique doit se faire par le travail intellectuel des historiens, le travail académique, mais aussi dans le registre du politique. La bataille culturelle est une bataille éminemment politique.