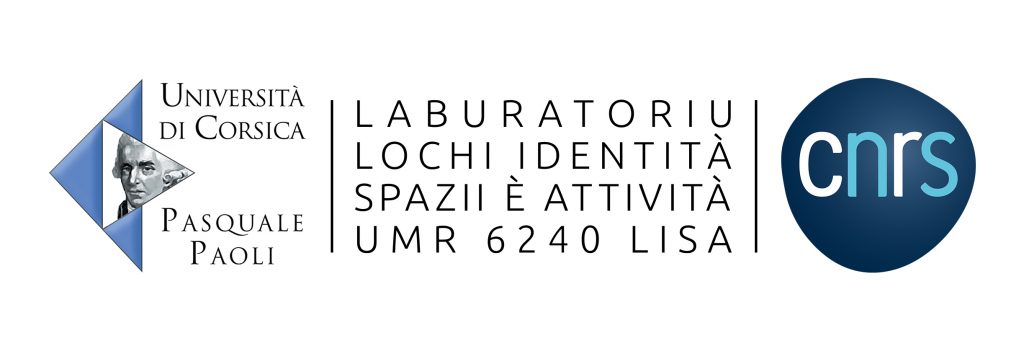Paradoxe de l’appartenance, objet social par nature, la langue ne prive-t-elle pas par essence, l’individu de sa propre individualité ? Comment accéder à la conscience de soi en tant que sujet par un objet nécessairement social, communautaire, en mouvement ? De même que l’on ne choisit pas nos géniteurs, Romain Gary nous rappelle combien l’identité ne saurait faire l’objet d’une délibération individuelle : « Il n’y a pas de commencement. J’ai été engendré, chacun son tour, et depuis, c’est l’appartenance. J’ai tout essayé pour me soustraire, mais personne n’y est arrivé, on est tous des additionnés » hurle-t-il dans Pseudo (Gary et Ajar 1976, 17). Si pour Gary/Ajar, nous sommes condamnés à appartenir à quelque chose, l’appartenance est-elle alors une réification de soi dans un absolu en particulier ? Religion, langue, sexe ou peau, un trait particulier qui me définirait radicalement, dans mon origine plutôt que dans mon individuation. L’appartenance se décline ainsi sur le mode ambivalent du devoir ou de la responsabilité tout comme du besoin de s’en émanciper. Insuffisante, l’identité inhibe en même temps qu’elle suscite la singularité. Lorsqu’elle jaillit, elle prend alors les couleurs de la responsabilité. Dès lors, ne peut-on pas observer avec Axel Honneth, en nous appuyant sur la tradition française de la pensée de la reconnaissance que :
« Le sujet humain, constitutivement tributaire de la reconnaissance d’autrui, se perd lui-même dans les imputations que celui-ci lui adresse, et il doit donc se résoudre à voir son Je « clivé » en une partie capable d’accéder à la conscience, et une partie durablement inaccessible » (2020, 61).
Et si la reconnaissance se limite à la conscience de soi, n’est-elle pas alors un outil de conservation non pas de la langue, mais de la diglossie, c’est-à-dire du rapport de domination exercé par le français ou par toute langue dominante sur la langue dominée ?
Ne faut-il pas chercher l’appartenance et la reconnaissance encore ailleurs ? Chez Gary, il n’y a pas de la langue à soi en propre. Russophone de naissance, francophone et anglophone dans sa création littéraire, son œuvre mobilise au total seize à dix-sept langues. Dans Pseudo (1976), Emile Ajar essaie d’en inventer une supplémentaire, une langue nécessairement hybride et burlesque : le hongro-finnois. Pourtant, là encore, il ne peut esquiver une éventuelle rencontre avec un semblable…
« J’ai alors tâté du hongro-finnois, j’étais sûr de ne pas tomber sur un HongroFinnois à Cahors et de me retrouver ainsi nez à nez avec moi-même. Mais je ne me sentais pas en sécurité : l’idée qu’il y avait peut-être des engendrés qui parlaient le hongro-finnois, même dans le Lot, me donnait des inquiétudes. Comme on serait seuls à parler cette langue, on risquait, sous le coup de l’émotion, de tomber dans les bras l’un de l’autre et de se parler à cœur ouvert. On échangerait des flagrants délits et après, ce serait l’attaque du fourgon postal. Je dis « l’attaque du fourgon postal », parce que ça n’a aucun rapport avec le contexte et il y a là une chance à ne pas manquer. Je ne veux aucun rapport avec le contexte » (1976, 11‑12).
Alors, puisque toute langue à soi n’est qu’une construction socioculturelle inscrite dans le temps long de l’histoire, pour être soi, pour être authentique, l’individu est-il condamné à se libérer du « colonialisme intérieur » de Robert Lafont (1967) en exerçant sa liberté dans l’invention de sa langue en propre ? Gary/Ajar nous interpelle en ce sens dans un monologue délirant, gargantuesque et pourtant sincère :
« Méfiez-vous. Les mots ennemis vous écoutent. Tout fait semblant, rien n’est authentique et ne le sera jamais tant que nous ne sommes pas, ne serons pas nos propres auteurs, notre propre œuvre. Croyez-moi : j’étais déjà ça quand braillait Homère. L’authenticité ne sortira pas du foutre que nous sommes. Il faut changer de foutre. »
Parfois, c’est le cas notamment des néolocuteurs, on s’expose aussi au jugement des locuteurs natifs. Le Clézio (2020, 90) évoque brièvement les transitions phonologiques, lexicales ou syntaxiques de la langue sans lesquelles la transition vers une revernacularisation voire vers une normalisation linguistique serait illusoire :
« Certains parlent à nouveau la langue bretonne (avec parfois un drôle d’accent, mais après tout c’est le propre des langues vivantes que d’évoluer). C’est en partie par eux que la Bretagne vivra. »
Pourtant, toute politique linguistique de revernacularisation ou de normalisation repose sur le primat de la reconnaissance. Celle-ci autorise l’individu et la communauté linguistique à s’appartenir à nouveau. Dès lors, la communauté noue ou renoue de nouveaux liens, se réinvente autour d’un patrimoine en péril.
4. La lutte pour la reconnaissance des langues
Dès lors s’ouvre la lutte pour la reconnaissance des langues, comme soin de soi et soin de l’objet d’identification, comme « besoin de réparation », évoqué par François Mitterrand dans son discours de Quimper, en campagne électorale, en 1981.
Le besoin de reconnaissance
La diffusion des langues fut un enjeu de la colonisation, de la décolonisation, du post-colonialisme et du néocolonialisme. Elle connait de nouvelles actualités de nos jours avec la globalisation qui est parfois ressentie comme procédant d’un nouveau mode de colonisation. La gestion de leurs contacts est à la fois un héritage de la colonisation et bien souvent une anticipation du futur agençant une transition linguistique entre réappropriation et plurilinguisme.
Dès lors, le concept de reconnaissance apparait comme un élément central dans l’analyse des processus en cours. Dans son ouvrage La reconnaissance, histoire européenne d’une idée, Honneth analyse les cultures de la reconnaissance en France, en Grande-Bretagne et en Allemagne (2020). Il distingue trois approches à la fois distinctes et complémentaires, à savoir la reconnaissance comme :
S’appartenir
– Cette dimension constitue un « accès « authentique » à son véritable soi » selon une acception française qui renvoie à une dimension normative, c’est-à-dire au « jugement de la société » (2020, p. 123) dans le processus d’intégration de l’individu comme membre légitime de la communauté. Selon Honneth, « la “reconnaissance” désigne alors cet acte social d’attribution de qualités personnelles par lequel un sujet peut espérer être socialement accepté, voire admiré » (2020, p. 123). Ne retrouve-t-on pas cette invitation au travail sur soi, dans le Portacultura adressé par Dumenicantone Geronimi à ceux qui critiquent l’action d’autonomisation du champ littéraire menée par Rigiru : « a quistione hè di sapè di s’elli sò dicisi i Corsi à fà ch’ella campi a so cultura (…) cunosce è aduprà qualvogliasiasi lingua moltu più quella d’un populu praputinziatu hè sempre un fattu di cunquista nant’à sè[7] » (1976, p. 2) ? La langue apparait ici comme un enjeu d’appartenance. J’appartiens au groupe de ceux dont je parle la langue. Parfois, il peut s’agir du registre ou de la variété. Parfois encore, la question de l’appartenance est plus délicate parce que entend-on : « je parle la langue des autres. Je ne parle plus la langue des miens ». La langue est alors un enjeu d’identification de soi. Qui suis-je ? Suis-je de ceux qui parlent la langue A ou de ceux qui parlent la langue B ? Suis-je réductible à un B, moi qui prétends, ressens être un aussi, d’abord, voire seulement ou principalement un A ? La maîtrise de la langue est donc un enjeu de maîtrise de la désignation de soi, des siens et des autres. On se situe dans son écosystème, au sein de la biosphère, selon la ou les langues que l’on parle. Les français parlent le français. Le code civil l’impose désormais (Assemblée nationale 1993; Ministère de l’intérieur 2020). Nous sommes dans l’identité de l’identique, du prêt à porter, de l’idem, de la mêmeté. L’identité est comme un uniforme. Nous sommes tous remplaçables. Le je égal le tu, le il, le elle, le nous… Le vous c’est l’autre. Pourtant, si les Français se doivent d’être francophones, la réciproque n’est pas vraie. Les francophones ne sont pas tous français. Héritage de la colonisation pourrait-on rétorquer d’un air narquois ?
Faire communauté
– il s’agit de la dimension normative issue de « la tradition de pensée britannique » (2020, p. 121) qui renvoie au « contrôle moral de soi », à une forme d’engagement nécessaire de l’individu au sein de sa communauté. Dans le cas qui nous occupe, la corsitude s’inscrit dans une communauté culturelle partageant un style de vie par-delà les considérations géographiques, territoriales ou ethniques. Les individus s’emparent alors du pouvoir de s’ériger en autruis significatifs, c’est-à-dire en moralisateurs qui escomptent un changement d’attitude de la part des autres. En revanche, dans le cas où l’individu ne se reconnaitrait pas dans la morale proposée, dans le cas où il se sentirait exclu de son groupe de référence, il connaitrait un déni de reconnaissance. Pour Honneth, la reconnaissance « désigne donc ici cet acte social d’approbation morale dont un sujet doit pouvoir s’imaginer faire l’objet, pour être convaincu de compter comme un membre légitime de sa communauté de référence » (2020, p. 123). Nous retrouvons Murtoriu de Marcu Biancarelli (Biancarelli 2009), le témoignage tragique d’un personnage issu de la diaspora dépassé et toujours déclassé, par la rapidité du changement des signes d’appartenance :
« Quand j’étais enfant et que nous revenions du continent pour l’été afin de passer deux mois dans un village de montagne, j’étais, au milieu de tous ces gens, la seule personne à ne pas savoir parler corse. »
« Ils me parlaient et je ne comprenais absolument rien. Et puis j’ai deviné qu’ils utilisaient exactement les mêmes mots que mes parents à la maison quand ils se disputaient ou qu’ils abordaient des sujets auxquels mon frère et moi ne devions pas avoir accès. Je remarquais que les mêmes expressions revenaient toujours et je pouvais les répéter à tue-tête : T’aghju da minà, fà ghjà passà u vinu… Avant d’avoir le courage de parler avec les anciens, je ne m’exprimais en corse qu’avec le chien. Je lui donnais les ordres que j’avais entendus formuler par d’autres pendant les chasses au cochon ou les bagarres entre gamins : Piddalu ! L’usage de la langue me permettait aussi de tester mon autorité : Và è ghjaci ! Avec le temps, l’obscurité des sonorités que j’entendais s’est dissipée. Quand nous sommes définitivement rentrés du continent, je parvenais, dans ma tête, à exprimer tout ou presque dans cette langue, mais de ma bouche ne sortaient que quelques bribes ; j’ai alors fourni un effort car je savais déjà que la puissance s’exprimait aussi par le biais du langage. Pour répondre à ces gens qui me menaçaient, j’ai appris leurs mots, leurs expressions et leurs proverbes. À la fin, ils ne me menaçaient plus, puis ils sont morts et je suis resté là, seul avec cette langue. »
Pour lui, la reconnaissance consiste à disposer du droit de cité, c’est pouvoir appartenir au groupe de référence, or la communauté imaginée s’évanouit aussitôt qu’il croit obtenir son sauf-conduit symbolique.
Faire relation
– Nous arrivons ici à la relation, chère à Edouard Glissant (2009), en ce qu’elle constitue « une attitude et une façon d’agir à l’égard d’autre sujets, qui permettent à ceux-ci d’exercer leur autodétermination » (2020, p. 128) selon la philosophie allemande de la reconnaissance (2020, p. 120). Ni besoin intérieur, ni approbation morale, la reconnaissance apparait comme un besoin ontologique de réciprocité, une négociation susceptible de prendre les formes d’une lutte. Pour Honneth, elle « désigne ici toujours un acte dyadique d’autolimitation morale, qu’au moins deux personnes doivent pouvoir accomplir réciproquement pour se confirmer l’une à l’autre leur capacité rationnelle, et ainsi leur appartenance à une communauté d’êtres doués de raison » (2020, p. 124).
Dans la société de l’authenticité, ce qui est en jeu, ce n’est plus l’existence des images, comme à l’époque de la querelle qui pendant près de cent vingt ans a opposé au sein de l’Empire byzantin les iconoclastes (εικονοκλάσται, littéralement « briseurs d’images ») et les iconodules (εικονόδουλοι, littéralement « serviteurs des images »). Les images existent et sont véhiculées par les produits de la société de la consommation, par les médias, par la publicité, par Internet. Ce qui est en jeu, c’est leur pouvoir sur les imaginaires (Castoriadis 2006), c’est le pouvoir donné aux imaginaires de les organiser, de les interpréter dans le flux continu et exponentiel déversé par les médias et les réseaux sociaux. Les images ne disent que ce que l’imaginaire du lecteur, du public ou du critique leur fait dire. Une même image peut être muette ou polyglotte et polysémique.
Dans nos sociétés urbanisées, les imaginaires se déplacent en direction des objets de consommation et des marques, tant et si bien que le locuteur n’échappe pas lui non plus à la figure du consommateur. Les trois ordres des mythes que sont le réel, le symbolique et l’imaginaire chez Lévi-Strauss ne s’appliquent pas seulement aux animaux, aux objets et aux figures qui irriguent la culture. Ils s’appliquent également aux relations entre les hommes.
Il ne s’agit pas seulement de l’imaginaire des individus considérés comme des isolats, mais des usages intersubjectifs des imaginaires. Tant que l’imaginaire de l’individu n’a d’autre effet que sur lui-même, il est relativement difficile pour la société d’avoir une action sur celui-ci, mais lorsque la rencontre des imaginaires produit de la violence, il est certes trop tard, mais ce moment appelle soit une résolution par une surenchère de violence au terme de laquelle un imaginaire s’imposera sur l’autre, ou bien, dans la société globalisée et complexe dans laquelle nous vivons, le choc des imaginaires ne se réduisant pas à une opposition en face-à-face, il est à la fois pragmatique et éthique de travailler à un dialogue intersubjectif, intersectionnel et interculturel des imaginaires sur d’autres terrains et par d’autres moyens. En ce sens, en démocratie, ces moyens peuvent paraître dérisoires, mais l’éducation interculturelle et plurilingue (Verdoni 2008; 2010; Di Meglio 2010b; 2010a), associée à une politique culturelle s’avère indispensable aux fins de la préservation, de la conservation des imaginaires et de leur dialogue commun, condition de la paix et du progrès au sein du « Tout-monde » cher à Édouard Glissant (2013) ou de « la communauté terrestre » d’Achille Mbembé (2023). La gestion de la diversité est d’abord la gestion des imaginaires, non pour les harmoniser et les réduire, mais pour que les identifications symboliques conduisent à des coopérations, à des collaborations, à des coexistences et à de la cohabitation (Wolton, 2010) de tous dans le monde de la vie, le Lebenswelt (Husserl, 2008 ; Declève, 1971).
Inventer une politique linguistique pour la communauté méditerranéenne
Dès lors, il revient au corps social insulaire de définir une politique linguistique dans les interstices des droits linguistiques acquis. Il s’agit de pouvoir piloter une planification linguistique susceptible de créer de nouveaux usages et de nouveaux droits en équipant la langue. La création d’espaces propres, spécifiques, singuliers et réservés, afin de restaurer des espaces d’expression corsophone apparait nécessaire, tout comme l’on restaure parfois les écosystèmes détruits ou menacés par la pression anthropique.
Le territoire de l’île, à la fois complexe et limité, peut-il permettre l’émergence d’un territoire apprenant ses langues sans correspondre en même temps avec une politique méditerranéenne des langues ? En tant que domaine régalien non-écrit, la politique linguistique relève à la fois de la politique culturelle intérieure de chaque État et de sa diplomatie. Dans une Méditerranée polyphonique, de contacts et de conflits, peut-être est-ce de la responsabilité de chacun d’engager une esquisse des plurilinguismes nécessaires à l’invention de son unité autour d’un projet de citoyenneté culturelle vécu comme l’acte fondateur d’un processus de civilisation de la communauté méditerranéenne au temps de l’anthropocène. Ainsi, à la « mer de nos langues » (Calvet 2020) succèderaient les langues comme mères d’une Méditerranée apaisée.
[7] Tda : « La question est de savoir si les Corses sont décidés à faire vivre leur culture (…) connaitre et utiliser quelque langue que ce soit, d’autant plus lorsqu’il s’agit de celle d’un peuple tout-puissant, c’est toujours un acte de conquête sur soi. »