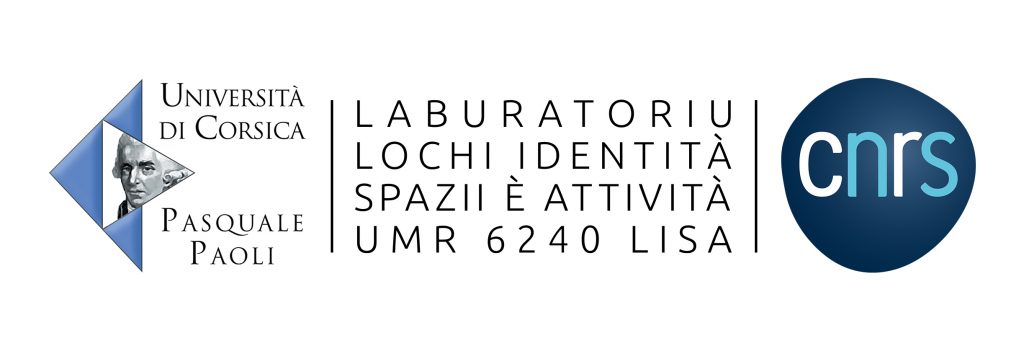B. La proscription des peines corporelles
Il est, en effet, banal de rappeler que sous l’ancien régime, des peines corporelles et parfois très cruelles étaient infligées aux personnes reconnues coupables de certains crimes. Ces peines qui étaient très fréquemment infligées par les tribunaux (au XVIe et XVIIe siècle) s’atténuent progressivement ou deviennent de plus en plus rares au cours du siècle des Lumières[23], sous l’effet de la tendance humanitaire. La quasi-totalité des peines corporelles disparaissent à la Révolution[24], avec notamment le code pénal de 1791 qui a cherché à atténuer les souffrances liées aux sanctions.
Ainsi, supprimées en métropole pour des raisons humanitaires, les peines corporelles ne peuvent, selon toute logique, trouver place parmi les moyens de répression dans les colonies. Dès son arrivée au Soudan, le colonisateur français mène une lutte contre les peines corporelles, qui, quoique n’étant pas représentatives du droit pénal indigène, sont prévues par la plupart des coutumes. Les mutilations, les coups de corde ou la mise aux fers sont bien en usage au moment de l’occupation du Soudan. Le colonisateur français, convaincu de ses principes civilisateurs, les qualifie d’inadmissibles à son arrivée et procède immédiatement à leur suppression. Les divers rapports sur le fonctionnement de la justice indigène administrative de 1894 indiquent que les différents commandants supérieurs du Soudan français ont bien prescrit leur suppression, excepté les coups de corde, restés en usage jusqu’à l’arrivée du premier gouverneur civil, Albert Grodet. Ce dernier s’est montré inflexible à ce sujet. En juillet 1894, lors de l’examen des rapports sur le fonctionnement de la justice administrative indigène des différents cercles du Soudan, il relève parmi les peines infligées pour la répression de certains délits et crimes dans le cercle de Bougouni, celle des coups de corde. Il saisit cette occasion pour rappeler sa circulaire n°106 du 26 février 1894 abolissant ce type de pénalités dans la colonie du Soudan français :
Je les interdis de la manière la plus formelle. En ce qui concerne les femmes surtout, je déclare honteux et barbare le châtiment des « coups de corde ». J’interdis de nouveau et de la façon la plus absolue ce genre de répression qui est indigne de notre civilisation. Vous voudrez bien porter la présente lettre à la connaissance des commandants de cercle de votre région[25].
On observe ainsi la volonté du colonisateur de voir disparaître toute forme de peines corporelles dans la colonie au nom de la civilisation française. Cette volonté est d’autant plus réelle qu’il essaye de les interdire même dans les territoires où son autorité n’est pas encore effective. C’est le cas de Dinguiraye, devenu protectorat français le 12 mars 1887. Dès son installation à Dinguiraye[26], en 1896, l’autorité coloniale française tente de faire enregistrer et contrôler les jugements rendus par les juridictions locales. Bien sûr, ce procédé viole l’article 2 du traité de protectorat signé avec Dinguiraye aux termes duquel la France s’engage à ne pas interférer dans les affaires internes du pays qui sont gérées par son chef comme bon lui semble[27]. Mais l’administration coloniale a estimé que pour transformer en amende ou en emprisonnement les peines corporelles, incompatibles avec les idées humanitaires de la civilisation française et qui sont en usage dans ce pays exclusivement musulman, régi par la loi coranique, il faut un minimum de contrôle des jugements rendus. Mais, jusqu’en 1899, sa tentative n’aboutit pas à cause de l’opposition de l’Almamy Maki Tall[28], maître du pays qualifié de despote. Le lieutenant Dubreuil, premier représentant de l’autorité française à Dinguiraye, ne disposait pas de pouvoirs pour s’imposer, il n’était en réalité qu’un ambassadeur chargé de surveiller essentiellement les troubles du Fouta-Djalon[29]. Le capitaine Husson et l’adjoint Dupuy qui lui succèdent n’auront pas plus de moyens d’action du fait de la politique très habile de Maki Tall. Cependant, la politique de neutralisation de l’influence française à Dinguiraye ne dure pas longtemps puisque le lieutenant Boucher, arrivé en poste en janvier 1899, suspend l’Almamy de ses fonctions avant de l’envoyer en exil à Bamako[30]. Désormais seule maître du pays, l’autorité coloniale met immédiatement en place de nouvelles juridictions auxquelles il est interdit d’appliquer des peines corporelles prévues par le Coran (lapidation, flagellation, amputation d’un membre, etc.)[31].
La suppression des châtiments corporels dans les coutumes pénales indigènes, entamée dès les premières heures de l’occupation se trouve consacrée en 1903, après la conquête définitive, dans le cadre de l’organisation judiciaire. L’article 75 paragraphe 2 du décret du 10 novembre 1903 réorganisant la justice en Afrique Occidentale Française (AOF), oblige les tribunaux indigènes à transformer le châtiment corporel en emprisonnement[32]. Il s’agit là de la consécration d’une pratique déjà connue. Cette affirmation de l’interdiction de toute forme de peines corporelles n’existe pas dans les normes juridiques des autres empires coloniaux. La France a imposé l’interdiction des peines corporelles aux juges indigènes et aux commandants de cercle en AOF à un moment où les autres puissances européennes, notamment l’Allemagne, la Belgique, l’Angleterre, les consolident dans leurs colonies.
Cependant, Il importe de souligner que l’administration coloniale française n’a pas toujours été inspirée des principes d’humanité qui dominent la civilisation française. Dans nombre de cas, les intérêts coloniaux ont pris le dessus.
[23] Benoît Garnot, « L’histoire de la criminalité en France », Les annales de l’Est, 1998, n° 2, p. 251-257, p. 252.
[24] René Garraud, op. cit., p. 144 ; Voir aussi Marie-Hélène Renault, op. cit., p. 103.
[25] ANM 2M59 : Lettre du gouverneur du Soudan français à Monsieur le commandant de la Région Est Bamako, Kayes, le 19 juillet 1894.
[26] Le décret du 17 octobre 1899 rattache Dinguiray, qui faisait partie jusqu’alors du Soudan français, à la colonie de la Guinée française.
[27] Traité de Tamba, 12 mars 1887. Cité intégralement par Yves Saint-Martin, « Un fils d’El Hadj Omar : Aguibou, roi du Dinguiray et du Macina (1843 ?-1907) », Cahiers d’Études Africaines, vol. 8, cahier 29 (1968), p. 144-178, p. 162, note 1.
[28] Fils d’Aguibou, roi du Macina, et petit-fils du conquérant El Hadj Omar Tall, fondateur de l’empire toucouleur. Il remplace son père à la tête de Dinguiray en 1892.
[29] En 1891, le colonel Archinard, commandant supérieur du Soudan français avait invité l’administration des Rivières du Sud (qui devient par la suite la Guinée française) à surveiller Fouta-Djalon que le conquérant Samory tente de soulever contre Dinguiraye (Joseph Quiquaud, « La pacification du Fouta-Djalon », Revue d’histoire des colonies, tome 26, n° 116, 1938, p. 49-134, p. 60). Mais suite aux troubles intérieurs du Fouta nés lors de la succession de l’Almamy Bkar-biro, c’est l’administration du Soudan français qui sera amenée à surveiller particulièrement ce pays. À propos des troubles du Fouta-Djalon voir Fernand Rouget, La Guinée, notice publiée pour l’Exposition coloniale de Marseille, Corbeil, E. Crété, 1906, p. 60-61.
[30] Lieutenant commandant Boucher, « Notice sur le Dinguiray », Revue coloniale, juillet-août1901, p. 282-301, p. 287-288.
[31] Lieutenant commandant Boucher, « Notice sur le Dinguiray (suite et fin) », Revue coloniale, juillet-août1901, p. 478-500, p. 479-480.
[32] Décret du 10 novembre 1903 réorganisant la justice dans les colonies du gouvernement général de l’Afrique occidentale, voir Recueil Dareste, 1904, p. 18 [disponible sur Gallica].