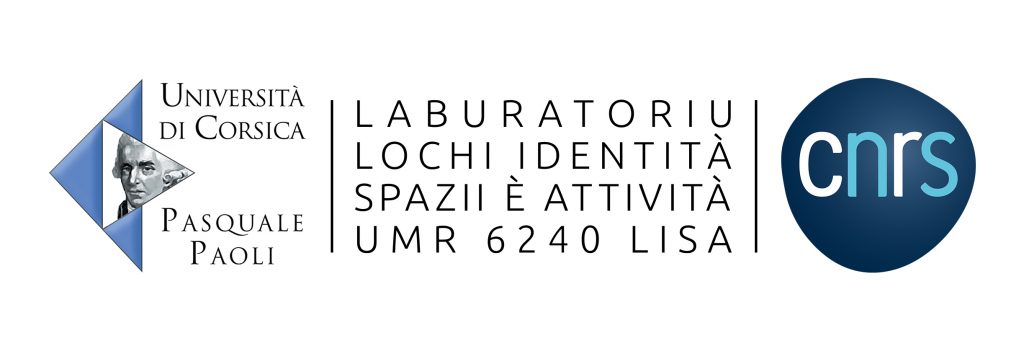« Car l’idée que je n’ai jamais cessé de développer, c’est que, en fin de compte, chacun est toujours responsable de ce qu’on a fait de lui-même, s’il ne peut rien faire de plus que d’assumer cette responsabilité. Je crois qu’un homme peut toujours faire quelque chose de ce qu’on a fait de lui. C’est la définition que je donnerais aujourd’hui de la liberté : ce petit mouvement qui fait d’un être social totalement conditionné une personne qui ne restitue pas la totalité de ce qu’elle a reçu de son conditionnement. »
Jean-Paul Sartre, L’Existentialisme est un humanisme
Toute pratique sociale invente un savoir. L’action dévoile la réalité et la modifie. Le groupe, au-delà d’être un instrument, un moyen, est un mode d’existence. Chaque lutte singulière totalise l’ensemble de toutes les luttes. Faire l’histoire, c’est se changer en la changeant. Dans ce que Sartre appelle le « pratico-inerte », chacun est autre que soi, le même que les autres : l’identité avec l’autre tient à la séparation qu’il y a entre eux. Toute liberté s’exerce en situation. Elle est toujours à faire, à assumer. Le monde n’est pas donné, il est à construire. Le conçu et le vécu sont indissociables. L’humain est liberté et la liberté est un arrachement. Dans un monde incertain, nous sommes condamnés à nous inventer perpétuellement à travers une liberté angoissante et inconfortable.
La philosophie de Sartre sur la violence de la liberté a été mise en œuvre magnifiquement dans ses écrits sur la colonisation.
La violence coloniale, c’est pour lui à la fois une domination politique, une exploitation économique et une déshumanisation psychologique. Cela conduit à ce que l’indigénat soit une véritable névrose où il s’agit de nier ce qu’on a fait de nous pour devenir ce que nous sommes. Le colon tire sa vérité d’homme du système colonial, fondé sur un véritable narcissisme juridico-politique. Le monde colonial est compartimenté ; il conditionne les comportements. Le colonisé n’a ni espace ni temps. Il est conduit à mener une vie sans repères, affamée. A travers un droit manichéiste, fondé sur des essences, des statuts rigides, le colonisé, véritable gibier, est présumé coupable et ne dispose d’aucun rêve de liberté. Le colonisé n’est pas un sujet, mais une chose, un objet, un bien. Il n’a ni état civil, ni propriété, ni domicile. Il ne jouit ni des droits-protection (« fatoumata », « passage à tabac »), ni droits-promotion (absence de droit de vote), ni pouvoirs, ni projets de vie. Il n’est ni sédentaire, ni nomade :il vit en déplacements permanents. Il ne relève pas du politique, où il est invisible, mais de la police, surveillé et puni en permanence.
Les colonisés sont des gens sans rivages et couleurs, sans limites. Ce système de domination conduit à une redistribution fondamentale des rapports sociaux. Le colonialisme doit donc disparaître, et aussi le colonisateur. A travers une inégalité infériorisante pour l’indigène, s’est construit un droit assimilationniste, missionnaire, autour de l’idée de civilisation par la « race » blanche. Un universalisme et une unification se baptisent du côté du Bien à travers une étatisation systématique. A l’aide du principe majoritaire, reproducteur des hiérarchies sociales, les « minorités » sont fabriquées artificiellement par une majorité qui se juge supérieure. Toute minorité est arrasée et discréditée et jugée déviante et illégitime. La majorité est imposée comme norme uniforme et uniformisatrice. Devant cette normalisation, la minorité doit rester invisible, faire allégeance, impuissante à élaborer une catégorie d’intelligibilité sociale. Aucune régulation pluraliste de la diversité ne peut advenir. S’impose le mythe national du « creuset », cette matrice éternelle, immuable, étanche.
Un droit colonial s’est construit, fait d’interdits et de contraintes (exemple du travail forcé). Ce droit colonial autorise les inégalités et leurs dérives, refuse tous référents collectifs aux colonisés. On a bâti un droit des autres à travers ce droit colonial, un droit contre les autres, droit de domination dont il ne faudra pas s’étonner qu’il soit violemment combattu.
D’où la violence de la revendication de la liberté, revendication nécessaire, à la fois individuelle et collective, qui recouvre, au-delà de la liberté de faire, la liberté d’être. La violence du colonisé est une contre-violence, violence subie d’abord qui s’extériorise ensuite, qui s’appuie sur une philosophie de la libération : le sujet existe dans la mesure où il désigne son ennemi et le combat. La violence est créatrice, elle crée l’existence humaine, le sujet historique, l’humain véritable qui naît dans la lutte, l’arrachement à sa condition d’opprimé. Le révolté se réinvente. Les masses deviennent peuple grâce à la violence. La révolte de l’humain opprimé correspond à une conception de la liberté, et cela correspond à une morale, à une éthique universelle qui combat l’exploitation. Le refus de l’oppression est une manifestation de la liberté, qui est une exigence de vérité, exigence d’une éthique. Cette volonté morale d’émancipation fit scandale quand les analyses de Sartre furent publiées. Mais pour Sartre, le scandale était sa façon de lutter contre l’intolérable, de le dénoncer. Les textes de Sartre, lus dans le monde entier, ont représenté l’espoir. Grâce à lui, entre autres, des voix que l’on n’entendait pas jusque là allaient se faire entendre dans le monde entier.
Les intellectuels colonisés ont retourné contre les colonisateurs leur propres discours, universalistes, ce qui permettra aux colonisés de construire leur unité d‘action contre cette colonisation qui a créé les nations colonisées. Alors que l’Etat colonisateur unifie les colonisés de l’extérieur, par la contrainte, la lutte pour l’indépendance unifie le peuple de l’intérieur, en évitant l’effritement du pays. On comprend alors le rôle de l’idéologie de l’unité nationale : le panafricanisme est le corollaire de la revendication de souveraineté nationale.
Mais la liberté ne se donne pas, elle se prend par la lutte et la révolte. Les concessions des colonisateurs sont provisoires, le néo-colonialisme est proche qui va tenter de récupérer le pouvoir. Le capitalisme sait truquer les décolonisations.
Sartre renverse la situation coloniale : le Blanc perd le monopole du regard et celui de la parole, le Blanc doit s’exposer au dialogue et aux regards du colonisé, anciennement soumis. Le colonisé se décolonise sous le regard du colonisateur : son assignation, qui lui était imposée, est remise en cause par sa lutte, qui assume son sort en se révoltant.
Le « Tiers- Monde » s’est exprimé à travers ses intellectuels (Franz Fanon, « Les damnés de la terre »), avec des servages qui font honte aux occidentaux. Les colonisés sont traités comme des bêtes de somme, déshumanisés.
« Nous ne devenons ce que nous sommes que par la négation intime de ce que l‘on a fait de nous » (Jean-Paul Sartre). Le colonialisme engendre la haine. La violence sans-merci des colonisés est en elle-même émancipatrice : ils se font hommes à travers leur violence.
« Abattre un européen, c’est faire d’une pierre deux coups ; supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé : restent un homme mort et un homme libre » (Jean-Paul Sartre, préface aux « Damnés de la terre »).
Ainsi sera extirpée la qualité de colonisateur, qui se verra décolonisé, arraché à ses idéologies menteuses qui ont fait que les hommes européens ne sont devenus hommes qu’à travers le racisme et la surexploitation.
« Le travail en peau blanche ne peut pas s’émanciper là où le travail en peau noire demeure marqué d’infamie » (Karl Marx).
Lucide, Sartre savait que longtemps encore les colonisés se battraient entre eux et que ces effets néfastes de la colonisation séviraient pendant des décennies. Même celui – Patrice Lumumba – qui peut se considérer comme au-dessus de tous les noirs, reste traité comme situé au-dessous de tous les blancs.