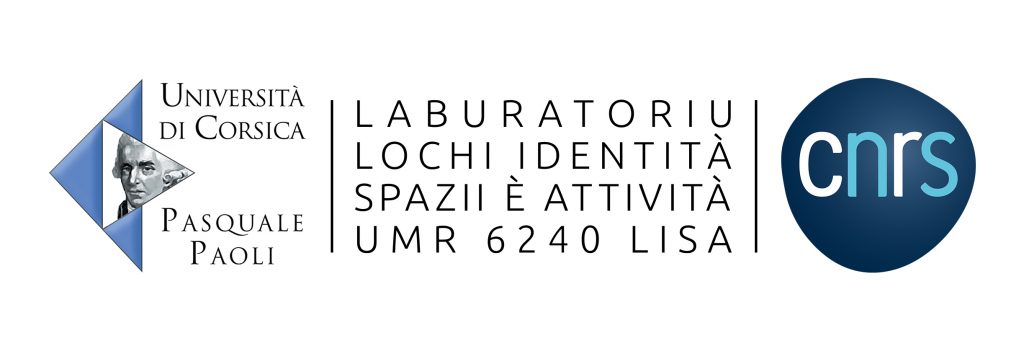Une réflexion depuis les sociétés post-esclavagistes de la Caraïbe
Rendre audibles les sans-voix
Le propos de ce texte est de soumettre une réflexion sur la difficulté de pouvoir entendre les « sans-voix », de donner de la voix à celles et ceux qui sont rendus inaudibles au sein de systèmes sociaux dont le fonctionnement repose précisément sur le pouvoir de « faire taire » et de rendre silencieuses les figures pourtant si présentes dans nos vies sociales.
Les chercheurs spécialisés sur la Caraïbe fondée à partir du socle colonial et esclavagiste connaissent bien l’ouvrage de l’anthropologue Michel-Rolph Trouillot (1995), Silencing the past, dont le titre dans sa traduction française – « Rendre le passé silencieux » – n’a sans doute pas la même efficacité pour venir dire la capture des possibilités de recouvrer les termes de sa propre histoire. Par cette expression que pourrait aussi traduire la notion « d’ensilencement » qu’utilise la philosophe Elsa Dorlin (à paraître, 2023), M.-R. Trouillot veut traduire l’idée selon laquelle les conditions de production de narrations spécifiques sur le passé attestent de « l’exercice différentiel du pouvoir qui rend certains récits possibles et qui réduit les autres au silence » (Trouillot, 1995, p. 25)
S’intéresser à la production du silence et à ce qui existe forcément en-deçà de ou par-delà ce silence est une question à laquelle les chercheurs du temps présent s’adressent bon an mal an, en recourant au « terrain » ou à la « relation », « le terrain » étant ce fétiche de l’anthropologue équivalent à celui de l’archive pour l’historien, pour tenter de mettre en lumière les « si petits destins » de la violence subie.
Quand elle s’adresse aux figures anonymes du passé, cette difficulté de la quête du « caché », du « non visible », du « non su », du « rendu silencieux », du « disparu », du « vouloir taire » est redoublée par l’absence du vivant, l’absence du « maintenant » et du possible de cette rencontre de « terrain » ou de la relation avec des témoins de l’expérience vécue. Car tenter de recouvrer le passé, c’est toujours avoir affaire à la perte définitive. La reconstitution historique pourrait alors nous paraître bel et bien comme un leurre avec, comme le disait Michel de Certeau, un assemblage de matériaux destinés à « tromper la mort », à « cacher l’absence effective des figures » dont parle le texte, « à faire comme si » le vivant pouvait être de nouveau atteint, alors qu’il s’agit de « l’irréparable perte de la présence » (de Certeau, 1975, p. 386).
Il est bien-sûr envisageable d’élargir cette réflexion hors du champ des sociétés (post)esclavagistes de la Caraïbe et des Amériques. Si ces dernières confrontent aux voix imperceptibles et inaudibles des esclaves, puis de leurs descendants, elles mettent à jour bien plus largement la question des sources à explorer pour tenter de restaurer des présences effacées, des présences anéanties par le poids des appareils de pouvoir. Parmi ces appareils, l’archive a pu être considérée comme le lieu par excellence du déploiement de l’autorité coloniale, et plus généralement de celle des nations occidentales autant dans leur pulsion impériale que dans leur structuration interne vouée à produire des sociétés segmentées et hiérarchisées. Ces hiérarchies nationales se confortent d’ailleurs par le contrôle qu’exercent les groupes dominants sur le récit national : sans la possibilité de dire et circonscrire la Nation, les élites sont fragilisées, d’où leurs luttes pour le monopole de la production narrative du corps social légitime.
L’archive…
Le pouvoir de l’archive a été maintes fois décrit et décrié, faisant des documents archivés des « produits de machines étatiques » (Stoler, 2009, p. 28), l’usage des ressources électroniques venant décupler ce pouvoir que Featherstone (2000, p. 180) assimile à un « super-panoptique ». La matérialité du lieu de l’archive – le bâtiment de conservation – fabrique en soi ce qui est au principe même de la puissance de l’archive, c’est-à-dire le principe de coupure qui circonscrit les savoirs sur le passé en tant qu’acceptables, conservables, tout en les séparant de la parole vivante. Le document d’archive est « silencieux » nous dit Ricœur, et même « orphelin » car privé de ce qui donne la vie. Il est voué à ne pas être dit/entendu et donc privé de la capacité à entrer dans le dialogue dont rend compte le témoignage. Aphone, il se présente comme la première mutation de la mémoire vivante recouverte et même éteinte par la scripturalité (Ricœur, 2000). L’archive est donc une institution du savoir qui fonctionne par une sorte de décantation de la vie dont l’usage ouvre la voie à une histoire positiviste sur le passé comme épurée des subjectivités puisque dépouillée des ressorts de l’émotion, du vivant et du mouvement de la pensée.
Il serait illusoire de penser que cet élan positiviste a été laminé par les épistémologies qui se sont succédé : post-structuralistes, déconstructivistes, post-coloniales, décoloniales, ontologiques etc. En France, les historiens et chercheurs d’autres disciplines continuent de charger l’archive de son pouvoir de vérité, de sa visée vérificationniste – « une épistémologie de la vérification » selon l’expression de l’anthropologue jamaïcain David Scott (1997, p. 21) – et ceci selon un rapport qui semble être totalement ignorant de la façon dont il introduit lui-même des hiérarchies, redouble des rapports de domination et produit en définitive de la « violence épistémique » telle que l’a abordée Gayatri Chakravorty Spivak (1988) dans son célèbre texte Can the subaltern speak ?. De ce point de vue, deux polémiques très vives portant sur les sociétés coloniales à fondement esclavagiste ont montré l’existence de ce redoublement – vérité et subalternisation – sur la base de l’objectivité attribuée à l’Histoire et à la rigueur de l’historien. Je veux parler ici de la polémique partie de l’ouvrage d’Olivier Pétré-Grenouilleau (2004) et des commentaires de l’auteur dans la presse, ouvrage portant sur l’approche globale des traites négrières estimées comme non rentables pour l’Occident (voir Chivallon, 2005) et plus récemment la controverse violente suscitée en Guadeloupe par l’ouvrage de Jean-François Niort (2015) relatif au Code noir où il s’agissait de montrer que celui-ci ne niait pas la personne humaine chez l’esclave et, en conséquence, ne le déshumanisait pas. Dans les deux cas, le « regard surplombant » se réclamait de la capacité à établir une vision du système esclavagiste réputée « vraie » et bien moins atroce en certains aspects que celle que lui prêteraient celles et ceux qui sont les descendants des victimes et restent soumis encore aujourd’hui aux prolongements de la violence d’un monde social racialisé, structuré par la colonialité formée dans la matrice ancienne de ce système. La plus importante polémique sans celle renouvelée bien au-delà du contexte français, reste sans conteste celle autour de la thèse de l’historien trinidadien Eric Williams (1994 [1944]) pour qui l’esclavage a permis le décollage de l’industrialisation des pays européens. Lauréat du prestigieux Bancroft Prize de l’Université de Columbia en 2015, l’historien Greg Grandin a très bien résumé l’enjeu de ces remises en cause interminables de la thèse de Williams (et sans doute de toutes les autres) : concernant l’esclavage, chaque génération doit prouver de nouveau ce qui semble pourtant être évident, et c’est en définitive ce qui forme obstacle à la possibilité de se souvenir du tragique de cette expérience pour l’humanité (Grandin, 2015).
La perspective qui voit dans l’archive l’un des piliers majeurs de l’exercice du pouvoir s’est vue toutefois âprement discutée et remise en cause au cours des deux dernières décennies à la faveur d’un des nombreux tournants qui animent le monde académique. L’archival turn (le tournant archival/archivistique) a fait naître une profusion d’interprétations où fleurissent les notions de « contre-archives » ; « d’archives alternatives » ; « d’archives non officielles » tout en réclamant que l’institution elle-même soit revisitée pour le potentiel qu’elle offre malgré tout d’emplir la froideur des documents par des émotions, de l’agentivité, de l’esthétique, et des pratiques tout simplement vivantes. Il y a dans tous les cas, celui ou celle qui s’empare du sens que l’archive s’apprête à livrer, qui s’adonne à le déconstruire (à le « décoloniser » aussi) et à mobiliser en définitive une lecture d’où les affects ne sont pas absents (Mbembe, 2002).
Ramené à notre double préoccupation, celle de l’altération des figures devenues inconnues ou méconnaissables et celle du passé irrémédiablement perdu, le débat nous renvoie à des questions en forme d’obstacles et sans doute d’apories. Existe-t-il dans l’archive ou hors de l’archive des voies de traverse qui laissent entrevoir ces destins fragiles qui nous préoccupent, ces destins si enclins à être obscurcis et meurtris par les documents officiels où l’écrit élimine déjà la trace d’une parole audible ?
… Et la trace
Ce que l’on pourrait désigner par le mot « trace » à la manière de l’écrivain martiniquais Édouard Glissant, ne serait-il pas justement ce lieu d’une alternative où pourraient se manifester des manières d’échapper à la scripturalité de l’archive ou d’être insérées accidentellement ou discrètement dans ses interstices ? Dans la pensée de Glissant, la « trace » désigne comme des sédiments épars à partir desquels les mémoires s’élaborent contre des « pensées systèmes ». Dans son étude de la place de « la trace » dans l’œuvre de Glissant, Françoise Simasotchi-Bronès, (2014) s’en remet à l’approche de deux autres écrivains martiniquais – Patrick Chamoiseau et Raphaël Confiant – pour indiquer la composante originelle de cette inscription fragile et clandestine attachée aux lieux parcourus par les esclaves :
« La chose est frappante, à côté des routes coloniales dont l’intention se projette tout droit à quelque utilité prédatrice, se déploient d’infinies petites sentes que l’on appelle tracées. Élaborées par les nègres marrons, les esclaves, les créoles à travers les bois et les mornes du pays, ces tracées disent autre chose. Elles témoignent d’une spirale collective que le plan colonial n’avait pas prévu » (R. Confiant et P. Chamoiseau, 1991, p. 12, cités par Simasotchi-Bronés, 2014, p. 24).
Recouvrer une conscience du passé, c’est, avec Édouard Glissant, s’éloigner de toute historiographie détachée de la vie, même si l’écrivain-philosophe n’exclut pas le recours aux sciences humaines pour accéder à ce qu’il désigne par une « vision prophétique du passé » (Glissant, 1981, p. 132), à savoir un démêlement/emmêlement que je comprends pour ma part comme une sorte de parcours temporel sans bornes établies, sans balises normées et figées. « La pensée de la trace », c’est plus précisément mettre en œuvre :
« (…) un non-système de pensée qui ne sera ni dominateur, ni systématique, ni imposant, mais qui sera peut-être un non-système de pensée intuitif, fragile, ambigu, qui conviendra le mieux à l’extraordinaire dimension de multiplicité du monde dans lequel nous vivons » (Glissant 1996 : 25).
Patrick Chamoiseau, grand complice intellectuel de Glissant, en décline une définition poétique où « la Trace » contient le vivant de l’expérience, à l’écart des dispositifs de conservation autorisés :
« La Trace est marque concrète […]. Les mémoires irradient dans la Trace, elles l’habitent d’une présence-sans-matière offerte à l’émotion. Leurs associations, Traces-mémoires, ne font pas monuments, ni ne cristallisent une mémoire unique : elles sont un jeu des mémoires qui sont emmêlées. Elles ne relèvent pas de la geste coloniale, mais des déflagrations qui en ont résulté. Leurs significations demeurent évolutives, non figées – non univoques comme celles du monument. Elles me font entendre-voir-toucher-imaginer l’emmêlée des histoires qui ont tissé ma terre ». (Chamoiseau, 1997 : 120)
D’un possible dépassement ?
D’un côté pourrait donc se trouver l’archive, et de l’autre la trace ; d’un côté l’histoire, de l’autre la mémoire ; d’un côté le dépôt figé, de l’autre la circulation de la parole. De nouveau avec Paul Ricœur, il y a cependant matière à éviter un schème binaire, puisque la mémoire est vue comme la « matrice de l’histoire », le philosophe allant jusqu’à définir son ouvrage majeur comme un « plaidoyer pour la mémoire comme matrice de l’histoire » (Ricœur, 2000, p. 106). En d’autres mots, l’archive elle-même – et « l’Histoire » qu’elle conforte – se trouve dépendante d’un régime particulier de mémoire, ce qui pourrait être ce « régime d’historicité » défini par Hartog (2003) ou Détienne (2000), à savoir une manière de construire un rapport au temps, l’archive devenant avant tout un Discours, un ensemble de représentations pour un groupe ou une Nation qui voient en elle le possible d’un passé atteignable et reconstruit de manière la plus crédible possible, animée par la croyance en « la reconstitution véridique ». Mais n’y-a-t-il pas lieu de désenclaver l’archive de son propre système ? N’est-elle pas aussi emplie de traces, « les éclats de vie » ou « les fragments de vie » dont parle Arlette Farge (1989) et qu’il faut savoir débusquer parmi les « discours tronqués » que rapportent les documents ? De même, la trace ne devient-elle pas elle-même archive quand, hors du document, se trouvent déposés des témoignages du passé, dans les architectures multiples, dans les symbolismes matérialisés, dans les corps et leurs mémoires motrices et en définitive dans tout signifiant incarné.
À partir de ces notions de traces et d’archives mêlées s’ouvre un horizon de questionnements moins conquérant, plus modeste et non moins prometteur sur la possibilité de dévoiler des pans de vie restés muets, comme de reconfigurer les notions qui nous sont familières sans forcément les opposer, ni faire entrer en conflit les termes et les binarismes qu’ils portent. Si ces pistes sont plutôt théoriques, elles pourraient cependant être précieuses et nous aider de façon pratique dans ce travail de « fouille » quasi archéologique pour entendre ce qui nous vient du passé, qui retentit dans notre présent et nous aide à retrouver des continuités, des strates, des matrices de sens anciennes et pourtant encore-là et dont les figures des sans-voix d’aujourd’hui pourraient être le témoignage vivant, porteurs d’archives et de traces des vies d’hier.
Contre-commentaires
Je voudrais terminer ce propos par deux remarques se rapportant à ces deux pans de notre point de départ avec d’une part un passé irrémédiablement perdu et d’autre part l’altération de figures rendues méconnaissables ou inconnaissables, remarques un peu en forme de contrepoints ou de contre-commentaires critiques.
La première remarque consiste à évoquer une sorte de leurre de la mort du passé, ce qui peut paraître contradictoire avec ce qui a été proposé plus haut, mais qui relève me semble-t-il de la possibilité de concevoir comme compatible l’idée de la perte irrémédiable et celle du dépassement du caractère provisoire des existences individuelles. Il n’est pas question d’affirmer que la vie en soi/pour soi continue et de se prévaloir d’un quelconque transhumanisme qui rêve d’immortalité, mais seulement d’entrevoir la continuité de la vie au travers des traces déjà évoquées mais, de manière encore plus incorporée, au travers de la mémoire intergénérationnelle comme de la mémoire animée par les souvenirs qui se sédimentent en chacun de nous, à partir de strates cumulées puisant dans les expériences successives. De ce point de vue, je ne fais que mentionner, à titre exploratoire de cette proposition, les recherches que j’ai pu conduire sur les traces du souvenir d’événements anciens, événements datant de 1870 au cours d’une révolte anticoloniale, et dont j’ai rencontré les « porteurs », les passeurs ou les témoins de souvenirs constitués au fur et à mesure de l’éloignement temporel (Chivallon, 2012). Je ne parle ici de cette recherche que pour en dire le rapport qu’elle fait surgir entre l’archive de l’événement consigné par les autorités coloniales et la parole actuelle des descendants des protagonistes de cette insurrection.
Le travail conduit sur les archives n’a jamais pu laisser entrevoir des matériaux froids et désincarnés devenus disponibles à la liberté de mon interprétation, à ma capacité de leur donner une vie singulière et de les charger de ma seule émotion et de mes affects. La relation établie avec ceux liés par l’expérience à ces matériaux arrachait l’archive à son statut fondé sur le principe de la coupure. Les matériaux n’étaient plus « orphelins » mais raccordés au vivant de la parole qui circule. Ces archives, notamment les actes du procès des insurgés, sont une déclinaison parfaite de la capacité narrative du pouvoir colonial dont il était question avec Trouillot, c’est-à-dire la capacité à taire, transformer, travestir et faire disparaître, laissant à peine se profiler l’ombre des aïeux des personnes avec qui j’étais aujourd’hui en présence. Mais par-delà cette autorité de l’archive, le témoignage des personnes venait interférer comme pour raconter l’autre face de l’archive, celles de mémoires circulantes, liantes, vivantes, reconfigurant le statut de l’archive au travers de la parole échangée et transmise. C’est ce rapport entre la personne vivante et le matériau conservé qui la concerne qui semble offrir la voie la plus prometteuse sur les plans autant éthique, politique qu’épistémique pour investir l’archive sans redoubler son pouvoir d’être l’incarnation d’un mode d’autorité voué à la conservation et offerte à la rigueur historienne. La mémoire est un moyen de détourner la puissance de l’archive, de la travailler par la trace, par le témoignage sensible et de lui donner en définitive une filiation, une condition historique, d’instaurer au cœur de ces empilements de documents morts, le dialogue dont Ricœur évoquait l’absence constitutive.
Ce cheminement où le dépouillement et l’interprétation des sources archivistiques se font en compagnonnage avec ceux qui pourraient être définis comme les détenteurs premiers d’une légitimité à accéder aux documents qui se rapportent à leurs vies et aux figures familières de leur milieu, amène la deuxième remarque ou le deuxième contre-commentaire. Car tenter de faire jaillir l’existence de ceux rendus invisibles par les narrations dominantes ne va pas sans poser des questions éthiques et politiques que ne suffit pas à résoudre la perspective d’un dialogue entre chercheur-historien-anthropologue et personnes-témoins directement concernées. Il faut aussi accepter que la résistance aux appareils de pouvoir, à tous les pouvoirs comprenant ceux du savoir, puisse se loger dans le désir de la clandestinité et de la non-visibilité.
Je me souviens d’une scène en 2020 où des collectifs associatifs étaient réunis dans un quartier populaire de Bordeaux pour présenter au public leurs activités. L’un de ces collectifs affichait plutôt fièrement son objectif de donner la parole à ceux que l’on n’entend pas, de donner les moyens de faire émerger cette parole inaudible. Une femme d’une quarantaine d’années, se présentant comme précaire et gilet jaune, lui a demandé calmement le pourquoi de la mission que ce groupe se donnait. Presque gentiment, comme si elle s’adressait à un enfant, elle a expliqué au représentant associatif que personne ne voudrait que l’on parle à sa place, et qu’elle-même ne voulait pas que l’on parle à sa place, que la parole appartenait à chacun et que vouloir projeter cette parole dans l’espace public n’était pas forcément le désir de ceux que l’on classait comme sans parole.
Fréquenter les écrits des écrivains antillais ramène au cœur de cette emprise sur les destins déclarés être éteints et invisibilisés. Edouard Glissant se méfie du verbe « comprendre » qui est au fondement même de nos démarches de connaissance. Il y a, dit-il, « dans ce verbe comprendre le mouvement des mains qui prennent l’entour et le ramènent à soi. Geste d’enfermement sinon d’appropriation. Préférons-lui le geste de donner-avec » (Glissant, 1990, p. 206). Et Si Édouard Glissant se méfie du verbe « comprendre » qu’il signale avec son trait d’union – com-prendre – pour rappeler le sens étymologique de « prendre avec soi » (Ibid., p. 158), c’est parce qu’il y décèle « un sens répressif redoutable » (ibid., p. 38). Quand la conquête géographique s’est faite banale et moins aventureuse pour l’occident, s’est en effet substitué le souci de vérité de l’Autre. « Comprendre des cultures fut alors plus gratifiant que découvrir des terres nouvelles. L’ethnographie occidentale s’est structurée à partir de ce besoin » (ibid., p. 38).
Mais c’est plus encore avec la notion d’opacité que Glissant nous amène à poser la question du « qui » dévoile les vies cachées et pourquoi ? Glissant réclame le « droit à l’opacité », il est un militant de l’opacité. Écoutons ce qu’il nous dit de l’opacité :
« La pensée de l’opacité me distrait des vérités absolues dont je croirais être le dépositaire (…) Elle relativise en moi les possibles de toute action en me faisant sensible aux limites de toute méthode (…). La pensée de l’opacité me garde des voies univoques et des choix irréversibles (…). Que par ailleurs l’opacité fonde un Droit, ce serait le signe de ce qu’elle est entrée dans la dimension du politique. Redoutable perspective (…). Comment concilier la radicalité inhérente à toute politique et le questionnement nécessaire à toute relation ? Seulement en concevant qu’il est impossible de réduire qui que ce soit à une vérité qu’il n’aurait pas générée de lui-même. C’est-à-dire dans l’opacité de son temps et de son lieu (…). C’est aussi (…) cette même opacité [qui] anime toute communauté : ce qui nous assemblerait à jamais, nous singularisant pour toujours. Le consentement général aux opacités particulières est le plus simple équivalent de la non-barbarie. Nous réclamons pour tous le droit à l’opacité » (Glissant, 1990, p. 206-209).
Je terminerai donc avec cette double orientation qu’il nous faut explorer, à savoir le désir d’une justice que nos démarches trouveraient à mettre en œuvre en exhumant les histoires tragiques broyées, éteintes ou fragilisées par les machines de pouvoir ou bien le désir de taire notre propre désir de nous attacher aux existences qui ne sont pas les nôtres pour leur donner une vie qui restera forcément dépendante de notre subjectivité, de notre trajectoire et de nos appareils de savoir. Dans La vie des hommes infâmes, Michel Foucault entrevoit parfaitement ce dilemme que fait naître la découverte des destins obscurs, esseulés, relégués et condamnés : « On me dira : vous voilà bien, avec toujours la même incapacité à franchir la ligne, à passer de l’autre côté, à écouter et à faire entendre le langage qui vient d’ailleurs ou d’en bas ; toujours le même choix, du côté du pouvoir, de ce qu’il dit ou fait dire. Pourquoi, ces vies, ne pas aller les écouter là où, d’elles-mêmes, elles parlent ? » (Foucault, 1977, p. 13). Connaitre, comprendre, dévoiler les figures invisibles et inaudibles ou revendiquer l’opacité et laisser la liberté de cette opacité à celles et ceux dont les voix ont été ensevelies par des institutions qui aujourd’hui voudraient les faire rejaillir ? L’interrogation vaut pour l’exploration des matériaux considérés comme orphelins, ou aphones comme pour ceux donnés par la parole qui circule, elle vaut aussi pour l’archive et la trace.
Références citées
Chamoiseau P., Confiant R., 1991, Lettres créoles et tracées antillaises et continentales de la Littérature, Paris, Hatier.
Chamoiseau P., 1997. Ecrire en pays dominé. Paris : Gallimard.
Chivallon C., 2005, « Sur une relecture de l’histoire de la traite négrière », Revue d’histoire moderne et contemporaine (RHMC), n°52-4 bis, pp. 45-53.
Chivallon C., 2012. L’esclavage. Du souvenir à la mémoire.Paris, Karthala.
De Certeau M., 1975. L’écriture de l’histoire. Paris : Gallimard.
Détienne M., 2000. Comparer l’incomparable. Paris : Seuil.
Dorlin E., à paraître, « La gouvernementalité impériale contre l’unité caribéenne : massacrer et abîmer les vies (Antilles, 1959-1969) », in Dorlin E., Rigouste M., Sainton J.-P., Mai 67. Massacrer et laisser mourir, Paris, Libertalia, avril 2023.
Farge A., 1989. Le goût de l’archive. Paris, Seuil.
Featherstone M., 2000. “Archiving cultures”, British Journal of Sociology 51(1), 161–184.
Foucault M., 1977, «La vie des hommes infâmes», Les Cahiers du chemin, n° 29, pp. 7-29.
Glissant É., 1981, Le discours antillais, Paris, Seuil.
Glissant É., 1990. Poétique de la relation. Paris, Gallimard.
Glissant É., 1996. Introduction à une Poétique du Divers. Paris, Gallimard.
Grandin G., 2015, « Capitalism and Slavery », The Nation, May 2015, [En ligne] : https://www.thenation.com/article/archive/capitalism-and-slavery/
Hartog F., 2003. Régimes d’historicité. Paris, Seuil.
Mbembe A., 2002. “The Power of the Archive and Its Limits”, in C. Hamilton et al. (ed), Refiguring the Archive, Boston: Kluwer Academic Publishers, pp. 19-26.
Niort J.-F., 2015, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Paris, Le Cavalier Bleu.
Pétré-Grenouilleau, 2004, Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris,Gallimard.
Ricœur P., 2000. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Seuil.
Scott D., 1997. ‘An Obscure Miracle of Connection’: Discursive Tradition and Black Diaspora Criticism. Small Axe 1, 19-38.
Simasotchi-Bronès F., 2014, « La trace à l’œuvre dans les premiers romans d’Édouard Glissant », Littérature, 2/174, pp. 18-32.
Spivak G. C., 1988, « Can the Subaltern Speak ? », in Cary Nelson, Lawrence Grossberg (ed.), Marxism and the Interpretation of Culture, Chicago, University of Illinois Press, p.271-313.
Stoler, A.L. 2009. Along the archival grain: Epistemic anxieties and colonial common sense. Princeton, Princeton University Press.
Trouillot M.-R., 1995, Silencing the Past. Power and the Production of History, Boston, Beacon Press.
Williams E., 1994 [14], Capitalism and Slavery, Chapel Hill, The University of North Carolina Press.