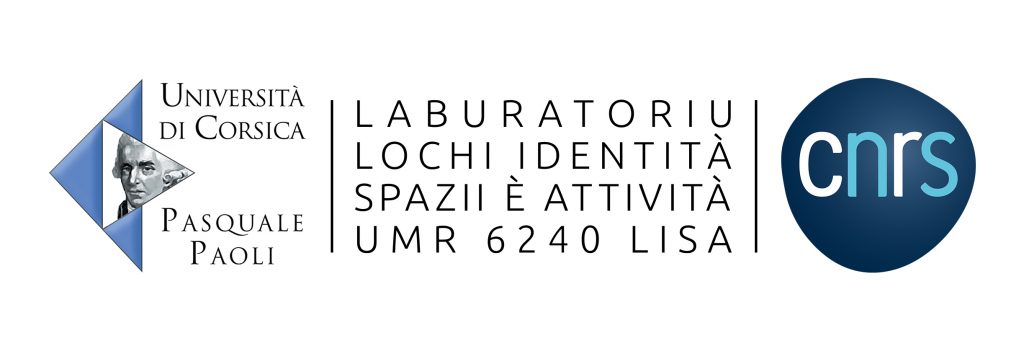De la théorie de l’état et de la notion de république en Islam
Florence Jean-Coppolani
Il ne peut être question de traiter en quelques lignes la théorie de l’Etat et la notion de république en islam. Les sources et la bibliographie sont considérables. Au fil des siècles, la théorie de l’Etat a fait l’objet d’abondants développements des plus grands auteurs : Al Mawardi au XIème siècle, Ibn Khaldûn au XIVème. Bon nombre d’islamologues et professeurs de droit ou de science politique se sont penchés sur ce sujet au XIXème. Louis Milliot y consacre son premier chapitre de son Introduction à l’étude du droit musulman, Bousquet l’évoque dans le titre II de sa deuxième partie de son Précis de droit musulman, Les institutions du droit public musulman d’Emile Tyan traitent cette question au fil de plusieurs centaines de pages et on pourrait prolonger longuement cette liste.
Sur les questions fondamentales de la genèse, de l’essence et de l’autorité de l’Etat, la pensée politique musulmane diffère finalement peu de la pensée occidentale. Le grand Ibn Khaldûn par exemple, dont l’œuvre repose en partie sur son expérience d’Etats musulmans du XIVème siècle, du Maghreb, du Machreq et d’Al Andalus, rejoint sur bien des points la tradition aristotélicienne et peut être lui-même présenté comme le précurseur de penseurs politiques européens de l’époque moderne et contemporaine.
Dans la théorie de l’Etat, les seuls éléments spécifiquement musulmans sont on le sait, des notions de umma, de califat ou imâmat ainsi que leur succédané, le sultanat. Il s’y est ajouté récemment, au XXème siècle, la notion de république islamique. Ces notions sont généralement présentées comme ayant un fondement éminemment religieux. En réalité, elles ne trouvent que peu de références précises dans le Coran. Leurs théories relèvent essentiellement des interprétations des théologiens, philosophes et juristes.
I – Peu de précisions sur le califat ou l’imâmat dans le Coran
Voulue par le Prophète après l’Hégire et définie dans ce qu’il est coutume d’appeler « la Constitution de Médine » (dustûr al madinat), la umma regroupe les fidèles demeurant aussi bien en pays d’Islam (dâr al islam) que dans les autres contrées (dâr al harb) soumis à la même Loi et ayant le même objectif de victoire de l’islam. Comme lui, elle est universelle. Elle transcende tous les clivages raciaux, tribaux et nationaux et ne se cantonne pas dans un espace géographique limité. Son originalité tient à ce qu’elle est fondée sur l’appartenance à une même religion et non sur les liens du sang, comme c’était le cas dans la société traditionnelle antéislamique.
Elle joue un rôle politique et juridique. Dans les premiers siècles de l’Islam, le consensus de la umma se révèle nécessaire pour l’entrée en guerre et valide les sources secondaires du droit. Ce consensus est aujourd’hui considéré par certains comme pouvant entériner les évolutions nécessaires du droit initiées par le néo-ijtihâd. Dans le même temps, l’universalisme de la umma s’oppose aux divers nationalismes et induit des tendances unitaires tant sur le plan international qu’au sein des populations musulmanes émigrées hors des pays d’Islam.
Dans le Coran, les tenants du pouvoir politique sont évoqués de façon allusive ou indirecte :
« C’est lui [Allah] qui a fait de vous ses lieutenants sur la Terre. Il a élevé certains d’entre vous de plusieurs degrés au-dessus des autres pour vous éprouver en ce qu’il vous a donné » (VI, 165) ;
« Souvenez-vous, il vous a désignés comme ses lieutenants après les ‘Ad et il vous a établis sur la Terre » (VII, 74) ;
« Nous vous avons établis sur la Terre après eux (les prophètes) comme leurs successeurs afin de voir comment vous agiriez » (X, 14) ;
« Dieu a promis à ceux d’entre vous qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes d’en faire ses lieutenants sur la Terre (XXIV, 55).
David est nommément désigné comme l’un des lieutenants de Dieu sur Terre[1] et le verset 30 de la sourate II évoque même négativement la nomination d’un lieutenant de Dieu sur la Terre : « Lorsque ton Seigneur dit aux anges : « je vais établir un lieutenant sur la Terre », ils dirent : vas-tu établir quelqu’un qui fera le mal et qui répandra le sang (…) ? ».
Page 1
Finalement, l’institution du califat n’apparaît qu’après la mort du Prophète. Le terme qui signifie originellement successeur est utilisé lors de l’accession d’Abu Bakr (khalifa rasuli lah). Par la suite, l’institution va être façonnée par l’histoire au fil de la succession des califes. Dans un premier temps, les califes se sont succédé selon des procédures de choix variées, la seule constante étant que l’imâm devait être qoraychite donc appartenir à la famille du Prophète.
L’assassinat de ‘Uthman en 656 suscita l’opposition des Alides, issus de ‘Ali et de Fatima et [de ?] la famille des Omeyyades dont faisait partie ‘Uthman. C’est de là que découle la scission Sunnites/Chiites/Kharijites autrement appelée la grande fitna[2]. Les principes de dévolution du califat sont au cœur de cette division. Pour les Sunnites largement majoritaires, le calife doit appartenir à la tribu des Qoraych mais sa nomination doit recevoir l’agrément de la umma, ou du moins d’une représentation symbolique de celle-ci, et sa souveraineté ne peut s’exercer que grâce au serment d’allégeance[3] prêté par les puissants membres de son entourage et par les populations. Chez les Chiites, la légitimité de la transmission de l’imâmat réside dans le choix que fait l’imâm de son successeur. Quant aux Kharijites très minoritaires, ils sont partisans d’un califat électif.
Au-delà de ces divisions, les contours de l’institution du califat et de l’imâmat vont être encore compliqués ou même brouillés par son évolution au Moyen Age et à l’époque moderne. Les califes du Bas Moyen Age n’ont plus qu’une autorité temporelle limitée voire virtuelle. La réalité du pouvoir étant détenue par des émirs et des sultans. De 1516 à 1922, le califat ottoman apparaît surtout comme une autorité religieuse supérieure (« inter-islamique »).
L’ouvrage de référence sur la théorie orthodoxe sunnite du califat est celui d’Al Mawardi dont le titre de la traduction française est Les statuts gouvernementaux. Le califat y occupe le premier chapitre intitulé le statut d’imâmat. Al Mawardi y développe les règles de dévolution du califat qu’il tire des expériences historiques. Il présente deux dispositifs.
Le premier est l’élection de l’imâm ou calife par un petit nombre de personnes compétentes pour effectuer le choix de l’imâm, qui doivent remplir des conditions d’honorabilité, de savoir, de jugement et de sagesse. Quant aux conditions d’éligibilité à l’imâmat, elles sont au nombre de sept : 1° une parfaite honorabilité ; 2° une science lui permettant d’examiner toute question et de rendre son jugement ; 3° l’intégrité des sens ; 4° la validité (l’imâm ne doit pas être handicapé moteur) ; 5° la capacité d’administrer le peuple ; 6° la bravoure et l’énergie pour lutter contre les ennemis ; 7° l’appartenance à un lignage qoraychite. Cette dernière exigence est soulignée par Al Mawardi comme unanimement requise et il rejette toute opinion divergente affirmant l’éligibilité de tout homme quelconque. Il appuie cette position sur la parole du Prophète rapportée par Abu Bakr[4].
Les électeurs ayant pouvoir de « lier et délier », qui peuvent se réduire d’ailleurs à trois personnes, doivent se réunir pour examiner les candidats à l’imâmat remplissant les conditions requises et choisir le plus méritant et celui à qui le peuple est le plus à même d’obéir. En cas de contestation, le collège des électeurs peut trancher ou recourir au sort. La contestation d’un candidat ne vicie pas la nomination à condition que le conclave n’ait éliminé d’avance aucun prétendant. Une fois sa nomination portée à la connaissance du peuple, le calife ou imâm doit être obéi ipso facto.
Le second dispositif est la désignation de l’imâm ou calife par son prédécesseur. Celui qui est ainsi désigné doit remplir les conditions requises et doit être le plus digne d’exercer la fonction. La désignation est irrévocable à moins que l’héritier n’ait changé.
Que le calife soit investi par une élection ou la désignation de son prédécesseur, le calife doit être reconnu par la communauté musulmane qui doit s’en remettre à lui pour « toutes les affaires d’intérêt général sans rien faire sans ou contre ses ordres », ce qui fait de lui un autocrate.
Avant d’évoquer la nomination des califes au début du chapitre, Al Mawardi s’est posé rapidement la question de la nécessité de l’imâmat, de sa raison d’être et du fondement de son autorité. Après avoir dit que la raison d’être de l’imâmat est de suppléer le prophétisme après la disparition de Muhammad, dernier des prophètes, Al Mawardi signale que s’il y a quasi-unanimité sur la nécessité de la fonction, les opinions se partagent sur le fondement de cette nécessité. Pour les uns, il serait rationnel et pour d’autres, religieux. Al Mawardi reconnaît que le fondement rationnel a une certaine pertinence mais il rappelle le verset 59 de la quatrième sourate : « Ô vous qui croyez ! Obéissez à Dieu ! Obéissez au Prophète et à ceux d’entre vous qui détiennent l’autorité ! »[5]. Selon Al Mawardi, le Prophète a
« donc imposé catégoriquement d’obéir à ceux d’entre nous qui commandent, c’est-à-dire aux imâms ».
Et Al Mawardi de conforter cette opinion par une déclaration du Prophète rapportée par l’un de ses compagnons Abu Horeira :
« D’autres chefs après moi vous commanderont, le pieux d’après sa piété, le pervers d’après sa perversité, mais écoutez-les et obéissez à tout ce qui est conforme à la vérité : s’ils font bien, cela vous servira et leur servira ; s’ils font mal, cela vous servira et leur nuira »[6].
Page 2
La nécessité de l’imâmat étant établie, Al Mawardi ajoute que « cette charge constitue un devoir de solidarité, comme sont par exemple ceux de la guerre sainte et de la recherche de la science ».
Dans ses Prolégomènes ou Muqaddima, Ibn Khaldûn, trois siècles plus tard, est revenu sur la question du besoin du pouvoir politique. Il commence par affirmer « la nécessité absolue d’une organisation sociale entre les hommes » et que « toute société doit avoir un modérateur qui la gouverne ». Ayant posé que ce qui légitime l’Etat est un double contrat de société et d’autorité symbolisé par le serment d’allégeance, que « la monarchie prend son véritable sens quand le monarque défend ses sujets », Ibn Khaldûn manifeste sa préférence pour une autorité reposant sur la religion :
« Parfois l’autorité supérieure repose sur la loi d’une religion révélée. Le peuple doit s’y soumettre, parce qu’il en sera récompensé ou puni dans l’Autre Monde comme son Législateur le lui a prédit. Parfois, le pouvoir n’est qu’une politique rationnelle (siyâsa). Dans ce cas, il est obéi dans l’espoir d’être récompensé par lui, quand il aura appris ce qui est bon pour ses sujets. Le premier système est bon pour ce monde et pour l’autre, puisque le Législateur connaît les fins dernières de son peuple, il s’occupe du salut éternel de l’homme. Le second système n’est bon que pour ce monde ».
Ainsi, un bon gouvernement respecte « les lois religieuses, ensuite les maximes des philosophes et enfin, les modèles des rois passés ». Mais évoquant le verset 34 de la sourate XXVII (les Fourmis) dans laquelle la reine de Saba, Bilqis, dit
« Quand les rois pénètrent dans une cité, ils la saccagent et ils font de ses plus nobles habitants, les plus misérables des hommes. C’est ainsi qu’ils agissent », Ibn Khaldûn rappelle que « Muhammad a blâmé la monarchie et les monarques. Il les a blâmés pour leur amour des plaisirs, leur vaine prodigalité et leurs déviations en dehors de la voie de Dieu » et que « quand le Législateur condamne le pouvoir royal (…), il le blâme de régner par des moyens futiles et d’utiliser les hommes à des fins personnelles ». Ainsi, le pouvoir temporel, la monarchie, l’Etat, apparaissent de façon négative. Le calife, successeur du Prophète, doit prolonger la mission de ce dernier comme guide religieux. Pour Ibn Khaldûn, « le dessein du Législateur vis-à-vis de l’humanité est d’assurer son bonheur dans l’autre vie (…), faire agir le peuple selon la loi religieuse (…). L’autorité nécessaire pour cela a d’abord été incarnée par le Prophète, représentant la loi religieuse puis par ses successeurs : les califes. (…) Le califat est en vérité un intérim de l’auteur de la loi sacrée visant à sauvegarder la religion et à la mettre en application dans la gestion de la vie terrestre ». Ainsi, il est significatif que le calife soit appelé aussi imâm comme celui qui dirige la prière, sa fonction est avant tout religieuse. Le calife est le « grand imâm ».
Le calife est essentiellement une autorité religieuse supérieure et non le chef temporel de l’ensemble des musulmans. Cela rejoint la pensée d’auteurs contemporains tels que le cheikh ‘Ali Abderraziq selon lequel l’institution d’un califat à la tête d’un grand Etat islamique universel ne repose sur aucun fondement légal ou rationnel. Et d’ailleurs, de son vivant, le Prophète, affirme ce docteur de l’Université Al Azhâr, n’a fait aucune allusion à un Etat islamique, ni à ses principes d’organisation et il ajoute que « les théologiens n’ont pu produire le moindre hadith dans leur argumentation sur ce sujet ».
De nos jours, le califat a pris la dimension d’un véritable mythe. Comme l’a montré le professeur Ali Mérad dans son ouvrage[7],
« les discours islamiques contemporains exaltent l’éthique de l’unité, à la fois comme valeur inhérente au message coranique et comme nécessité pour la renaissance du monde musulman. Dans ce dessein, les uns militent pour le retour au modèle original du califat, lorsque ce concept était synonyme de grandeur et de rayonnement dans les domaines de la culture et de la civilisation. Pour d’autres, le réalisme politique inciterait à privilégier un califat à vocation purement spirituelle… ».
Cette position permet aux pays majoritairement peuplés de musulmans d’organiser l’Etat autrement que sur le modèle autocratique du califat mythique confinant à la monarchie absolue. Leur organisation peut prendre des formes institutionnelles variées quitte à faire de l’islam la religion d’Etat, la première source d’inspiration des normes juridiques, voire la religion obligatoire des dirigeants, sans pour autant être obligé de remplacer le concept de califat par celui de république islamique.
II – La république islamique, concept récent sans référence précise dans la chari’a
En effet, ce régime adopté aujourd’hui par l’Iran, le Pakistan, l’Afghanistan et la Mauritanie ne peut se référer à aucun verset du Coran et à aucun hadith. Il est fondé sur le principe du velayat-e-faqih, mot à mot, tutelle du juriste religieux, expression utilisée pour désigner la prééminence du religieux sur le temporel, revendiquée par l’ayatollah Khomeyni au lendemain de la révolution de 1979.
La Constitution iranienne issue de cette révolution illustre cette notion par son dispositif, en particulier son article 5[8]. Et justement les articles 107 à 112 qui constituent le chapitre 8 de la constitution intitulé « Le Guide ou le Conseil des guides » qui est l’expression de la mise en œuvre de la velayat-e-faqih.
Ce principe au cœur de la doctrine de Khomeyni et qui est présenté comme le seul moyen d’imposer une politique conforme à l’islam est en contradiction avec la doctrine chiite traditionnelle qui se caractérisait justement par rapport aux Sunnites par un pluralisme des autorités religieuses et par leur autonomie vis-à-vis de l’Etat.
Cette tutelle religieuse des organes exécutifs (Président de la République), législatif (Assemblée législative islamique) ainsi que sur l’ensemble des instances constitutionnelles aboutit à l’évidence à une forme de dictature ou tout au moins à une démocratie totalitaire.
III – Les autres formes de république en islam
Ainsi, les dérives d’une interprétation erronée, ou tout au moins tendancieuse et utopique de la chari’a aboutissent avec le califat mythique à une monarchie absolue et avec la notion de république islamique à l’iranienne, à une démocratie totalitaire.
Heureusement, plusieurs Etats musulmans ont adopté une autre voie : l’Egypte, dont la Constitution de 2014 conserve néanmoins l’intégralité de l’article 2 de celle de 1971 selon lequel « les principes de la charia islamique sont la source principale de la législation », et la Tunisie tout récemment.
Pour ce qui est du Liban, on sait que c’est notamment sur le plan socio-communautaire qu’il se différencie des autres pays de la région. La diversité religieuse de la société libanaise est source de particularismes et de particularités. Le Liban se définit historiquement comme « la terre de refuge de peuples épars qui ont fui leur foyer d’origine à la recherche de la liberté et de la sécurité dans l’exercice de leurs croyances »[9].
Pour rappel, à la suite de la première guerre mondiale, après la dislocation de l’Empire ottoman, la France créa le Grand Liban, réunissant le Mont-Liban et la plaine de la Beqaa, sur la base des accords de Sykes-Picot de 1916 et de San Remo de 1920[10]. Placé par la SDN sous mandat français en 1920, le Liban accéda à l’indépendance le 22 novembre 1943 avec l’approbation du Général De Gaulle, alors chef de la France libre. Dix-sept communautés religieuses furent institutionnalisées par le Haut Commissariat sous le mandat français en 1936[11]. Selon l’article 2,
« la reconnaissance légale d’une communauté à statut personnel a pour effet de donner au texte définissant son statut, force de loi et de placer ce statut et son application sous la protection de la loi et le contrôle de l’autorité publique ».
Puis, apparut une 18ème communauté, la communauté protestante.
La République algérienne a été proclamée suite aux accords d’Evian de 1962. De tous les pays de l’Union du Maghreb Arabe qui regroupe les pays du Grand Maghreb[12], l’Algérie est celui dont la Constitution souligne le moins le lien entre l’Etat et l’islam. Lien qui n’en est pas moins indéniable et officiel.
La Constitution algérienne, comme beaucoup de constitutions arabes qui ont subi le « printemps arabe », a fait l’objet d’une révision votée le 7 février 2016 après cinq ans de tergiversations, révision qui devait montrer que le pays était en marche vers la démocratisation.
Si l’Algérie, république démocratique et populaire, et présentée comme une « terre d’islam, partie intégrante du grand Maghreb », selon l’article 1er de ladite Constitution, en est une, elle ne choisit pas l’intitulé de république islamique.
Ce qui caractérise ces républiques et les différencie notamment de la République française, c’est le lien officiel avec la religion et l’obligation pour le futur chef d’Etat, d’être de confession musulmane. Le seul exemple qui contredit cette acception, c’est la Turquie de Mustafa Kémal Atatürk qui dans le cadre de sa politique de laïcisation de l’Etat, eut pour objectif de se débarrasser de l’obscurantisme religieux le plus archaïque et réactionnaire mais l’histoire de ce pays et l’actualité en ont décidé autrement…
Page 4
[1] Sourate XXXVIII, 26.
[2] Al fitna al kubra.
[3] Bay’a – qui se fait par la dation des mains, comme l’hommage féodal en Occident.
[4] « Les imâms sont de la race des Qoraych ».
[5] Il aurait pu d’ailleurs citer aussi le verset 80 de la même sourate selon lequel « ceux qui obéissent au Prophète, obéissent à Dieu ».
[6] Ce hadith est à rapprocher de la phrase de Bossuet dans La politique tirée des propres paroles de l’Ecriture Sainte : « Obéissez à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et modérés, mais encore à ceux qui sont fâcheux et injustes ».
[7] Le califat, une autorité pour l’islam ?
[8] « Pendant l’occultation de Sa Sainteté le Maître du temps –Dieu le Très Haut veuille réduire l’attente–, la régence exécutive et la direction de la communauté islamique des croyants dans la République islamique d’Iran appartiennent au jurisconsulte religieux (faqih) juste, vertueux, conscient des problèmes de l’époque, courageux, capable de diriger, avisé, qui assume ces fonctions conformément à l’article 107 ».
[9] G. CHARAF, Communauté et pouvoirs au Liban, Centre libanais de documentation et de recherche, Beyrouth, 1981.
[10] Ces accords d’ailleurs feront capoter l’idée d’un royaume arabe unifié.
[11] Arrêté n°60 LR 18/3/36 de vingt-cinq articles, modifié par arrêté n°146 LR. Le Haut Commissariat avait une mission de contrôle politique et de maintien de l’ordre. Il avait d’ailleurs des pouvoirs de police et pouvait recourir à la force armée. Cf. M. HAYEK, Centre-périphérie dans un système multicommunautaire, le cas du Liban, thèse en science politique, Université de Toulouse, 2003.
[12] D’est en ouest, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie.
D'autres articles

La Loi Toubon et la Loi 101 de la philosophie au droit : la France et le Québec entre républicanisme et libéralisme
Comme les travaux menés par Joseph-G. Turi à la fin des années 1980 l’ont démontré, les législations linguistiques québécoise et française visaient toutes deux la consécration d’une seule langue officielle, mais avaient fait l’objet d’interprétations plutôt favorables à une langue autre[2]. Depuis…

Pasquale Paoli et sa documentation sur les régimes mixtes de l’Antiquité
Qu’est-ce que les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle ont cherché dans la documentation antique à propos des régimes mixtes et, surtout, qu’y ont-ils trouvé ? C’est une question que l’on abordera en la circonscrivant à des limites raisonnables, c’est-à-dire à un personnage, Pasquale Paoli, et à sa…

Échanges avec Vincent Peillon
Jean-Guy TALAMONI
Merci, Vincent Peillon, pour cette conférence qui ouvre des pistes et présente des idées nouvelles, à plusieurs titres. Il serait intéressant qu’il y ait un échange avec les collègues qui sont présents à ce colloque. D’autant que…