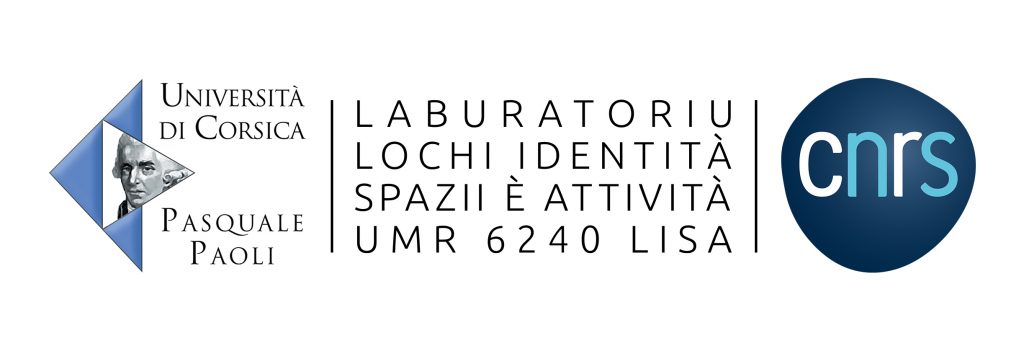Démocratie et représentation chez les premiers républicains français (1789-1792)
Sandy Autard
La source de tous nos maux c’est l’indépendance absolue, où les représentants se sont mis eux-mêmes à l’égard de la nation, sans l’avoir consultée. Ils ont reconnu la souveraineté de la nation, et ils l’ont anéantie. Ils n’étoient, de leur aveu même, que les mandataires du peuple, ils se sont faits souverains, c’est-à-dire despotes. Car le despotisme n’est autre chose que l’usurpation du pouvoir du souverain.[1]
Formulés dans Le Défenseur de la Constitution à l’été 1792, alors que la monarchie s’éteint brutalement pour laisser place à la république, ces mots de Robespierre résument une pensée politique en germe dans le camp républicain développant avec précocité une conception propre de la représentation. Dès 1789, ce « républicanisme avant la république »[2], qui pose déjà en partie les bases de celui de 1792, se fait notamment jour sous la plume d’auteurs comme Desmoulins, Brissot, Marat, Robespierre, Pétion, Bonneville, l’abbé Fauchet, François Robert et son épouse Louise Guinement de Kéralio, Carra, Prudhomme, ou encore Lavicomterie. Ce républicanisme de principes, aspirant d’abord par stratégie à modeler progressivement la monarchie à l’aune de l’ethos républicain, se mue en un républicanisme institutionnel, prônant l’abolition de la monarchie et l’instauration d’un gouvernement démocratique. Il se renforce et se radicalise concomitamment aux trahisons successives de Louis XVI.
S’inscrivant dans une longue tradition, de l’Antiquité à la révolution américaine en passant par les cités italiennes de la Renaissance et l’Angleterre du XVIIe siècle[3], les radicaux français réceptionnent une pensée politique et une conception républicaine de la liberté[4] aujourd’hui qualifiée de « non domination »[5]. Comprise comme l’absence d’interférence arbitraire, effective ou potentielle, cette conception précède celle de la liberté comme simple « non interférence », glorifiée ensuite par les libéraux[6]. Une telle vision, selon laquelle un peuple n’est libre que lorsqu’il est soumis aux lois auxquelles il a consenti, légitime aux yeux des républicains français du XVIIIe siècle l’établissement d’une république démocratique reposant sur la souveraineté du peuple. Or, au regard de l’étendue du territoire français, la représentation se révèle comme le seul moyen de mettre en place un tel gouvernement. Cette question se pose concrètement dans le cadre parisien dès juillet 1789 où naît une forte opposition entre les districts et l’Assemblée des Représentants de la Commune, chargée d’élire les membres de l’Assemblée nationale, les premiers se targuant de pouvoir révoquer les mandats confiés aux députés et refusant de reconnaître une assemblée intermédiaire[7].
Page 1
[3] Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin…
[4] François Quastana et Pierre Serna, « Le républicanisme anglais dans la France…
[5] Philip Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement…
[6] Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil, coll. « Liber », 2016.
[7] Manuela Albertone, « L’apprentissage de la démocratie représentative à Paris…
Cette réflexion sur la représentation s’élargit rapidement pour s’étendre à la question de l’exercice du pouvoir législatif. Deux conceptions de la représentation éclosent alors dans l’hémicycle le 10 août 1791, l’une triomphante portée par Barnave pour lequel la qualité de représentant découle de la participation au pouvoir législatif, conférant au roi ce statut par son droit de veto, l’autre défendue notamment par Roederer, conditionnant la représentation à l’élection[8]. Les républicains, tout en souscrivant à cette dernière[9], la complètent en proposant une définition plus radicale et à bien des égards différente de celle libérale défendue entre autres par le camp monarchien. Dès 1789, ils pointent du doigt les failles d’un système purement représentatif, inspiré par l’Angleterre, qu’entend instaurer le comité de constitution dominé par Mounier. Ce dernier, regardant la sanction des lois dans les assemblées de districts comme la naissance de la « démocratie la plus orageuse »[10], reçoit le soutien de Clermont-Tonnerre qui estime que le mandat impératif constitue une entrave aux délibérations[11].
En revanche, les républicains, inspirés par Rousseau, ont bien conscience du décalage inévitable entre la volonté des représentants et celle des représentés. Ainsi, Pétion ne manque pas de dénoncer cette conception de la représentation selon laquelle les mandataires du peuple, une fois élus, devraient « jouir de la liberté la plus étendue »[12], en y opposant une lecture plus radicale du principe selon lequel la loi doit être l’expression de la volonté générale. Puisque le premier des droits des citoyens dans un régime libre, c’est-à-dire pour lui républicain, est « de participer à la création des lois sous l’empire desquelles ils consentent à vivre », il faut à l’en croire que chaque assemblée primaire puisse se prononcer à leur sujet[13]. Prudhomme, éditeur de la feuille républicaine des Révolutions de Paris, ne dit pas autre chose lorsqu’il accuse le comité de constitution de confier aux seuls députés le pouvoir de faire les lois créant ainsi une liberticide « aristocratie représentative » arguant que « l’organisation purement représentative est destructive de la liberté
publique »[14]. Ainsi, sous diverses formes, les premiers républicains français réclament un véritable droit de regard du peuple sur l’action de ses représentants, l’élection ne pouvant suffire à garantir le respect de la volonté générale.
Dès lors, contrairement à Sieyès soutenant que si les citoyens « dictaient des volontés, ce ne serait plus cet état représentatif ; ce serait un état démocratique »[15], nulle incompatibilité pour eux entre démocratie et représentation qui s’avèrent dans leur esprit des notions bien plus consubstantielles qu’antagonistes. Par ailleurs, si Rousseau supposait l’impossibilité de représenter la volonté générale en démocratie sans la dénaturer, les républicains français entendent résoudre cette aporie par l’adoption d’une conception spécifique de la représentation. Il semble ainsi nécessaire de revenir sur des visions classiques qui, sans être infondées, méritent d’être nuancées. Les républicains, parfois strictement divisés entre tenants d’une « république démocratique » et partisans d’une « république représentative »[16], se montrent en réalité favorables à la représentation dans le but d’instaurer la république démocratique qu’ils appellent de leurs vœux.
Page 2
[8] A.P., t. XXIX, Discussion du titre III du projet de Constitution, lors de la séance…
[9] Jacques-Pierre Brissot, Le Patriote français, n° 730, 9 août 1791, p. 164…
[10] A.P., t. VIII, Rapport de M. Mounier sur la nécessité de la sanction royale, lors…
[11] Stanislas de Clermont-Tonnerre, Œuvres complètes, t. 2, Paris, Chez Letellier…
[12] A.P., t. VIII, Suite de la discussion sur la permanence et l’organisation du…
[14] Louis-Marie Prudhomme, Révolutions de Paris dédiées à la nation, n° XXI…
Tout en s’imposant en panégyristes d’une « démocratie représentée » comme meilleur écrin pour l’exercice par le peuple de sa souveraineté (I), ils y accolent l’impérieuse nécessité d’encadrer l’action des représentants pour remédier au risque de les voir devenir absolument indépendants de leurs commettants, ce qui sonnerait immanquablement le glas de la liberté (II).
I. L’exercice de la souveraineté du peuple en république par la représentation : apologie de la « démocratie représentée »
D’emblée, les républicains rejettent l’idée d’une « démocratie pure » comme la connurent certaines cités de l’Antiquité. À la veille de la réunion imminente des États-généraux, Brissot met en garde contre les insuffisances du vote par tête chez un peuple encore trop peu républicain, contrairement aux sages Quakers de Pennsylvanie qui sont habitués dès leur plus jeune âge à délibérer et voter dans une grande assemblée[17]. À sa suite, Prudhomme dans Les Révolutions de Paris[18] comme Duchosal dans La Bouche de Fer[19] adoptent un même discours. Que la démocratie ait échoué dans les cités antiques ne présage cependant pas de la désuétude de ce gouvernement que les républicains français espèrent voir renaître grâce à un élément ayant cruellement fait défaut aux vertueux anciens : le système représentatif. Brissot prévient ainsi ses détracteurs de se garder d’en conclure à partir des exemples de l’Antiquité « que le Peuple est incapable de délibérer, & qu’il faut lui ôter le pouvoir législatif » car celui-ci « n’a jamais été mieux confié qu’à des démocraties représentatives »[20], thèse qu’il réitère lors de la crise de l’été 1791 lorsqu’il définit une république qu’il espère voir rapidement édifiée[21].
Même du côté des Cordeliers, présentés à juste titre comme les plus radicaux, le gouvernement représentatif est une évidence. Marat par exemple, parfois considéré à tort comme un partisan de la démocratie directe, souscrit au système représentatif, l’Ami du Peuple critiquant plus la corruption des représentants que le principe de la représentation[22]. Quant à Desmoulins, il estime que puisque « la nation en personne ne peut s’assembler », elle doit « déléguer son pouvoir, c’est-à-dire tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires à des représentans » mais qu’elle n’en demeure pas moins « toujours propriétaire de la souveraineté qui est inaliénable, d’où il suit qu’elle peut à sa fantaisie, ad nutum, modifier, restreindre, retirer ses pouvoirs »[23].
Mais s’il est clair que la représentation s’avère nécessaire à l’instauration d’une république démocratique, se pose inévitablement le problème déjà formulé par Rousseau[24] de l’inadéquation entre la volonté du peuple et les lois faites par les représentants. À cela, les radicaux apportent une solution fondée sur une conception proprement républicaine de la représentation. Dès 1790, Lavicomterie relève l’erreur de l’illustre Genevois, consistant à croire que dans un État moderne il n’existera jamais de véritable démocratie parce qu’il est impossible que le peuple demeure toujours assemblé pour régler ses affaires[25], problème soluble car :
La difficulté se réduit à rien devant une démocratie représentée. Je conçois que si la nation confiait des pouvoirs sans bornes à ses représentants, ce serait alors des pouvoirs très dangereux et nuls ; mais il n’en est pas ainsi : ils sont limités et la nation a toujours le droit d’improbation. Le peuple peut, dans tout pays, charger des députés de ses volontés, leur donner des pouvoirs qu’ils ne peuvent enfreindre.[26]
Page 3
[17] Jacques-Pierre Brissot, Plan de conduite pour les députés du peuple aux états…
[18] Louis-Marie Prudhomme, Révolutions de Paris dédiées à la nation, n° 47, 29 mai…
[19] Nicolas de Bonneville, Claude Fauchet, La Bouche de Fer, n° 88, 10 juillet 1791, p. 4-5.
[20] Jacques-Pierre Brissot, Plan de conduite pour les députés du peuple aux états…
[21] Jacques-Pierre Brissot, Le Patriote français, n° 696, 5 juillet 1791, p. 19…
[22] Émilie Bremond-Poulle, « Souveraineté populaire et pouvoir représentatif chez…
[23] Camille Desmoulins, Révolutions de France et de Brabant, n° 71, avril 1791, p. 257.
[24] Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (1762), Paris, Gallimard, coll. « Folio…
[25] Louis Lavicomterie, Du Peuple et des rois, 1790, p. 110.
Cette forme de « démocratie représentée », proche de la formule de « démocratie représentative » déjà employée par Condorcet[27], ne contredit en rien le principe de souveraineté du peuple mais permet au contraire sa réalisation, à condition de ne jamais considérer les députés comme indépendants. Lavicomterie reprend ainsi la distinction entre le pouvoir, capacité d’agir pouvant être délégué, et la souveraineté inaliénable, comprise comme la capacité de vouloir dont le peuple demeure l’éternel titulaire. Car ici, « charger des députés de ses volontés » ne signifie pas pour le peuple se dépouiller de sa souveraineté, mais confier aux représentants la capacité de présumer la volonté générale tout en agissant sous le contrôle du peuple détenteur d’un droit de correction s’ils s’en éloignent. Le problème de la contradiction potentielle entre la volonté générale et les lois prises par les représentants se résoudrait ainsi par un contrôle des députés par le peuple, une idée fort populaire dans le milieu radical.
Cet apparent désaccord entre Rousseau et les républicains français provient en réalité d’une acception différente de la notion de « représentants » ainsi que le relève peu après François Robert. Reconnaissant d’abord avec Rousseau la perfection théorique de la démocratie pure, il présente la démocratie représentative comme le gouvernement le plus approchant :
L’immortel citoyen de Genève nous a dit que le gouvernement représentatif ne pouvoit être libre, et que les sujets d’un tel gouvernement ne jouissent de leur liberté que dans le moment des élections des représentants. J.J. ne s’est pas trompé, si par gouvernement représentatif, il a exclusivement entendu parler d’un gouvernement tel que celui de l’Angleterre, où les représentans sont législateurs absolus dès qu’ils sont nommés ; mais ce grand homme a partagé l’erreur de son siècle, s’il a cru qu’il étoit impossible d’introduire une forme de gouvernement représentatif ; où les représentans ne fussent que représentans, et ne pussent faire des loix sans, et contre la volonté des représentés.[28]
Pour François Robert, Rousseau est dans le vrai en critiquant la représentation s’il l’entend comme en Angleterre où les députés demeurent indépendants, le seul droit d’élire constituant une liberté somme toute illusoire comme l’écrira également Condorcet[29]. C’est d’ailleurs à cette forme de représentation que Prudhomme fait, avec le citoyen de Genève, le procès pour en conclure que, si la représentation est nécessaire, il faut, dit-il à ses concitoyens, « vous faire représenter le moins que vous pourrez, et faire par vous-même tout ce que vous pourrez »[30], la seule faculté d’« élire des hommes, pour qu’ils veuillent bien prendre la peine d’être nos maîtres » constituant une liberté fictive, un fantôme de liberté[31].
Pourtant, Rousseau entrevoit déjà une forme réconciliation entre démocratie et représentation lorsqu’il envisage le cas où « les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires » et que « toute loi que le peuple en personne n’a pas ratifiée est nulle »[32]. Malgré une méfiance de principe envers la représentation qu’il exprime avec intransigeance dans le Contrat social, Rousseau conviendra finalement de sa nécessité et proposera dans ses Considérations sur le gouvernement de Pologne des moyens pour prévenir la corruption des représentants, notamment par le mandat impératif, la régularité des élections et le maintien des assemblées populaires[33]. Il se rapproche ainsi de la conception de la représentation que développe ici François Robert qui n’a rien de comparable avec celle qu’il répudie. Au demeurant, la notion de « représentant » telle que conçue par l’avocat liégeois rejoint plutôt ce que le Genevois entend par celle de « commissaires », ce dernier se fourvoyant dès lors qu’il suppose impossible l’existence d’une représentation démocratique. François Robert ne peut donc être qualifié sans nuance de contempteur de la représentation, celle-ci lui apparaissant comme la condition même de l’existence d’une république démocratique. Tout l’apport des premiers républicains français est d’avoir cru cette forme de gouvernement possible et de s’être penchés sur les mécanismes de contrôle des députés pour s’assurer de l’adéquation de leur action avec la volonté générale.
Page 4
[28] François Robert, Le républicanisme adapté à la France, 1790, p. 89
[29] Nicolas de Condorcet, De la nature des pouvoirs politiques dans une nation…
[30] Louis-Marie Prudhomme, Révolutions de Paris dédiées à la nation, n° XI, 19…
[31] Ibid., n° XXI, 28 novembre-5 décembre 1789, p. 10.
[32] Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op. cit., livre III, chap. XV, p. 251-252.
[33] Julien Boudon, Les Jacobins, une traduction des principes de Jean-Jacques…
L’idée de « démocratie représentée » résout ainsi cette apparente inconciliabilité et se voit partagée dans le camp républicain. Ainsi, Condorcet défend la « démocratie représentative », qu’il oppose aux délétères « démocraties immédiates », comme le moyen de promouvoir une république exigeant que « la nation est libre quand elle n’obéit qu’à des loix conformes aux principes du droit naturel reconnus par elle »[34]. Cette idée se perpétue une fois la république instaurée comme en témoigne une lettre de Brissot à Bonneville en octobre 1792. Il y critique la « démocratie pure » des républiques anciennes, dont le malheur est de n’avoir jamais connu la « démocratie représentée » car, rappelle-t-il, « le républicanisme que nous prêchons n’est qu’une démocratie représentée dans tous les pouvoirs »[35]. Brissot finit donc par employer l’expression de Lavicomterie malgré un désaccord précédent au sujet de sa mise en œuvre.
Ce différend, sur le plan théorique, entre les deux républicains s’établit au mois de juin 1791, moment fatidique de montée en puissance du républicanisme renforcé ensuite par l’arrestation du roi à Varennes. Les droits du peuple sur l’Assemblée nationale, pamphlet publié par Lavicomterie, ouvre le dialogue lorsque, protestant dans le chapitre IX contre le projet de réduction du nombre de députés, il défend au contraire la nécessité de l’accroître pour assurer une représentation nationale plus fidèle. Car si ces députés, plus nombreux, pourraient ainsi apporter « des mandats précis réformateurs pour toutes celles [les lois] de la législature précédente que la nation voudra changer », ils auront de surcroît l’obligation de soumettre à la « ratification du peuple » dans les cantons les décrets proposés par l’Assemblée nationale[36].
C’est en revanche là que le bât blesse pour Brissot qui attire l’attention de ses lecteurs sur la mauvaise compréhension du principe de souveraineté populaire par, selon ses termes, cet « ardent défenseur du peuple » qui s’en fait malgré lui « son plus cruel ennemi »[37]. Pour l’auteur du Patriote français, « s’il est un moyen de n’avoir ni loi, ni liberté, c’est de vouloir faire ratifier toutes les lois par les six mille assemblées primaires »[38]. Sans renier le principe de la sanction populaire, il entend réserver cette dernière aux seules lois constitutionnelles et en conteste l’application aux lois ordinaires[39], une distinction également opérée plus tôt par Condorcet[40]. L’ultime confrontation se retrouve dans le Patriote français du 22 juin 1791 dans lequel Brissot publie une lettre de Lavicomterie, insistant sur la sanction populaire des lois, pour lui répondre en ces termes :
J’ai dit que le moyen de n’avoir ni loi, liberté, c’est d’exiger que chaque loi soit ratifiée par les 6000 assemblées primaires. Vous le niez, et vous ne donnez aucune raison, je vais vous en donner moi. Imaginez tel moyen que vous voudrez, pour obtenir le vœu de 6000 assemblées primaires sur chaque loi ; réduisez-les à n’opiner que oui ou non, ce qui est réduire à zéro leur droit de législature, toujours est-il que, pour chaque vœu, il faudrait employer un temps prodigieux ; à peine pourriez-vous avoir cinq à six lois dans l’année.[41]
Arguant que cette méthode chronophage ne permettrait en rien de refléter la volonté du peuple, il en conclut que la liberté est bien plus susceptible d’être violée « quand chaque petite faction de la société s’arroge le droit de juger, d’exercer la souveraineté, que lorsque ce droit est exercé par quelques délégués temporaires »[42]. Au contraire, la fabrication des lois par un corps législatif, sans ratification systématique du peuple, garantit à ses yeux le triomphe de la volonté générale contre les intérêts particuliers. Mais que les lois ordinaires soient mieux faites par un corps législatif unique que par une multiplicité d’assemblées primaires ne suppose pas, même pour Brissot, de placer les députés dans un état de totale indépendance. Cette confiance en l’action du législateur se voit résolument conditionnée à un contrôle minimal des députés comptables devant le peuple. S’il entend accorder une certaine liberté aux représentants, il n’oublie pas pour autant le danger à les rendre absolument indépendants comme en Angleterre où ils « peuvent trahir les intérêts du peuple sans avoir autre chose à craindre que de n’être plus élus ». Il préconise donc que le peuple puisse « s’opposer aux abus que les représentans feroient de leurs pouvoirs, ou punir ceux qui trahiroient la confiance que la nation auroit mise en eux »[43].
Cependant, on ne saurait voir dans cette opposition entre Brissot et Lavicomterie deux conceptions éminemment différentes de la représentation. Tous deux préconisent un encadrement de l’action des représentants par le peuple, et divergent surtout quant au degré de ce contrôle. Aux yeux des républicains, il n’est en effet de plus grave atteinte à la souveraineté du peuple que l’accaparement du pouvoir législatif par des élus déliés de toute obligation envers leurs commettants.
Page 5
II. La préservation de la souveraineté du peuple par l’encadrement des représentants : prévenir « l’indépendance absolue »
L’indépendance absolue des représentants, qui ouvre pour les républicains la voie au despotisme de l’Assemblée nationale, se trouve consacrée par la Constitution de 1791 instituant, malgré ses bases républicaines originelles, une conception in fine dangereuse de la représentation. Immédiate est sa condamnation par les radicaux comme l’Ami du Peuple fustigeant les propos de Barnave qui, à la suite à la révision feuillante, soutient que, pour le peuple, « sa véritable manière d’exprimer sa volonté [est] par les élections »[44]. Marat n’a ensuite de cesse de dénoncer comme principal vice du texte « d’avoir rendu nos mandataires indépendants de leurs commettans » et, partant, « d’avoir dépouillé la nation de sa souveraineté pour en revêtir ses représentans »[45]. À cette indépendance des députés, les républicains entendent porter remède en les contrôlant, le caractère plus ou moins prononcé de ce contrôle témoignant plutôt d’une divergence quant à son mode d’exercice que d’une conception différente de la représentation.
D’aucuns préconisent un encadrement régulier de leurs actions d’abord par une forme de reddition des comptes conformément à l’article XV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Marat avertissait déjà en 1789 que, si la représentation se révèle nécessaire puisque le peuple ne peut s’occuper continuellement des affaires de l’État, enchaîner les représentants à leurs devoirs en se ménageant « les moyens de les y rappeler lorsqu’ils s’en écartent et de les punir lorsqu’ils les violent »[46] s’avère tout autant indispensable. Leur attitude lors de l’insurrection du 10 août 1792, passant pour la majorité de contre-révolutionnaires à bons patriotes, démontre à ses yeux leur opportunisme, leur versatilité, et, partant, qu’ils n’hésiteront pas à faire machine arrière si l’occasion se présente[47]. Robespierre le rejoint sur ce point en soutenant sans détour que :
La nation sera donc encore d’avis que, par une loi fondamentale de l’état, à des époques assez rapprochées pour que l’exercice de ce droit ne soit point illusoire, les assemblées primaires puissent porter leur jugement sur la conduite de leurs représentants ; ou qu’elles puissent au moins révoquer, suivant les règles qui seront établies, ceux qui auront abusé de leur confiance.[48]
Accusant la Constitution de 1791 d’avoir délié les représentants de la nation, il prêche en ce moment charnière pour une responsabilité perpétuelle des députés devant leurs commettants, le salut de la patrie ne pouvant reposer sur une foi aveugle en leur vertu, plutôt supposée qu’assurée. L’élection conditionnant la représentation ne peut donc se suffire à elle-même et doit être complétée par un droit de regard à des époques régulières sur la conduite de ses représentants pour les révoquer en cas d’abus. Et bien que cette forme de reddition des comptes doive s’exercer dans le cadre d’une procédure préétablie, la nation, ajoute Robespierre, « voudra encore que, lorsqu’elle sera assemblée, nulle puissance n’ose lui interdire le droit d’exprimer son vœu sur tout ce qui intéresse le bonheur public »[49].
Dans son Instruction sur l’exercice du droit de souveraineté, Condorcet se penchait déjà sur ce droit éternel pour le peuple de s’exprimer en soutenant la légitimité de son vœu spontané en cas d’usurpation de ses droits par les représentants tenant le pouvoir législatif « non d’un droit réel, mais de la confiance dont ils sont les dépositaires présumés »[50]. Comme le rappelle Pierre Serna, malgré la Constitution de 1791, certains révolutionnaires prônent une forme « d’auto-représentation » en contestant la capacité des représentants à tout représenter et justifient l’insurrection, en témoignent les propos de Louis XVI craignant la trop grande influence des clubs dans la vie politique[51].
Si Condorcet ne donne pas davantage de précisions, Lavicomterie propose un mécanisme pour assurer au peuple le droit de désapprouver formellement les décrets des représentants. Répondant à Brissot, qu’il ne cite pas mais que l’on reconnaît aisément, il précise dans sa République sans impôts sa conception de la sanction populaire des lois qu’il envisage désormais comme tacite. Rappelant la nullité à ses yeux des décrets non approuvés par la nation, il n’en conclut pas à une ratification systématique des lois par les six mille assemblées primaires, mais à l’attribution par le peuple de « mandats réformateurs » aux députés de chaque nouvelle législature chargés, suivant son vœu, de modifier ou de garder le silence sur les précédents décrets et d’en proposer de nouveaux. La liberté d’action, qu’ils retrouvent une fois cette mission accomplie, se verra alors contrôlée par la législature suivante[52]. Ce droit qu’il nomme « droit d’approbation tacite », ou « droit d’improbation formelle »[53], réunit alors à ses yeux l’avantage de réaliser la pleine souveraineté du peuple en lui permettant de juger le travail de chaque législature sans en passer par une procédure chronophage. Peu avant, Pierre-Nicolas Gautier s’en approchait lorsqu’il reconnaissait le silence d’une nation comme signe d’adhésion tacite aux décrets et la réclamation formelle contre ces derniers comme un ordre pour les abolir ou les réviser[54].
Page 6
La régularité des élections, la reddition des comptes, et l’adhésion tacite s’avèrent toutefois insuffisantes pour une partie des républicains privilégiant une approbation formelle du peuple. En témoigne une lettre adressée au Cercle social en juillet 1791 dans laquelle son auteur anonyme croit voir dans le Républicain, publié par Condorcet et Paine, l’apologie d’une représentation absolue. Il les accuse de ne vouloir :
que le gouvernement représentatif, le représentant infaillible, puisque le représenté ne peut point revenir sur les décrets, dès-lors plus de sanction populaire, plus de liberté, car la liberté bien conçue n’est autre chose que le droit de ratifier les loix, de refuser les mauvaises, de recevoir les bonnes. Or, dès que la sanction n’existe pas, la communion ou l’accord universel des volontés, toutes dirigées vers un même objet, la loi qu’il faut admettre ne peut exister.[55]
Sans doute cet « Ami de la Vérité » se réfère-t-il à la lettre de Thomas Paine, publiée dans le premier numéro, dans laquelle l’auteur du Common Sense présente « le vrai système républicain, par élection et représentation » comme « le seul moyen possible de proportionner la sagesse et les connoissances du gouvernement à l’étendue d’un pays »[56]. L’accusation portée contre Paine et Condorcet semble pourtant excessive au regard de l’importance qu’ils accordent à la souveraineté du peuple. Quoi qu’il en soit la publication de ce paragraphe suscite l’intérêt de Bonneville et Fauchet qui, tout en estimant le Républicain emprunt « d’excellens principes », reconnaissent à l’auteur anonyme que « les objections qu’il contient ont quelques fondemens »[57]. Ils se montrent en effet, avec d’autres, partisans d’un contrôle plus strict des décrets votés par les députés.
François Robert suggère par exemple un encadrement de l’action des représentants par des « mandats impératifs desquels ils ne pourront se départir » dont il sera fait à l’Assemblée nationale un recensement général et « ce qui aura été commandé par la majorité sera décrété »[58]. Une fois le scrutin clos, les députés cesseraient selon lui d’y être « vinculés », du latin vinculum, autrement dit liés[59], sans pour autant les placer ensuite dans un état d’indépendance absolue. Bien conscient toutefois que ces mandats impératifs ne pourraient prévoir toutes les situations, il propose que ces « décrets portés par le corps législatif sans l’aveu et la participation des représentés, ne doivent être que des loix provisoires »[60], proposition partagée par une partie des républicains. D’aucuns prêchent en effet en faveur d’un droit de sanction populaire des lois, partageant ainsi l’exercice du pouvoir législatif entre délibération des représentants à l’Assemblée nationale, et décision des représentés dans les assemblées primaires. Notamment popularisée par Rutledge, thuriféraire de la pensée politique de James Harrington[61], cette distinction suppose, en république, qu’au pouvoir de « débattre, discuter, discerner » des représentants s’ajoute celui « d’adopter ou rejeter, ou de résoudre et décréter » du peuple[62]. Comme l’exprime Lavicomterie en 1791, le gouvernement représentatif peut se concilier avec la liberté du peuple si celui-ci donne aux représentants « le modèle précis des loix » ou s’il exerce le pouvoir de « formellement les ratifier »[63].
Cette proposition gagne en popularité au lendemain de l’arrestation de Louis XVI à Varennes renforçant la conviction du parti républicain. À l’instar de Desmoulins soutenant que « jusqu’à la ratification tous les actes d’un mandataire n’existent que comme simple projet, ou du moins n’ont qu’une autorité provisoire »[64], Marat ne cesse de marteler que « les loix faites par nos représentans ne peuvent être censées notre ouvrage qu’autant que nous les aurons librement et solemnellement consenties »[65]. Ils perpétuent alors une conception proprement républicaine de la loi ne pouvant revêtir ce saint nom et disposer d’un caractère contraignant qu’une fois sanctionnée par le peuple.
Page 7
[58] François Robert, Le républicanisme adapté à la France, 1790, p. 93.
[59] Ibid. Belgicisme signifiant, dans un sens juridique, « possédé sous certaines…
[60] François Robert, Le républicanisme adapté à la France, 1790, p. 95-96.
[61] François Quastana, « Équilibre de la propriété et constitution démocratique…
[62] James Rutledge, Le Creuset, n° II, 6 janvier 1791, p. 27-28.
[63] Louis Lavicomterie, Les droits du Peuple sur l’Assemblée nationale, 1791, p. 37.
[64] Camille Desmoulins, Révolutions de France et de Brabant, n°81, juin 1791, p.110.
[65] Jean-Paul Marat, L’Ami du Peuple, n° 499 du 24 juin 1791, p. 5 ; n° 544, 3 septembre…
On trouve l’expression la plus révélatrice de ce mécanisme de « sanction populaire » dans La Bouche de Fer sous la plume de Duchosal[66] précisé ensuite sous celle de Bonneville et Fauchet. Rappelant que, puisque « le vœu des représentans peut souvent ne pas être le vœu de tous les François », il faut dès lors que le peuple procède à une « ratification inaliénable et annuelle de tous les nouveaux décrets » par « le droit de voter et de déclarer par oui ou par non seulement, tous les ans, dans les trois grands jours des assemblées souveraines, d’où émaneront tous les pouvoirs »[67]. Lors des fêtes des 12, 13 et 14 juillet seraient recueillies les volontés particulières de la totalité des citoyens. Par division de chaque commune en groupes de cent citoyens, chacune de ces assemblées se réunirait en cercle, symbole d’égalité, avec, en son cœur, une pierre servant comme à Sparte de tribune pour la lecture des lois provisoires devenant définitives une fois approuvées par la majorité[68].
Ces auteurs se placent assurément dans la continuité de François Robert qui prônait en novembre 1790 une même division de l’exercice du pouvoir législatif entre les représentants qui « doivent discuter et rédiger des loix » n’étant « que des lois provisoires, qui s’exécuteront d’abord, et qui seront même obligatoires, jusqu’à ce que le vœu général ait été prononcé »[69]. Du recensement national du vote des citoyens réunis dans chaque municipalité émergerait en conséquence, la volonté générale[70], une méthode qui se rapproche de celle proposée par Billaud-Varenne[71]. Louise Robert résume parfaitement la pensée de son époux en rappelant que, selon la conception républicaine de la liberté, chaque citoyen ne peut « remplir le devoir d’être soumis à la loi, qu’autant qu’il a usé du droit de la faire ou de la consentir » car bien qu’« ayant choisi la forme du gouvernement représentatif, comme la mieux adaptée à l’étendue de la république », le peuple n’a cependant pu céder « le droit inaliénable d’examiner ces mêmes loix, plutôt proposées que faites par de simples représentans »[72].
Les républicains n’ont ainsi de cesse de vanter les mérites d’un système représentatif prévoyant un encadrement strict des députés du peuple contre le triomphe de la conception libérale de la représentation dans la Constitution de 1791 dont ils espèrent la révision. C’est enfin au moment de la naissance tant attendue de la république que Robespierre en appelle à la plus grande vigilance à travers un avertissement qui résonne aux oreilles des républicains comme un commandement immuable :
Quelques soient vos délégués, gardez-vous de les laisser maîtres absolus de votre destinée : surveillez-les ; jugez-les ; et réservez-vous dans les tems des moyens réguliers et pacifiques d’arrêter les usurpations des hommes publics sur les droits et sur la souveraineté du peuple.[73]
Page 8
Mots-clés : Révolution française, républicanisme, démocratie, représentation, liberté.
[1] Maximilien Robespierre, Le Défenseur de la Constitution, n° 11, juillet 1792, p. 538.
[2] Voir Raymonde Monnier, Républicanisme, patriotisme et révolution française, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques historiques », 2005.
[3] Quentin Skinner, Les fondements de la pensée politique moderne, Paris, Albin Michel, coll. « L’Évolution de l’humanité », 2001.
[4] François Quastana et Pierre Serna, « Le républicanisme anglais dans la France des Lumières et de la Révolution : mesure d’une présence », La Révolution française, 5 | 2013.
[5] Philip Pettit, Républicanisme : une théorie de la liberté et du gouvernement, Paris, Gallimard, coll. « NRF essais », 2003 ; Maurizio Viroli, Républicanisme, Lormont, Le Bord de l’eau, coll. « Les Voies du politique », 2011.
[6] Quentin Skinner, La liberté avant le libéralisme, Paris, Seuil, coll. « Liber », 2016.
[7] Manuela Albertone, « L’apprentissage de la démocratie représentative à Paris. Brissot, Condorcet, et la Constitution municipale (1789-1790) », in Les Défis de la représentation. Langages, pratiques et figuration du gouvernement, Manuela Albertone, Dario Castiglione (dir.), Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2018, p. 197-221.
[8] A.P., t. XXIX, Discussion du titre III du projet de Constitution, lors de la séance du 10 août 1791, p. 323 sqq. Voir le commentaire de Michel Troper dans « Le représentant et l’organe », in La Représentation politique. Anthologie, Manuela Albertone, Michel Troper (dir.), Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque de science politique », 2021, p. 199-216.
[9] Jacques-Pierre Brissot, Le Patriote français, n° 730, 9 août 1791, p. 164. Il commente son précédent discours au club des Jacobins : « M. Roederer a fort bien prouvé que le roi ne pouvoit pas être qualifié de représentant du peuple ; parce que toute représentation suppose une élection par le peuple, et qu’ici il n’y en a point ».
[10] A.P., t. VIII, Rapport de M. Mounier sur la nécessité de la sanction royale, lors de la séance du 4 septembre 1789, p. 560.
[11] Stanislas de Clermont-Tonnerre, Œuvres complètes, t. 2, Paris, Chez Letellier, 1795, p. 14-15.
[12] A.P., t. VIII, Suite de la discussion sur la permanence et l’organisation du pouvoir législatif et sur la sanction royale, lors de la séance du 5 septembre 1789, p. 581.
[13] Ibid., p. 582.
[14] Louis-Marie Prudhomme, Révolutions de Paris dédiées à la nation, n° XXI, 28 novembre-5 décembre 1789, p. 7-10.
[15] A.P., t. VIII, Reprise de la discussion sur l’organisation du pouvoir législatif et la sanction royale, lors de la séance du 7 septembre 1789, p. 594.
[16] Jacques de Saint-Victor, Thomas Branthôme, Histoire de la République en France des origines à la Vème République, Paris, Economica, coll. « Corpus Histoire du droit », 2018, p. 227-232.
[17] Jacques-Pierre Brissot, Plan de conduite pour les députés du peuple aux états généraux de 1789, p. 29-32.
[18] Louis-Marie Prudhomme, Révolutions de Paris dédiées à la nation, n° 47, 29 mai-5 juin 1790, p. 461.
[19] Nicolas de Bonneville, Claude Fauchet, La Bouche de Fer, n° 88, 10 juillet 1791, p. 4-5.
[20] Jacques-Pierre Brissot, Plan de conduite pour les députés du peuple aux états généraux de 1789, p. 30-31.
[21] Jacques-Pierre Brissot, Le Patriote français, n° 696, 5 juillet 1791, p. 19 : « J’entends, par république, un gouvernement où tous les pouvoirs sont 1° délégués ou représentatifs ; 2° électifs dans et par le peuple, ou ses représentans ; 3° temporaires ou amovibles ».
[22] Émilie Bremond-Poulle, « Souveraineté populaire et pouvoir représentatif chez Marat. L’exercice de deux pouvoirs contradictoires ? » in Républicanismes et droit naturel : des humanistes aux révolutions des droits de l’homme et du citoyen, Marc Belissa (dir.), Paris, Kimé, coll. « Le Sens de l’histoire », 2009, p. 161-172. Voir par exemple L’Ami du Peuple, n° 16, 26 septembre 1789, p. 5-6.
[23] Camille Desmoulins, Révolutions de France et de Brabant, n° 71, avril 1791, p. 257.
[24] Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social (1762), Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2012, livre II, chap. I, p. 190 : « En effet, s’il n’est pas impossible qu’une volonté particulière s’accorde sur quelque point avec la volonté générale ; il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant ».
[25] Louis Lavicomterie, Du Peuple et des rois, 1790, p. 110.
[26] Ibid., p. 111.
[27] Raymonde Monnier, « Démocratie représentative ou république démocratique : de la querelle des mots (République) à la querelle des anciens et des modernes », Annales historiques de la Révolution française, n° 325, 2001/3, p. 2-4. Il l’utilise en 1787 dans ses Lettres d’un bourgeois de New-Haven pour défendre la nécessité de lois justes et consenties tacitement ou formellement par le peuple.
[28] François Robert, Le républicanisme adapté à la France, 1790, p. 89
[29] Nicolas de Condorcet, De la nature des pouvoirs politiques dans une nation libre, 1792, p. 1 : « Les hommes ont tellement pris l’habitude d’obéir à d’autres hommes que la liberté est, pour la plupart d’entre eux, le droit de n’être soumis qu’à des maîtres choisis par eux-mêmes ».
[30] Louis-Marie Prudhomme, Révolutions de Paris dédiées à la nation, n° XI, 19 septembre 1789, p. 33.
[31] Ibid., n° XXI, 28 novembre-5 décembre 1789, p. 10.
[32] Jean-Jacques Rousseau, Du Contrat social, op. cit., livre III, chap. XV, p. 251-252.
[33] Julien Boudon, Les Jacobins, une traduction des principes de Jean-Jacques Rousseau, Paris, L.G.D.J, coll. « Thèses », t. 128, 2006, p. 217-227. Voir aussi Philippe Crignon, « La critique de la représentation politique chez Rousseau », Les Études philosophiques, 2007/4, n° 83, p. 496.
[34] Nicolas de Condorcet, Journal de la société de 1789, n° X, 7 août 1790, p. 1-3.
[35] Jacques-Pierre Brissot, La Chronique du mois ou les Cahiers patriotiques, Octobre 1792, p. 20.
[36] Louis Lavicomterie, Les droits du Peuple sur l’Assemblée nationale, 1791, p. 123-126.
[37] Jacques-Pierre Brissot, Le Patriote français, n° 670, 9 juin 1791, p. 639.
[38] Ibid.
[39] Ibid.
[40] Nicolas de Condorcet, Instruction sur l’exercice du droit de souveraineté, 1790, p. 3.
[41] Jacques-Pierre Brissot, Le Patriote français, n° 683, 22 juin 1791, p. 696.
[42] Ibid.
[43] A.N. (Pierrefitte-sur-Seine), Fonds Brissot, 446AP/18, Politique, 495, 147-148.
[44] A.P., t. XXX, Reprise et suite de la discussion concernant la prochaine assemblée de révision, lors de la séance du 31 août 1791, p. 115. Citée dans L’Ami du Peuple, n° 545, 4 septembre 1791, p. 6.
[45] Jean-Paul Marat, L’Ami du Peuple, n° 610, 26 novembre 1791, p. 4. Voir aussi le n° 431, 16 août 1791, p. 5.
[46] Ibid., n°16, 26 septembre 1789, p. 5-6.
[47] Ibid., n° 678, 13 août 1792, p. 1-2.
[48] Maximilien Robespierre, Le Défenseur de la Constitution, n° 11, 1792, p. 539-540.
[49] Ibid., p. 540.
[50] Nicolas de Condorcet, Instruction sur l’exercice du droit de souveraineté, 1790, p. 6.
[51] Pierre Serna, « Comment se représenter soi-même ? Pour une histoire politique des constitutions de 1791, 1793, 1795 » in Les Défis de la représentation. Langages, pratiques et figuration du gouvernement, op. cit., p. 253.
[52] Louis Lavicomterie, République sans impôt, 1792, p. 311-312.
[53] Ibid.
[54] François Quastana, « Républicanisme et constitutionnalisme: Le Dictionnaire de la constitution et du gouvernement français de P. N. GAUTIER » in Des racines du Droit et des contentieux. Mélanges en l’honneur du professeur Jean-Louis Mestre, Aix-en-Provence, éd. l’Épitoge, coll. « Académique », 2020, p. 223.
[55] Nicolas de Bonneville, Claude Fauchet, La Bouche de Fer, n° 89, 11 juillet 1791, p. 6-7.
[56] Condorcet, Paine, Du Chatelêt, Le Républicain, ou le défenseur du gouvernement représentatif, n° 1, juillet 1791, p. 7-9.
[57] Nicolas de Bonneville, Claude Fauchet, La Bouche de Fer, n° 89, 11 juillet 1791, p. 7.
[58] François Robert, Le républicanisme adapté à la France, 1790, p. 93.
[59] Ibid. Belgicisme signifiant, dans un sens juridique, « possédé sous certaines obligations », ou « enchaîné » au sens moral.
[60] François Robert, Le républicanisme adapté à la France, 1790, p. 95-96.
[61] François Quastana, « Équilibre de la propriété et constitution démocratique – Enquête sur une filiation insoupçonnée : L’héritage républicain de James Harrington au XVIIIe siècle », in Pensée politique et propriété, Michel Ganzin (dir.), Aix-en-Provence, PUAM, coll. « Histoire des Idées Politiques », 2019, p. 75-96 ; Myriam-Isabelle Ducrocq, La République de Harrington dans la France des Lumières et de la Révolution, Liverpool, Liverpool University Press, coll. « Oxford University Studies in the Enlightenment, 2022, p. 171-173.
[62] James Rutledge, Le Creuset, n° II, 6 janvier 1791, p. 27-28.
[63] Louis Lavicomterie, Les droits du Peuple sur l’Assemblée nationale, 1791, p. 37.
[64] Camille Desmoulins, Révolutions de France et de Brabant, n°81, juin 1791, p.110.
[65] Jean-Paul Marat, L’Ami du Peuple, n° 499 du 24 juin 1791, p. 5 ; n° 544, 3 septembre 1791, p. 8 ; n° 176, 28 juillet 1791, p. 2.
[66] Nicolas de Bonneville, Claude Fauchet, La Bouche de Fer, n° 70, 21 juin 1791, p. 6. Duchosal commence son discours dans le n°69 du 19 juin.
[67] Ibid., n° 71, 23 juin 1791, p. 5.
[68] Ibid., n° 76, 28 juin 1791, p. 1-4.
[69] François Robert, Le républicanisme adapté à la France, 1790, p. 96.
[70] Ibid., p. 97.
[71] Jacques-Nicolas Billaud-Varenne, L’Acéphocratie, ou le gouvernement fédératif, 1791, p. 63-64. Il attribue la sanction à des corps secondaires représentants les quatre-vingt-trois départements.
[72] Louise Robert, Mercure National et étranger ou Journal politique de l’Europe, n° VIII, 23 avril 1791, p. 114-115.
[73] Maximilien Robespierre, Le Défenseur de la Constitution, n° 12, août 1792, p. 582.
D'autres articles

La Loi Toubon et la Loi 101 de la philosophie au droit : la France et le Québec entre républicanisme et libéralisme
Comme les travaux menés par Joseph-G. Turi à la fin des années 1980 l’ont démontré, les législations linguistiques québécoise et française visaient toutes deux la consécration d’une seule langue officielle, mais avaient fait l’objet d’interprétations plutôt favorables à une langue autre[2]. Depuis…

Pasquale Paoli et sa documentation sur les régimes mixtes de l’Antiquité
Qu’est-ce que les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle ont cherché dans la documentation antique à propos des régimes mixtes et, surtout, qu’y ont-ils trouvé ? C’est une question que l’on abordera en la circonscrivant à des limites raisonnables, c’est-à-dire à un personnage, Pasquale Paoli, et à sa…

Échanges avec Vincent Peillon
Jean-Guy TALAMONI
Merci, Vincent Peillon, pour cette conférence qui ouvre des pistes et présente des idées nouvelles, à plusieurs titres. Il serait intéressant qu’il y ait un échange avec les collègues qui sont présents à ce colloque. D’autant que…