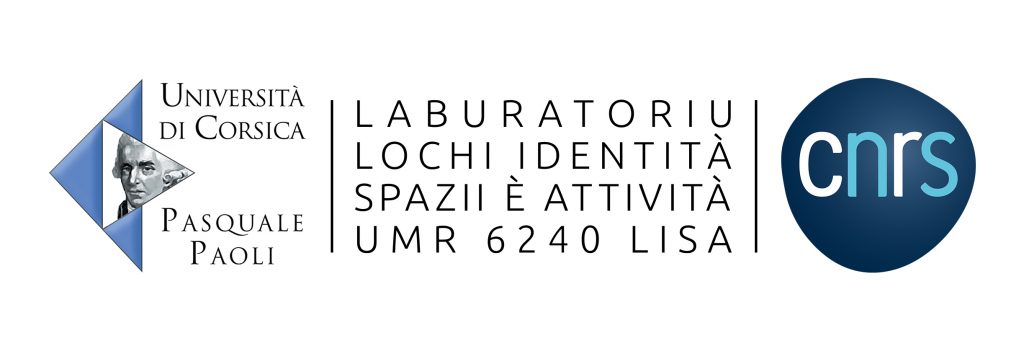Le commun pour base d’un éco-républicanisme
Thierry Dominici
La tâche la plus ardue de cette communication est, peut-être, de faire passer l’idée qu’au-delà de certains antagonismes, tenter de rapprocher le républicanisme au sens premier du terme, c’est-à-dire, en tant que principe de base de « toute activité publique » d’une société humaine organisée et institutionnalisée et l’écologie, du moins celle au sens courant que notre culture de masse produit depuis le début des années 1980, peut paraître tout à fait naturel aujourd’hui.
Certes, pour les occidentaux que nous sommes, cette idée de conjuguer ou de combiner républicanisme et écologie paraît paradoxale. Pour plusieurs d’entre nous, par essence, républicanisme et écologie sont antinomiques. Ce constat, erroné, mais souvent partagé, repose sur une réalité dialectique biaisée car les deux vocables n’évoluent pas sur la même échelle de sens philosophique, juridique et de fait encore moins sociétale.
De plus, ce phénomène résonne dans l’imaginaire collectif des sociétés libérales au point que, pour une grande majorité, les valeurs républicaines incarnent l’esprit des Lumières et ses fondamentaux et universaux (liberté, égalité, intérêt général). De sorte que le républicanisme se pense comme étant intrinsèquement lié à l’État centralisé, au progrès humain et à la civilisation des mœurs, alors que l’écologie est perçue comme empreinte de primitivisme, des hétéronomies traditionnelles des sociétés agrestes, voire pour les plus acerbes de mysticisme et de totalitarisme(s) vert(s). De fait, dans notre psyché, ces deux termes s’opposent plus qu’ils se confondent à l’image de deux aimants qui se repousseraient l’un et l’autre à l’infini.
Mais si, finalement, ces deux échelles de sens ne s’opposaient pas autant que l’on imagine, beaucoup moins en tout cas que d’autres alliages comme par exemple ceux qui fusionnent le vert et le brun à l’instar de l’éco-fascisme (re)naissant[1] ?
Aujourd’hui, en sciences sociales, l’écologie politique se présente comme le cinquième grand discours sur la modernité, après l’anarchisme, le communisme, le socialisme et le libéralisme. Pourtant, sur le plan du projet politique, l’écologie a été systématiquement ignorée par le jeu démocratique et républicain de nos sociétés pluralistes. Certes, ce phénomène est systémique, en effet, peu de discours sur la modernité ont résisté à l’hégémonie néolibérale. Mais le plus étrange est de voir que l’écologie est encore considérée comme l’étude scientifique du milieu et des interactions entre les éléments qui le composent au lieu d’une utopie réelle au sens d’Erik Olin Wright[2]. Voire une révolution paradigmatique ou une idéologie politique, bref La perspective du possible[3] en dehors du système actuel. Au point même que tout un chacun est convaincu que l’écologie seule (sans la fusion avec une autre idéologie plus clivante de droite comme de gauche) ne peut pas produire d’idées politiques et donc ne peut être une valeur à forte teneur républicaine au sens que nous, enfants des Lumières, l’entendons. Ce jugement erroné sur la politisation écologique est chez beaucoup d’entre nous renforcé par l’idée reçue que cette science n’étudie pas réellement ou pleinement l’action humaine du moins comme le font les sciences sociales classiques, et donc, sur le plan politique, l’écologie est souvent vue comme perturbatrice du système et non comme un projet de société viable permettant de concurrencer le productivisme. Force est d’admettre que la démocratie libérale telle qu’elle fonctionne aujourd’hui est peut-être le principal obstacle à la transition écologique et sociale que notre société doit produire.
Plus prosaïquement, l’écologie politique a été jugée par une grande majorité des démocraties libérales (et illibérales) comme une simple utopie irréalisable car trop anti-productiviste et donc contraire à la philosophie du libre marché qui orchestre nos vies quotidiennes, écho ou plutôt pâle reflet de l’Esprit des Lumières.
Aujourd’hui, la question se pose simplement parce qu’au regard de l’urgence écologique que nos sociétés traversent, notre monde change, comme si nous étions rattrapés par les maux générés par nos révolutions techno-industrielles.
Il suffit d’observer simplement à l’œil nu, devant nous, la pollution des océans et de l’eau potable, la plastification des terres et des organismes, les accidents nucléaires, le changement climatique et les vortex polaires, les gaz à effet de serre et les trous dans la couche d’ozone, les déforestations, les feux de forêts, la désertification, l’érosion et la destruction des sols, l’extinction massive de la biodiversité et enfin l’apparition de nouvelles pandémies. Tous ces phénomènes sont intrinsèquement liés à la dégradation de l’environnement et, de fait, contraignent les démocraties libérales et illibérales actuelles à penser (ou à nier) la crise écologique qui traverse notre modèle social : le capitalocène ou plus communément l’anthropocène.
Ainsi, l’urgence écologique ouvre sur des nouveaux défis socio-politiques et nos sociétés sont dans l’obligation, pour ne pas s’effondrer, de proposer un changement de paradigme, mêlant et entremêlant éthique et dialectique. Selon nous, ce changement paradigmatique devrait permettre, par le truchement d’un empowerment collectif et d’une certaine dose de résilience citoyenne individuelle, d’élaborer des valeurs éco-républicaines. Ce n’est qu’une fois institutionnalisé que cet éco-républicanisme creusera les fondations d’une cité écologique. Certes, comme l’explique le philosophe Serge Audier, « un tel mouvement d’initiative de la société civile est important et salutaire en ce qu’il comprend que c’est à elle de se mobiliser ; mais le problème nous paraît être celui d’une nouvelle articulation à construire entre mouvement de la société civile, politique institutionnelle et projet politique collectif. » [4]
L’objectif de cette communication est de montrer que l’écologie politique est devenue un enjeu démocratique de premier ordre. Celui-ci contraint de plus en plus nos sociétés à s’adapter sociologiquement, idéologiquement et systémiquement en proposant un éco-républicanisme liant étroitement écologie et liberté, et donc commun et citoyens. Après avoir défini rapidement ce que nous entendons par « commun » (I), l’idée de ce premier travail est de brosser les différentes propositions inhérentes à l’écologie politique du XXIème siècle afin de dégager un panorama des différents scenarii d’une écologie politique du commun (II, III), et enfin de présenter trois exemples d’éco-républicanismes émergents (IV).
1. L’écologie politique du commun
Dans son troisième volet de son analyse du champ politique de l’écologie, Audier explique que :Pierre Dardot et Christian Laval[6], fortement inspirés par les réflexions d’Illich et de Gorz, avancent des powerprocess permettant une reconquête citoyenne basée sur la convivialité notamment dans le travail[7]. Les deux sociologues présentent à travers le prisme d’une série de propositions avancées de « construire une politique du commun[8] ». Celles-ci[9] portent « sur le droit d’usage » opposable à « la propriété », sur « l’émancipation du travail », sur « l’entreprise commune », sur « l’association dans l’économie », et enfin sur la « démocratie sociale », où les services publics sont « institutions du commun ». Si les « communs » jouent un rôle nodal dans la pensée écologique (et paradoxalement dans la théorie économique néolibérale), c’est grâce l’article très flou paru en 1968 intitulé La tragédie des communs, de l’écologue Garrett Hardin. Dans ce papier, il pose l’idée d’une alternative entre la contrainte étatique et la propriété privée. Cependant, c’est plus le travail d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie en 2009, et de son mari Vincent, qui a très largement fait observer que partout dans le monde, les multiples expériences de biens communs prouvaient la pertinence et la durabilité de ce mode de gouvernance. Les Ostrom ont notamment souligné les hypothèses réductrices inhérentes au discours libéral de critique des communs : le raisonnement est entièrement construit sur la base d’homo oeconomicus égoïstes, isolés, décontextualisés, sans histoire commune (ni futur), sans interaction et sans coopération entre eux, aux désirs illimités, en compétition permanente, focalisés sur le temps court. Leur analyse est construite largement par la pensée républicaine du self-government de Tocqueville. Pour Serge audier, avec les propositions du couple Ostrom, « il existe une alternative théorique et pratique aussi bien à la privatisation qu’à la centralisation : elle réside dans la gouvernance des communs. Il s’agit de développer une pensée adéquate de l’action collective – économique et sociologique, mais en vérité surtout politique –.[10]». Pour conclure ce premier point, il semble que la conceptualisation du commun en ces temps de crises sociales et d’urgence écologique, est « un enjeu important dans le cadre de la construction d’un éco-républicanisme – à condition toutefois, c’est du moins la thèse qu’on défendra, de ne pas en faire une “solution” magique, tant sont redoutables les problèmes théoriques et pratiques qui lui sont liés [11] ». Aussi, comme le soulignent Dardot et Laval il faut « examiner le commun comme principe effectif de transformation de nos institutions[12] » ou soit simplement comme « exigence démocratique[13] ». Sans rentrée dans une analyse gramscienne, on peut ajouter avec Audier que « pour certains mouvements et intellectuels anticapitalistes et écologistes – à dire vrai, minoritaires mais dont la voix porte –, […], jugé bien fade et réformiste, mais dans un changement radical de paradigme, celui du « commun » et des « communs », voué à sortir définitivement de la propriété, qu’elle soit privée ou même publique, pour s’acheminer vers de nouvelles formes d’autogestion ou de communisme. Sans jugement de valeur, on peut parler d’une véritable « mode » intellectuelle et idéologique, au point que de nombreux acteurs politiques intègrent à leurs slogans les termes « en commun » »[14]. En d’autres termes, la lutte écologique pour préserver et restaurer la nature apparaît comme lutte sociale pour l’émancipation. Dardot et Laval observent que ces luttes élèvent toutes une même exigence, reposent toutes sur un même principe : le commun. En ce sens le commun appelle à une nouvelle institution de la société par elle-même : une révolution ?[15] ».« Les “communs”, à rigoureusement parler, désignent un type très spécifique de gestion et de régime de “propriété”. Selon la synthèse particulièrement représentative de son principal théoricien et défenseur parmi les économistes français, Benjamin Coriat, ils requièrent trois caractéristiques : d’abord, une ressource mise en commun, partagée et cogérée ; ensuite, un mode d’accès à cette ressource et des règles de partage, supposant une structure de droits et d’obligations, et un régime atypique de droits de propriété partagés, différenciés et enchevêtrés – ce que l’école institutionnaliste états-unienne a appelé un « faisceau de droits », « bundle of rights » ; enfin, un mode de gouvernance par définition pluriel de ces ressources, grâce à des conventions et/ou sur la base de traditions. En ce sens, par-delà des flottements conceptuels et autres controverses terminologiques, il faut bien distinguer les “biens communs” des “communs” : si les premiers – notamment, en matière écologique, l’air, les océans, les forêts, etc. – peuvent plus ou moins être gérés par des communs, ils ne le sont pas nécessairement. Si l’on s’en tient à cette définition assez stricte, on peut comprendre l’immense engouement actuel – en particulier dans des milieux écologistes et de gauche alternative – que suscite la thématique des “communs”, mais aussi garder une certaine prudence quant à leur généralisation. En tout cas, cette redécouverte ou plutôt réinvention des “communs” a joué un rôle intellectuel et politique d’autant plus important, y compris dans l’horizon écologique, qu’elle a servi de contre-feu et de modèle alternatif à un double modèle dont l’histoire a démontré les échecs répétés, notamment pour protéger la “nature”[5].
Page 2
2. L’écologie institutionnelle / les balbutiements de la révolution éco-républicanisme
L’écologie apparaît dans le jeu démocratique des systèmes occidentaux au milieu des années 1970. Cependant, il semble que ce phénomène résultait simplement des répercussions directes sur les champs politique et intellectuel des effets de médiatisation et de popularisation de la publication en 1972 du rapport Meadows. Vendu à 12 millions d’exemplaires, traduit en 37 langues, ce rapport était basé sur un modèle de simulations mathématiques. C’était la première fois, que des chercheurs du MIT (Massachussets Institute of Tehcnol) se basaient sur des calculs mathématiques pour étudier les effets directs de la croissance économique sur les ressources planétaires. La conclusion fut sans appel, les chercheurs prévoyaient un épuisement rapide des ressources énergétiques et des dommages graves causés à l’environnement. Le rapport désigne quatre facteurs directement moteurs de cet épuisement des ressources :- L’accélération de l’industrialisation
- La démographie croissante de la population mondiale
- La persistance de la malnutrition mondiale
- L’épuisement des ressources naturelles non renouvelables
3. L’écologie radicale : l’éco-républicanisme du commun
Celles-ci s’inscrivent dans l’espace politique non par une opposition au système (comme l’écologie institutionnelle), mais en se mobilisant autour d’une écologie radicale. L’adjectif radical renvoie à l’idée d’une modification des causes profondes, ici en dénonçant l’hégémonie néolibérale et en combattant le productivisme et la mondialisation économique.
De fait, c’est un vocable ou plutôt une formulation très vague car elle désigne tous les mouvements politiques qui prétendent agir et interagir contre la société marchande. Par contre, sur fond d’urgence écologique et climatique, la plupart de ces tendances, souvent post-matérialistes et altermondialistes, font aujourd’hui partie intégrante du paysage politique et de par leurs actions (directes et/ou de désobéissances civiles, manifestations, blocages, ZAD, etc.) font chaque jour la une des mass média. Par exemple, en France, à la faveur de la primaire écologiste, la percée spectaculaire de Sandrine Rousseau face à Yannick Jadot a marqué l’irruption sur le devant de la scène politique des branches les plus actives de l’écologie radicale[20].
Néanmoins, il est quasiment impossible de faire une liste exhaustive de ces tendances à la marge du système capitaliste. Par contre, cette écologie est radicale car elle propose un changement radical de paradigme institutionnel et économique. Elle se fonde sur l’édification d’une société du commun (municipalisme, bio-région, société primitive, collectivité, etc.) dont les fondations éco-républicaines sont une forme de solidarisme[21]. Lutter contre toute les formes de dominations (hiérarchisation, de classe, de genre, etc.) est combattu par l’ensemble des courants qui peuplent le monde de l’écologie radicale. À l’image d’Ivan Illich, penseur majeur de l’écologie radicale, qui écrivait à l’été 1973 dans le Nouvel Observateur qu’« au fur et à mesure qu’elles se couvrent d’institutions plus rares et plus vastes, les hiérarchies s’élèvent et s’agglutinent. Une place de cadre dans une industrie de pointe, voilà le produit le plus convoité et le plus disputé de la croissance. Les autres, ceux qui courent en vain derrière, sont le plus grand nombre et répartis dans une variété inférieure : les sous-éduqués, les femmes, les homosexuels, les jeunes, les vieux, les Noirs… Chaque jour est inventé un nouveau type d’infériorité. Les mouvements minoritaires réussissent au mieux à grappiller des diplômes et des carrières pour quelques-uns de leurs membres sortis du rang. Ils chantent victoire lorsqu’ils obtiennent la reconnaissance du principe : travail, égal, salaire égal. D’où le paradoxe : d’une part ces mouvements renforcent la croyance que les besoins d’une société égalitaire ne peuvent être satisfaits sans passer par un travail spécialisé et une hiérarchie bureaucratisée ; mais de l’autre ils accumulent de fabuleux quanta de frustration, que la moindre étincelle va faire exploser. »[22]. En revanche, bien qu’à la marge du champ politique néolibéral, on peut néanmoins retrouver les sources et ainsi identifier les courants de pensée où se forment l’écologie radicale :
- des tendances néo-luddites, critiques à l’égard du scientisme, de la Ici le lien qui rapproche ces groupes à l’écologie radicale est la mobilisation contre la société industrielle et aujourd’hui post-industrielle et marchande.
- des pensées régionalistes, fédéralistes et/ou anarchistes. Ce courant de pensée va permettre d’ouvrir plusieurs voies basées sur une idée de démocratie plus participative et moins représentative. Idée d’organisation horizontale du pouvoir, etc.
- des mouvances libertaires issues de 1968 en France et des organisations nées des révolutions estudiantines (en Europe et en Amérique du Nord). Toutes ces tendances œuvrent contre toutes les formes de domination (bureaucratique, patriarcale, économique, sociale, etc.) et militent contre toutes les formes d’injustices sociales que produisent nos sociétés libérales et l’ordre social inhérent au système (néo)libéral. Ces groupes soutiennent le droit à la reconnaissance des minorités (culturelle, sexuelle et bien sûr politique). Historiquement, ces idées se popularisent aux USA et au Canada. En Europe, il apparaitra dans les années 1960 aux Pays-Bas avec le parti PROVO.
- des courants de pensée traditionalistes et/ou agrariens, moins étudiés, car considérés comme dépassés par les environnementalistes essentiellement urbains. Le courant agrarien est très présent aux USA et au Canada avec les écrits de Berry notamment. Les agrariens sont très présents dans les anciens pays des PECO, dont notamment la Roumanie. De plus, le traditionalisme vert existe dans le champ politique depuis la seconde guerre mondiale, on le retrouve dans les éco-fascismes d’hier[23] (Italien et nazi), mais ses racines sont plus profondes car elles puisent leurs sources dans la tradition agreste et agraire.
- des mouvances naturistes, spiritualistes et ascétiques. Inspirées par les travaux de Naess (et ses héritiers) ces courants revendiquent une écologie profonde. Pour certains comme Bookchin, c’est une forme « d’écologie mystique » plus que politique, mais pour beaucoup de militants écologistes, notamment Nord-américains, elle est par ces huit principes (préceptes) de base, l’outil permettant sur le plan personnel une résilience écocitoyenne. Il est aussi fortement porté à droite avec l’héritage de la théosophie et de la biodynamie des Steiner et autres.
- Enfin, dans une catégorie spécifique, on peut rassembler les différentes pensées qui défendent des causes particulièrement liées à la nature, comme par exemple la défense des animaux comme mouvement de pensée de l’écologie radicale. Pour certains spécialistes, ce n’est pas à proprement parler un courant écologique car il y aurait une absence de problématique écologiste globale, mais à l’image des néo-luddistes, cette tendance donne aux mouvements écologistes (institutionnels et radicaux) des éléments de langage nouveaux, notamment concernant le rapport de domination homme-nature.
Ce petit panorama des différents courants de pensée qui constituent les tendances de l’écologie radicale (et une partie de l’écologie institutionnelle) actuelle nous permet de comparer et de regrouper les différents thèmes (combinés, voire fusionnés) qui échafaudent les deux mobilisations (institutionnelle comme radicale).
Page 4
Bien évidemment, tous les écologistes œuvrent pour la défense de l’environnement passant par un souci de protection/conservation de la Nature. Mais nous pouvons noter également, que d’une part, sur le plan institutionnel, apparaît clairement une critique de l’État et de la bureaucratie technicienne. On observe aisément au sein des organisations écologistes (institutionnelles et radicales) un rejet de l’État en tant que système institutionnel et/ou comme machine de reproduction d’une bureaucratisation administrative et d’une hiérarchisation sociale. Plusieurs tendances rejettent le système représentatif et le parlementarisme actuels, plusieurs sont acerbes à l’endroit des partis traditionnels allant jusqu’au refus du clivage droite/gauche, etc. De fait, on note chez tous les écologistes, sur le plan structurel, une nette préférence pour la démocratie directe ou du moins pour la démocratie participative (démocratie délibérative pour les uns, réelles ou radicales pour les autres).
Deuxièmement, sur le plan de la décentralisation du pouvoir, toutes les tendances proposent la défense de l’échelon local ou régional face au centralisme jacobin et parfois la volonté de substituer à l’État-nation un cadre plus fédéral.
Troisièmement, sur le plan économique, le rejet de la société industrielle, de l’organisation capitaliste du travail et plus généralement une critique de la primauté de la logique économique dans les sociétés modernes sont transversaux à toutes les mouvances écologistes. L’antiproductivisme et la décroissance sont les moteurs des concepts d’autogestion et d’autonomie. L’autonomie au plan économique, social et politique est nodale pour les l’écologistes. S’y imbrique une critique de la consommation pouvant aller jusqu’à l’éloge de la frugalité et d’un certain ascétisme.
Enfin, quatrièmement, les deux familles politiques (institutionnelle et radicale) partagent plus ou moins la même critique du progrès, c’est-dire, celle à partir de l’idée selon laquelle l’expansion de la science et de la technique ne signifie pas automatiquement progrès de la Raison et progrès de l’homme.
Pour conclure ce paragraphe, pour les écologistes actuels, la critique de l’État, sans entrer dans une analyse Gramscienne, est la conséquence directe de la subordination de celui-ci au système néolibéral. Pour les écologistes, l’État « […] dont la principale fonction aujourd’hui est de plier la société aux contraintes du marché mondial[24] » doit-être repensé. Sortir de ce type d’organisation politique institutionnalisée, tendre vers La perspective du possible ou l’utopie réelle, nous semble être la voie commune à toutes les écologies politiques. Dont notamment pour ces trois principaux piliers de l’écologie radicale dont les propositions aujourd’hui sont utilisées, instrumentalisées, récupérées à la fois par l’écologie institutionnelle et par les mouvements à la marge du système.
4. Trois propositions ou scénarii éco-républicains observables hors champ institutionnel étatique classique
Aujourd’hui, sur le plan des projets de sociétés, des différentes voies que propose l’écologie radicale on peut observer aisément trois visions ou scénarii qui s’articulent autour d’un éco-républicaine hors institutions étatiques néolibérales. Pour ces trois perspectives du possible, l’institutionnalisation de la société écologiste est basée sur le solidarisme et sur l’autogestion du commun. La première est d’ordre individuelle, elle s’articule autour d’une volonté de résilience écocitoyenne, ce scénario est intrinsèquement lié à l’écosophie ou l’écologie profonde dont Arne Naess est la figure de proue. Les deux autres propositions sont plus holistes, ou du moins collectives, elles se forment sur l’idée d’un empowerment, et plus précisément sur la dimension d’une gestion du territoire et de l’espace du vécu en bio-région, développées depuis les années 1960 par les bio-régionalistes et pour la seconde perspective celle d’un municipalisme (ou communalisme) libertaire[25] imaginé notamment par l’écologie sociale de Murray Bookchin.
Exemple 1– L’écologie profonde comme base de la résilience éco-républicaine
Mouvement spirituel, culturel et philosophique, l’écologie profonde est une source d’inspiration pour les militants et dirigeants écologistes. La portée populaire et individuelle de ce courant philosophique repose sur une éthique et une idée simple qu’un système global (la nature) est supérieur à chacune de ses parties (l’Homme étant une partie de la nature). L’écologie profonde de Naess cherche à préserver, voir à sauver la nature, en recréant l’unité du moi (self) et en incorporant ce moi dans la nature. Ainsi, l’objectif nodal de l’écologie profonde est la réalisation de Soi dans le système global. Comment y parvenir ? Arne Næss[26] qui est à l’origine de cette pensée philosophique[27] expose clairement deux dimensions ou déclinaisons du soi. Il y a d’abord « le soi personnel » et ensuite le « Soi du monde », avec un S majuscule, qui désigne l’humanité additionnée, sans hiérarchisation des espèces, à l’ensemble des êtres du vivant. Cette éthique s’appuie sur huit postulats[28] qui permettent d’élaborer une résilience écocitoyenne individuelle qualifiée par Naess d’écosophie. En revanche, point d’importance, l’écologie profonde n’est ni un projet politique et ni un manifeste. En fait c’est plus par souci pragmatique que les huit postulats de l’écosophie sont volontairement vagues. Le but était de constituer une plateforme de rassemblements internationaux de l’écologie profonde. D’ailleurs, l’écologie profonde fut à l’origine de plusieurs mouvements dont First Earth et Greenpeace.
Cependant, l’idée d’un « commun » est apparent dans l’article de Naess et notamment l’idée de décentralisation et d’autonomie locale c’est du moins ce que l’on peut imaginer à travers la lecture du septième postulat :
« La vulnérabilité d’une forme de vie est directement proportionnelle aux poids des influences extérieures, extérieures à la région ou est localisée cette forme de vie en équilibre écologique. Ce fait doit nous encourager à poursuivre nos efforts en vue d’obtenir la reconnaissance du droit de chaque région de se gouverner elle-même, à se suffire à elle-même tant sur le plan matériel que sur le plan moral […][29] ».
Mais il est moins explicite sur la plate-forme imaginée depuis 1984 qui dérive de l’article de 1973[30] et qui est réaménagée quasiment tous les deux ans par les gestionnaires du site. Aussi ce postulat de décentralisation ne permet-il pas de tendre vers une forme d’organisation politique collective ou d’un commun ; en revanche, l’écologie profonde proposée dans l’article de 1973 par Naess et notamment ce septième postulat permettra à d’autres courants plus structurés d’élaborer des alternatives à l’État, à l’image du biorégionalisme avec les concepts de « bio-région » et « de réhabitation » .
En résumé, bien que cette philosophie soit patinée de spinozisme, elle est chez plusieurs adeptes souvent imprégnée d’ésotérisme et de mysticisme. En effet, longtemps soumise aux dérives populaires et autres instrumentalisations, sa portée était comparable au transcendantalisme d’Emerson ou à l’anthroposophie de Steiner. Ce qui explique peut-être pourquoi, pour les contradicteurs de l’écologie profonde, à l’image de Murray Bookchin ou de certaines tendances de l’éco-socialisme, la théorie de la « réalisation de Soi » conduirait à abolir l’individu au profit d’un holisme manipulable proche du mystique et voire de l’éco-fascisme. Aujourd’hui, cette philosophie permettant une résilience écocitoyenne se généralise au sein de la vague actuelle des ultra-écologicus. Mais on retrouve certains postulats chez plusieurs entrepreneurs politiques des partis écologistes institutionnels. Par exemple en France, à l’image de Piolle, Rousseau, Bathot et voire Jadot, lors de la primaire écologistes de 2021, tous ont fait référence à l’écologie profonde dans le discours de campagne et lors des débats. En d’autres termes, tous les écologistes à leurs manières utilisent, appliquent, instrumentalisent, voire bricolent dans leurs discours les huit postulats de l’écologie profonde.
Exemple 2 – La bio-région du bio-régionalisme
La conceptualisation ou l’idée de bio-région est apparue au début des années 1960-70, sur la côte ouest des États-Unis. Techniquement, elle est le résultat, en pleine révolution contre-culturelle californienne, d’un rapprochement entre les milieux éco-anarchistes et les mouvances de défense et de protection de la nature.
À la base, la bio-région est un concept (une vision du monde) qui nous invite à délimiter les territoires selon leurs réalités (ou qualités) écologiques. La bio-région formerait donc une nouvelle unité institutionnelle permettant une réappropriation collective des enjeux écologiques, sociaux et donc politiques. Si on reprend à notre compte la lecture de Mathias Rollot et Martin Schaffner[31], concrètement une bio-région est un morceau de la biosphère dont les limites ne sont pas définies par des frontières administratives (département, région, État) mais par des limites géographiques et biologiques. Son périmètre est défini par les humains qui l’habitent – de façon autodéterminée dans la volonté de prendre soin de ce milieu de vie commun. Une bio-région est donc l’alliage, sur un territoire donné, entre une communauté habitante humaine et une communauté biotique. Elle doit être à la fois assez grande pour y maintenir l’intégrité des espèces qui y vivent et des cycles qui s’y déploient (nutriments, migrations, cycles de l’eau, etc..) ; et assez petite pour que ses habitants se considèrent comme chez eux. Pour le biorégionalisme, l’idée est de vivre en osmose avec le monde de la bio-région. Deux des pères du bio-régionalisme expliquaient en 1975 que le concept :
« De bio-région a été introduit pour explorer la possibilité de développer une méthode de planification, relativement non arbitraire, pour les réalités biologiques sauvages du paysage. […] Les bio-régions sont provisoirement définies comme des aires remarquables de surface de la Terre, du point de vue biologique, qui peuvent être cartographiées et discutées comme modèles existants distincts, de plantes, d’animaux, et d’habitants ; des distributions liées aux modèles d’aires de répartition et aux processus complexes de construction de niches culturelles – tout en tenant compte des formations attribuées à l’occupation d’une ou plusieurs populations successives du mammifère culturel[32] ».
Le mot clé chez les bio-régionalismes est le terme réhabitation. Le « commun » passe par cette idée de réhabitation, en fait il ne peut exister de « bio-région sans réhabitation[33] » du territoire. Ce mot est l’invention de Peter Berg et de Raymond Dasmann, il apparaît dans leur article fondateur « Réhabiter la Californie », publié en 1976. Ces deux pionniers du bio-régionalisme d’Amérique du Nord annonçait « quelque chose est en train de se passer en Californie […] un peu partout se déploient des communautés de gens qui tentent de nouvelles manières de vivre sur et avec la Terre. Nous appelons ce phénomène réhabitation, un processus qui implique d’apprendre à vivre in situ[34] »
Aux États-Unis, le biorégionalisme est peut-être la tendance de l’écologie radicale qui produit le plus sur le plan théorique et scientifique[35] mais elle est également celle qui agit le plus sur le plan de l’activisme écologiste. Plutôt décroissantiste que libertaire, l’économie bio-régionale est une économie de stabilité, de coopération et bien évidemment d’autosuffisance. Elle est basée sur une idée du partage et de l’égalité. Finalement, l’édification d’une bio-région est soutenue par trois piliers : l’autosuffisance (décroissance) pour la dimension économique, l’autonomie (administrative) pour la dimension institutionnelle et la spiritualité (écosophie) pour la dimension sociale. Certes il existe des nébuleuses séparatistes qui se revendiquent du biorégionalisme, mais seul le biorégionalisme proposé par Kirkpatrick Sale[36] est considéré comme radical. Ce dernier a engagé son projet sur la voie de l’antiproductivisme. Aussi à la différence des biorégionalistes classiques plus décroissantistes qu’anarcho-écologistes, Sale emprunte aux autres mouvements de l’écologies radicales des concepts et des paradigmes ouvrant sur des perspectives du possibles libertaires. Par exemple sur le plan de l’institutionnalisation des réhabitants dans une bio-région, il propose des modèles de gouvernance directement inspirés des travaux sur le communalisme de Bookchin.
Page 6
En résumé, à la lumière de ces origines contre-culturelles, les visions de bio-région des biorégionalistes entrent en résonnance avec une grande partie des écologistes radicaux et institutionnels actuels. En France, ces dernières années des ZAD, des collectifs à l’instar de l’Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, des mouvements éco-féministes, des syndicats d’habitants, et même des Gilets Jaunes se revendiquent du bio-régionalisme. Paradoxalement, c’est aussi, depuis peu, le cas des écologistes institutionnels notamment à travers le prisme des régionalistes européens et français inhérent aux liens de coalitions entre les confédérations française Régions&Peuples Solidaires et l’Alliance Libre Europe.
Exemple 3 – Le municipalisme libertaire de l’écologie sociale
Si le biorégionalisme est l’œuvre d’une kyrielle de pionniers, l’écologie sociale se résume à la pensée d’un seul homme : Murray Bookchin. Celui-ci est peu connu du public européen, néanmoins ses écrits et ses conférences nous donnent à voir une vision écologique dont le projet de société est incontournable aujourd’hui pour saisir les mouvements qui se revendiquent de l’écologie radicale. L’œuvre de Bookchin est à la fois très dense et infiniment complexe ; néanmoins deux ouvrages permettent de saisir sa pensée dans sa globalité[37]. Ces deux essais résument comment s’est échafaudée l’idée d’un courant politique basé sur le municipalisme libertaire et surtout pourquoi Bookchin estimait que c’était le seul outil socio-écologique capable de réduire certaines inégalités sociales et à terme le productivisme dans son ensemble. Ce qui est intéressant avec ce penseur, à l’inverse d’un Naess ou d’un Berg, c’est d’observer sa volonté d’élaborer un projet de société écologiste. C’est donc une réelle dialectique qui est proposée par le penseur américain et moins une éthique ou une philosophie. Pour ce faire, celui-ci utilise comme fondation éco-républicaine le concept de municipalisme libertaire. Car pour Bookchin, « La commune est la cellule vivante qui forme l’unité de base de la vie politique et de laquelle tout provient : la citoyenneté, l’interdépendance, la confédération et la liberté. Le seul moyen de reconstruire la politique est de commencer par ses formes les plus élémentaires : les villages, les villes, les quartiers et les cités où les gens vivent au niveau le plus intime de l’interdépendance politique au-delà de la vie privée[38] ».
Bookchin est parti d’une réflexion sur la place nodale de la hiérarchisation dans les sociétés, et il a tenté de démontrer que toutes dominations hiérarchiques sont intrinsèquement liées à la crise écologique que traversent les XX et XXIe siècles. Aussi fait-il observer que l’origine de nos sociétés hiérarchisées n’est pas une rupture morale ou socio-écologique (passage d’une société à une autre, par exemple lors de l’industrialisation) mais un problème lié à une logique d’organisation sociale et sociétale hiérarchisée. De plus, il souligne que « l’émergence de la société est aussi un fait naturel, qui trouve son origine dans la biologie de la socialisation humaine [39] ». En fait, il tente de démontrer que la société découle de la nature et paradoxalement que la déconsidération de la nature comme étant l’objectivation qui mène à son irrespect et à sa destruction est le résultat de la projection sociales des organisations humaines que nous avons institutionnalisées. Cependant, l’histoire de nos organisations sociétales montre l’existence de sociétés plus égalitaristes, donc moins hiérarchiques, et souvent sans principe de domination de l’homme par l’homme et encore moins de classe. Bookchin les appellent les « sociétés organiques[40] », toutes fonctionnaient sur le principe :
- de l’usufruit ; les biens matériels ne vont plus être des propriétés mais des usufruits (appartiennent à celui qui l’utilise, qui en ont besoin).
- du minimum irréductible ; chaque individu avait un droit au moyen de subsistance. Ce principe exclut l’égalité par le droit, par contre garantit d’un point de vue social que tout le monde doit disposer d’un minimum en termes de liberté et de propriété.
- de complémentarité ; principe lié à une organisation sociale selon laquelle chacun à une fonction estimable dans la communauté.
- de la cohésion sociale de ces communautés ; la cohésion est assurée par des liens de parenté. Ces liens doivent fonctionner sans qu’un quelconque groupe d’individus monopolise le pouvoir
Le projet de société de l’écologie sociale est donc de retrouver des logiques sociétales qui conduiraient à cet égalitarisme comparable aux sociétés organiques d’antan. Pour Bookchin, le constat est simple : il faut reconstruire une société basée sur l’usufruit, ce qui implique la fin de la propriété privée. « L’unité dans la diversité » est son leitmotiv, il va même jusqu’à défendre l’idée d’une allocation universelle pour les citoyens. Le moyen pour y parvenir est de redonner du pouvoir d’initiative populaire au citoyen. Par exemple, les décisions (politiques, administratives et même économiques et sociales) seront prises directement par les citoyens et doivent être le prolongement de ce que la science écologique a permis de mettre en lumière. Ici, le commun est entendu au sens du politeia et doit signifier simplement la gestion des affaires publiques par la population au niveau communautaire. Seul le municipalisme permettrait selon lui de sortir du carcan de la société hiérarchique et des systèmes de classes qui dominent nos sociétés libérales[41]. Dans le municipalisme, les usagers gèrent la chose publique par le biais d’assemblées citoyennes et élisent des conseils qui exécutaient les décisions politiques formulées dans ces assemblées donc, seul. Le municipalisme est le scénario permettant de transformer les trois piliers qui supportent la société de classe :
- le pilier économique: sera anticapitaliste et antiproductiviste (mais pas anti technologique, Bookchin n’est pas néo-luddite).
- le pilier politique: repose sur l’idée de démocratie directe ; le citoyen doit être émancipé politiquement.
- le pilier institutionnel: avec comme toile de fond la fin de l’organisation administrative de l’État. Il s’agit, ici, de se défaire de l’institutionnalisation pas du pouvoir en tant que tel ; les bookchiniens sont contre l’État institutionnalisé, contre l’État-nation, contre l’État centralisateur du pouvoir et proposent donc des coopérativismes, des fédéralismes ou simplement comme dans le Vermont dans les années 1960-1970 des systèmes de décentralisations écologiques.
Page 7
Enfin, pour y parvenir Bookchin appelle de ses vœux un mouvement de révolution capable de stimuler la création d’assemblées décisionnelles par quartier, village et ville organisées d’une manière fédérale et en tension avec les institutions de l’État centralisateur.
En résumé, nous avons tenté de montrer qu’avec Murray Bookchin, l’idée d’une démocratie délibérative demeure le fondement éco-républicain le plus abouti de son projet de municipalisme. D’ailleurs, outre les différentes tentatives de communalisme en Amérique du Nord, l’héritage de Bookchin se retrouve dans le Chiapas imaginé par le sous-commandant Marcos au Mexique et la région autonome du Rojava (Kurdistan occidental) dans le nord de la Syrie se revendique être le résultat de l’application des propositions du philosophe. Enfin, force est de constater que l’écologie sociale inspire, outre les anarcho-écologistes et le mouvement altermondialiste, plusieurs courants écologistes institutionnels. En France, des acteurs clés de l’écologie institutionnelle instrumentalisent une partie des pensées de Murray Bookchin.
En guise de conclusion :
Nous avons pu noter dans un premier temps, que remise sur le devant de la scène grâce, notamment, aux travaux d’Elinor Ostrom, la dynamique des communs occupe de plus en plus l’espace du politique. En effet, nous avons pu noter que l’idée de commun propose une capacité d’action écocitoyenne, orientée vers la prise en charge collective de multiples biens ou de services à travers le prisme de valeurs républicaines comme : l’égalité, la liberté, la solidarité (solidarisme) et la convivialité.
En ce sens, dans un second temps, après avoir montré que c’est en raison d’un combat asymétrique avec les autres idéologies que la politisation de l’écologie a toujours peiné à se frayer un chemin dans le champ politico-médiatique de nos démocraties (néo)libérales. Par contre nous avons pu souligner que depuis les années 2000 tous les écologistes ont comme ennemis principaux : la croissance, la technique et la mondialisation. Dans un troisième temps, nous avons pu observer que le commun est incontestablement un élément clé de l’écologie politique radicale car il matérialise une volonté de réappropriation de la chose publique et induit dans le champ politique de nouvelles formes d’engagement écocitoyennes. De sorte qu’aujourd’hui, système alternatif entre l’État et le marché privé, le commun (en tant qu’organisation institutionnelle, économique et sociale) est devenu le point d’achoppement entre tous les projets politiques écologistes (institutionnels comme radicaux).
Enfin dans un dernier temps, à l’image d’un Serge Audier[42], nous avons tenté de présenter trois scénarii du commun inhérents à l’histoire alternative de l’émancipation écocitoyenne dont les « ennemis » seraient du côté du capitalisme et de l’économie verte. Plus prosaïquement en choisissant trois voix ou plutôt trois voies qui passeraient par la case anti-productiviste, nous avons voulu mettre en lumière les fondations de trois utopies réelles au sens d’Erik Olin Wright dont La perspective du possible est la dynamique des communs. Certes ces trois exemples ne constituent pas une liste exhaustive des visions éco-républicaines du commun, mais ils matérialisent trois propositions majeures d’un éco-républicanisme et de son institutionnalisation originale. Enfin, nous soulignons que plus que des racines anarcho-écologiques, ce sont des racines libertaires qui animent ces courants, car toutes les trois sont appuyées par des valeurs acratiques comme la solidarité, l’entre-aide, l’égalité, la justice sociale et bien évidemment la liberté et le commun. Enfin, elles ont toutes les trois pour ambitions de tisser des liens de communalisation et de sociation au sens de Weber, entre « le soi » et le Soi, entre les « réhabitants » et la bio-région, entre les citoyens et la commune, permettant, peut-être, de sortir du système capitalisme et donc du capitalocène ou si l’on préfère, de l’anthropocène (les effets demeurent les mêmes) que nous vivons sous fond de crise éco-sociale.
[1] Pierre Madelin, La tentation écofasciste. Ecologie et extrême droite, éditions Ecosociété, Québec, Canada, 2023. Et Antoine Dubiau, Ecofascismes, Editions Grevis, Caen, 2022.
[2] Utopies réelles, La découverte, Paris 2020.
[3] Au sens de Haud Guégen et Laurent Jeanpierre in La perspective du possible. Comment penser ce qui peut nous arriver et ce que nous pouvons faire, La découverte, l’Horizon des possibles, Paris 2022.
[4] La cité écologique. Pour un éco-républicanisme. Editions la Découverte, Paris, 2020, p. 68.
[5] La cité écologique, op. cit., p. 556-557.
[6] Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 2015 (réédition de 2022).
[7] Ibidem, p. 494-495.
[8] Ibid., p. 459.
[9] Ibid., p. 459.
[10] La cité écologique, op.cit., p. 557.
[11] Audier, La cité écologique, op.cit., p. 557.
[12] Commun, op. cit., p. 456.
[13] Ibid., p. 460.
[14] La cité écologique, op. cit., p. 555.
[15] Commun., op. cit., quatrième de couverture.
[16] Les partis verts en Europe Occidentale, Economica, Paris 1996.
[17] Dick Richardson, Chris Rootes (eds), The Green chalenge. The development of Green Parties in Europe, éditions Routledge, Londres 1995. Pascal et Jean-Michel de Waele, Les partis verts en Europe, Editions Complexe, 1999.
[18] Voir les travaux de Bruno Villalba.
[19] In La révolution démocratique verte, éditions Albin Michel, Paris 2023.
[20] Marc Lomazzi, Ultra-écologicus. Les nouveaux croisés de l’écologie, Flammarion, Paris 2022.
[21] Nous employons ce terme au sens du professeur de philosophie sociale de l’Université de Toulouse, C. Bouglé, Le solidarisme, V. Giard & E. Brière éditeurs, Paris, 1907.
[22] Ivan Illich dans le Nouvel Observateur, été 1973, cité in Jean-Michel Djian, Ivan Illich. Lhomme qui a libéré l’avenir, Seuil, Paris 2020 pp.104-105.
[23] Philippe Simmonet, Le brun et le vert. Quand les nazis étaient écologistes, Les éditions du Cerf, Paris, 2022.
[24] In Le Commun, op. cit., p. 15.
[25] Janet Biehl, Le municipalisme libertaire. La politique de l’écologie sociale, éditions Ecosociété, Québec, Canada, 2013.
[26] L’écologie profonde, PUF, Paris, 2021.
[27] Une écosophie pour la vie. Introduction à l’écologie profonde, Points seuil, Paris, 2017.
[28] Ibid., pp. 26-41.
[29] Ibid., pp. 34-35.
[30] Voir Mathilde Ramadier, L’écologie profonde, PUF, collection QSJ, 2023, pp. 52-61.
[31] In Qu’est-ce qu’une biorégion ?, Editions Widprojet/inédit, 2021.
[32] Allen Van Newkirk in « Biorgions : Towards Bioregional Strategy for Human Cultures », Environnental Conservation, 1975, Vol.2, 2, pp. 108-119.
[33] Ibid.
[34] Pour la dernière traduction, voir la revue EcoRev’, n°47, 2019, pp. 73-84.
[35] Il existe une multitude d’essais, d’analyses, de propositions autour du concept de bio-région.
[36] L’art d’habiter la Terre. La vision biorégionale, Widprojet, 2020.
[37] The ecology of freedom qui a été traduit dans ce recueil de textes par l’écologie sociale. Penser la liberté au-delà de l’humain, éditions Widprojet, Paris 2020 et Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté. Éditions Écosociété, Québec, Canada, 2010.
[38] In Le municipalisme Libertaire. Une nouvelle politique communale ?. Extraits de From Urbanization to Cities (Londres, Cassell, 1995). Traduit par Jean Vogel pour la revue Articulations 1995. Page 14.
[39] Une société à refaire. Vers une écologie de la liberté, op.cit., p. 47.
[40] In l’écologie sociale. Penser la liberté au-delà de l’humain, op. cit., pp. 17-43.
[41] In La révolution à venir. Assemblée populaire et promesses de démocraties directe, éditions Agone, Paris 2022.
[42] Voir La société écologique et ses ennemis. Pour une histoire alternative de l’émancipation, Éditions La Découverte, Paris, 2017.
D'autres articles

La Loi Toubon et la Loi 101 de la philosophie au droit : la France et le Québec entre républicanisme et libéralisme
Comme les travaux menés par Joseph-G. Turi à la fin des années 1980 l’ont démontré, les législations linguistiques québécoise et française visaient toutes deux la consécration d’une seule langue officielle, mais avaient fait l’objet d’interprétations plutôt favorables à une langue autre[2]. Depuis…

Pasquale Paoli et sa documentation sur les régimes mixtes de l’Antiquité
Qu’est-ce que les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle ont cherché dans la documentation antique à propos des régimes mixtes et, surtout, qu’y ont-ils trouvé ? C’est une question que l’on abordera en la circonscrivant à des limites raisonnables, c’est-à-dire à un personnage, Pasquale Paoli, et à sa…

Échanges avec Vincent Peillon
Jean-Guy TALAMONI
Merci, Vincent Peillon, pour cette conférence qui ouvre des pistes et présente des idées nouvelles, à plusieurs titres. Il serait intéressant qu’il y ait un échange avec les collègues qui sont présents à ce colloque. D’autant que…