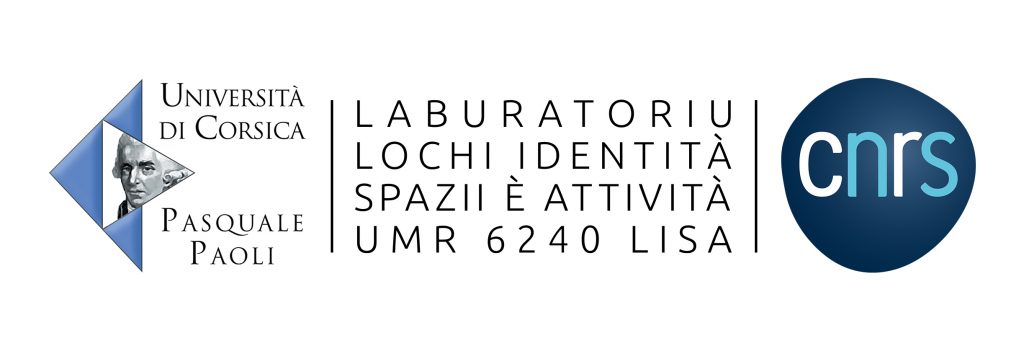Le Républicanisme à l’épreuve sous la seconde république (1848-1852) : L’affrontement entre une vision conservatrice et une vision démocratique et sociale
David Stefanelly
La République est un terme polysémique. Le dictionnaire Larousse la qualifie de « forme d’organisation politique dans laquelle les détenteurs du pouvoir l’exercent en vertu d’un mandat conféré par le corps social ».
La Seconde République, qui s’installe à l’issue de la révolution des 22, 23 et 24 février 1848 en raison de la progression des idées républicaines et du discrédit des solutions concurrentes (légitimisme, orléanisme, bonapartisme), suscite de profondes divergences. À partir de juin 1848, dans le contexte de la suppression des ateliers nationaux, destinés à offrir aux chômeurs des travaux publics d’importance secondaire pour les occuper et les rémunérer, deux visions de la République s’affrontent : les tenants d’une République démocratique et sociale s’opposent aux défenseurs d’une République conservatrice ou modérée, ce qui attise les conflits sur le sens de la République.
Pour étudier cette opposition, qui se solde par la disparition de la Seconde République en 1852, nous nous appuierons sur l’action des légitimistes[1], de retour au premier plan à l’issue des élections constituantes en avril 1848 puis législatives en mai 1849 et qui, faute de mieux, défendent la République conservatrice à l’intérieur du parti de l’Ordre, ainsi que sur des travaux récents qui renouvellent la recherche historique sur la période[2].
La République de Février 1848, deux conceptions de la République à l’œuvre
La notion de République est ancienne et ne date pas de 1848[3]. Une partie du mouvement libéral, apparu sous la Restauration en opposition à la réaction ultra-royaliste et attaché aux principes de 1789, accède au pouvoir en 1830 et instaure la Monarchie de Juillet. Il met en pratique le gouvernement représentatif auquel il associe la liberté. Celle-ci est mise au service du bon gouvernement de la société et s’applique dans le domaine de la presse ou encore dans celui des élections. L’ « apprentissage de la politique moderne »[4] s’effectue grâce à l’élargissement du corps électoral pour les élections du conseil municipal et de la Garde nationale. Dans ce contexte de liberté, un mouvement républicain porteur d’un projet alternatif apparaît et exprime des critiques à l’encontre du système en place. Structuré autour d’associations comme la Société des droits de l’homme, il se montre sensible à la question ouvrière et revendique une réelle représentation. Un ouvrier horloger saint-simonien, Charles Béranger, présente en 1831 une pétition à la Chambre des députés pour dénoncer une mauvaise représentativité des parlementaires et le mensonge du pouvoir sur sa volonté de promouvoir les capacités :
« On avait passablement parlé du règne des capacités. Or, je me disais : Sans doute chacun sera classé suivant sa capacité, et rétribué selon ses œuvres. Simple que j’étais ! »[5]
La campagne pour la réforme électorale de 1838-1841, combattue par Adolphe Thiers alors président du Conseil, permet l’affirmation d’une conception de la République qui associe suffrage universel et émancipation des travailleurs. François Arago, physicien membre de l’Académie des sciences et député de l’opposition radicale, s’inscrit dans cette approche dans son discours du 16 mai 1840 où il souligne l’exclusion politique et l’exploitation économique dont sont victimes les ouvriers et la nécessité d’instaurer un suffrage universel émancipateur :
« Je dis qu’il y a, dans la population, une partie considérable qui est privée de toute espèce de droits politiques, et qui non seulement est la plus nombreuse, mais encore qui paie la masse la plus considérable dans les contributions de l’État. […] Il y a, Messieurs, dans notre pays une classe de la population qui souffre beaucoup. Elle souffre à tel point qu’elle est torturée par la misère et la faim. (Vive interruption.) […] cette partie de la population est plus particulièrement la population manufacturière. […]
Tant que la réforme n’aura pas été introduite dans le pays, tant qu’on pourra appeler cette chambre, à tort ou à raison, une chambre de monopole, les classes ouvrières qui souffrent, je vous ai prouvé qu’elles souffrent et qu’elles souffrent violemment, qu’elles sont souvent torturées par la faim (Exclamations, la phrase reste en suspens). […] Les classes ouvrières se sentent humiliées de l’espèce d’ilotisme politique (violents murmures) dans lequel le mode actuel des élections les place. […] La révolution de 1830 a été faite par le peuple ; fermons la bouche à ceux qui disent qu’elle n’a pas été faite pour le peuple. »[6]
Page 1
[1] David STEFANELLY, Affirmation puis effacement du mouvement légitimiste…
[2] Samuel HAYAT, 1848, quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté…
[3] Claude NICOLET, L’Idée républicaine en France (1789-1924), Essai d’histoire…
[4] Christine GUIONNET, L’apprentissage de la politique moderne : les élections…
La République de Février 1848 n’est pas un régime de transition mais un moment d’expérimentation d’un système pluriel dans lequel les citoyens sont acteurs de la vie publique grâce au passage d’une forme de « représentation exclusive », typique de la monarchie de Juillet, à une « représentation inclusive »[7] et à la création de nombreuses instances. La formation du Gouvernement provisoire est subordonnée aux insurgés parisiens. La réorganisation de la Garde nationale par l’élection des officiers permet l’émergence de « citoyens-combattants »[8]. La Commission du Luxembourg, dont la mission est de réfléchir et de proposer une nouvelle organisation du travail, témoigne de l’intégration des ouvriers à la sphère publique et de la prise en compte des préoccupations sociales. Les formes d’expression se développent grâce à la multiplication des mouvements clubistes et des journaux. La citoyenneté se transforme donc et ne se limite plus à celle du gouvernement représentatif comme c’était le cas dans le régime précédent même si les femmes, les étrangers et, à un degré moindre, les citoyens de province forment trois catégories d’exclus.
Pour autant, les institutions de la République de Février sont l’objet de controverses. Les mandats des institutions de représentation du peuple suscitent des interprétations divergentes, qui s’enracinent dans les deux conceptions de la République nées dans le régime précédent et qui coexistent alors dans le nouveau régime politique. La majorité des membres du Gouvernement provisoire entend rétablir l’ordre et assurer l’organisation des élections d’une Constituante mais se heurte à des chefs clubistes qui aspirent à une transformation sociale massive. Dans le second numéro de son journal, L’Ami du peuple, le 28 février, Raspail rédige un article en faveur d’un gouvernement qui joue le rôle d’une autorité révolutionnaire :
« Nous avons entendu vainement ces trois grands jours, pour nous orienter sur les tendances du gouvernement provisoire de la République française : il nous semble qu’il a de la peine à se défaire des habitudes de l’ex-chambre des députés. Ce n’est plus le temps des phrases et de tous ces longs parlages parlementaires ; une République qui n’agit pas à toutes les heures est morte ; elle ne donne signe de vie qu’à soixante pulsations par minute. Que faites-vous donc, citoyens membres du gouvernement provisoire ? Vous avez tout à réorganiser, et nul de vous n’est à son poste […]. Nulle idée, nul acte qui vous dévoile au peuple ! Vous lui administrez de l’opium à hautes doses ; et voilà tout. »[9]
Le rôle de la Garde nationale suscite la controverse. D’un côté, elle est présentée comme le peuple en armes et donc la seule habilitée à garantir l’ordre. D’un autre côté, elle est perçue comme une institution de simples citoyens, chargée du maintien de l’ordre en compagnie d’autres corps d’armée permanents (unités de police, armée, Garde nationale mobile). La Commission du Luxembourg voit s’opposer deux visions quant à sa fonction. La première, partagée par une majorité des membres du Gouvernement provisoire et par son président Louis Blanc, la voit comme un simple lieu de réflexion économique, chargé de transmettre des propositions à la future assemblée, une « synagogue socialiste »[10]. La deuxième, née de l’investissement et du travail des délégués ouvriers, vise à en faire une instance inédite de représentation et d’organisation autonome des travailleurs. Enfin, la presse et les clubs de Paris suscitent des divergences chez les républicains. Les uns ne les perçoivent que comme un lieu de discussion. Les autres désirent en faire des lieux d’action collective et des acteurs de la préparation des élections. C’est le cas de Raspail qui, dans un article de L’Ami du peuple, le 23 mars 1848, présente le rôle actif des clubs dans les élections :
« Le jour des élections approche ; les coteries se remuent ; le patriotisme ne doit pas rester en défaut. Que tout patriote soit à son poste, et qu’il prépare son vote par la discussion des titres de candidats. […] Nommez des travailleurs, bons et braves camarades. […] C’est dans les clubs surtout que doivent se préparer les élections ; et c’est là qu’on doit indiquer à chaque citoyen les formalités à remplir, pour que chacun arrive en temps opportun à déposer son vote dans l’urne électorale. »[11]
Les tensions nées des mésententes sur le rôle des institutions de la République de Février s’expriment lors des trois manifestations du printemps 1848, le 17 mars, le 16 avril et le 15 mai. L’affrontement entre deux conceptions opposées de la République, l’une modérée et conservatrice, l’autre démocratique et sociale, en germe depuis les débuts du nouveau régime, se met en place.
Page 2
La journée du 17 mars permet aux délégués des clubs et des corporations de se présenter comme les porte-paroles des ouvriers représentés auprès du Gouvernement provisoire. Dans un article publié dans Le Populaire, le 17 mars, Cabet veut profiter de la manifestation pour rappeler le Gouvernement provisoire à ses devoirs auprès des ouvriers :
« Nous allons donc demander au Gouvernement provisoire : 1° l’éloignement des troupes ; 2° l’ajournement des élections pour la Garde nationale jusqu’au 5 avril ; 3° et l’ajournement des élections pour l’Assemblée nationale jusqu’au 31 mai. Nous formerons cette demande sans haine et sans menaces, comme des citoyens qui connaissent leurs devoirs et leurs droits. Puisse le Gouvernement provisoire accéder à nos vœux. Puisse-t-il, fidèle à ses engagements, comprenant toute la grandeur de sa mission révolutionnaire et humanitaire, s’appuyant résolument sur le Peuple, ne laisser désormais aucune inquiétude aux amis de la République, comme aucune espérance à ses ennemis. »[12]
Désormais, les deux visions antagonistes de la République se font face. Le ministre de l’Intérieur Ledru-Rollin incarne la République démocratique et sociale dans ses circulaires qui visent à nommer des commissaires du gouvernement qui éclairent le peuple dans les provinces, à écarter les opportunistes et les représentants du régime précédent et à promouvoir une politique d’éducation républicaine. La révolution de février 1848 est alors perçue comme le point de départ de la transformation républicaine du pays, non le point final :
« Cette Assemblée doit incessamment travailler à fonder solidairement l’édifice de la société républicaine. Elle doit porter une main hardie sur les institutions oppressives et condamnées, ne reculer devant aucune des conséquences de la révolution, entraîner le pays par la grandeur de ses résolutions, et, s’il le faut, briser sans ménagement toutes les résistances. Le salut de la France est à ce prix. Or, cette mission difficile et dangereuse ne peut être confiée qu’à des mandataires libres de tout engagement avec le passé, supérieurs à toute faiblesse, préparés à verser le sang pour le triomphe complet de la sainte cause du peuple ! Sachez bien que la République n’est pas dans de vaines déclarations, non plus que dans un changement de personnes. Elle n’existera vraiment que lorsque, grâce à l’intervention de tous les citoyens dans les affaires publiques, la volonté, l’intérêt, les besoins du plus grand nombre recevront leur légitime satisfaction. »[13]
Cette conception de la République n’est pas partagée par tous les républicains, notamment Lamartine qui défend une approche modérée du nouveau régime selon laquelle tout se résume à l’instauration du suffrage universel à la place du suffrage censitaire :
« La loi électorale provisoire que nous avons faite est la plus large qui, chez aucun peuple de la terre, ait jamais convoqué le peuple à l’exercice du suprême droit de l’homme, sa propre souveraineté. L’élection appartient à tous sans exception. À dater de cette loi, il n’y a plus de prolétaires en France. Tout Français en âge viril est citoyen politique. Tout citoyen est électeur. Tout électeur est souverain. Le droit est égal et absolu pour tous. Il n’y a pas un citoyen qui puisse dire à l’autre : « Tu es plus souverain que moi ! » Contemplez votre puissance, préparez-vous à l’exercer, et soyez dignes d’entrer en possession de votre règne ! »[14]
Si, au 17 mars, le débat entre les deux républiques n’est pas tranché, le 16 avril, journée durant laquelle une contre-manifestation bourgeoise succède à une manifestation ouvrière, marque l’échec de la République démocratique et sociale. La République de Février est remise en cause parce que la conception modérée l’emporte. La Garde nationale devient un outil de l’ordre au service de l’État. La Commission du Luxembourg est remplacée par une simple commission parlementaire dominée par les conservateurs et son rapporteur légitimiste le comte de Falloux. Les clubs et les journaux, victimes de mesures restrictives et d’attaques virulentes, ne peuvent plus être que de simples lieux de discussion. Leur fréquentation diminue rapidement. Le Gouvernement provisoire, quant à lui, n’est pas une autorité révolutionnaire mais se montre soucieux du légalisme face aux manifestants :
« La journée d’hier n’a fait qu’ajouter une consécration nouvelle à ce qu’avait si puissamment inauguré la journée du 17 mars. De même que le 17 mars, le 16 avril a montré combien sont inébranlables les fondements de la République. […] Vous avez confondu les espérances des ennemis de la République, assuré la sécurité du Paris libre, et dissipé les alarmes répandues dans les départements. Citoyens, l’unité du Gouvernement provisoire représente l’unité de la patrie ; c’est ce que vous avez compris, grâces vous en soient rendues ! »[15]
Le 15 mai, jour d’une manifestation pour la Pologne et qui se termine par l’invasion de l’Assemblée constituante, assure la victoire des républicains modérés et conservateurs. À l’instar du député Mongin de Montrol, ceux-ci refusent de prendre en compte les pétitions apportées par les manifestants et lues par Raspail :
« Le citoyen Montrol. Je n’ai point entendu, je n’ai point voulu entendre les pétitions qui vous ont été lues à cette tribune. Envoyé ici par le peuple, je ne voterai jamais, je ne délibérerai jamais que dans la plénitude de mon droit et de ma liberté.
Un représentant. L’Assemblée ne peut délibérer quand elle est envahie.
(Un grand nombre de représentants se lèvent pour appuyer cette motion.)
Voix dans la foule. Qu’on délibère immédiatement !
Autres voix au milieu du bruit. Il y a des ennemis du peuple parmi les représentants ; ils ne veulent pas qu’il parle.
Le citoyen Président. La pétition a été déposée sur le bureau ; l’Assemblée nationale … (Interruptions nombreuses.)
Voix du peuple. Nous voulons une décision immédiate !
Le citoyen Président. L’Assemblée nationale a votre pétition ; elle s’occupait, lorsque vous êtes entrés, du sort de la Pologne. Je vous invite à sortir pour que l’Assemblée nationale puisse immédiatement traiter cette grave question.
Voix du peuple. Nous ne voulons pas attendre. Un décret ! Un décret ! »[16]
Ils contribuent à ce qu’une conception exclusive de la représentation, conforme à leurs convictions modérées, s’impose au détriment d’une approche inclusive. Les institutions issues de la République de Février sont définitivement mises à mal. L’Assemblée constituante et, plus tard, l’Assemblée législative, détiennent le monopole de la représentation et mènent la lutte contre la République démocratique et sociale pour défendre une République modérée et conservatrice.
Le légitimisme, une des composantes du parti de l’Ordre tenant d’une République conservatrice
Au début de la Seconde République, le légitimisme repose sur la volonté d’installer, à terme, le comte de Chambord sur le trône. En attendant, sous l’influence de l’avocat Pierre-Antoine Berryer son chef de file légitimiste, il s’inscrit dans la démarche conservatrice du parti de l’Ordre et se structure autour du groupe parlementaire pendant la Constituante et la Législative. La coalition des droites met en avant le conservatisme social, aspire à un retour à l’ordre et craint les « rouges », ses adversaires politiques favorables à une autre approche de la République. La peur façonne le comportement politique du comte de Falloux. Les débats de l’Assemblée constituante l’inquiètent au plus haut point :
« Chaque jour (…) nous apportait de nouvelles lumières sur les dangers de la situation et permettent de comprendre l’adhésion des légitimistes au parti de l’Ordre. Nous étions arrivés de nos provinces, très résolus à nous montrer indulgents pour le gouvernement provisoire, à condition cependant qu’il s’efforça d’inaugurer une république sensée et sérieuse, à la place de cette république déclamatoire et stérile qui, du 24 février au 4 mai, s’était épuisée en démonstrations vaines, quand elles n’étaient pas souverainement imprudentes. Nous savions gré à messieurs Lamartine, Marie, Garnier-Pagès de lutter pied à pied contre messieurs Ledru-Rollin et Louis Blanc. »[17]
Les droites s’appuient sur une idéologie conservatrice articulée autour de trois axes. « [Leur] credo tient dans la triade des principes adoptée par le comité de l’union électorale créée par la réunion de la rue de Poitiers avant les élections de 1849 : « ordre, propriété, religion. » »[18] L’ordre est une préoccupation constante comme en témoigne la lettre d’un député légitimiste breton de base, élu dans les Côtes-du-Nord, Paul de Dieuleveult, en juin 1849 :
« Nous sommes d’accord sur les questions vitales, nous ne voyons maintenant qu’une lutte entre l’ordre et le désordre et tous se prononcent énergiquement pour sauvegarder la société. La majorité, l’immense majorité de la Chambre se déclare contre les anarchistes et, si tu voyais l’ensemble avec lequel elle vote par assis ou levé, tu en serais étonné : il n’y a jamais la moindre hésitation, nos deux camps sont bien distincts. »[19]
Ses collègues sont dans un état d’esprit identique. Le 5 avril 1851, le comte de Rességuier, député des Basses-Pyrénées, demande de prendre en considération la proposition de Desmousseaux de Givré selon laquelle « une pétition apportée aux abords de l’assemblée par un rassemblement ne pourra être reçue ni déposée sur le bureau ». Il veut empêcher que des attroupements apparaissent et menacent les parlementaires comme ce fut le cas les 15 mai 1848 et 13 juin 1849 qui « ont commencé l’un et l’autre par une pétition qu’il s’agissait de porter à l’Assemblée nationale » :
« Plus qu’en aucune autre circonstance, il importe donc de prévenir les manifestations, même pacifiques, qui pourraient essayer de donner le change sur l’opinion publique véritable, en même temps qu’elles porteraient une atteinte plus ou moins grave à l’autorité des importantes déterminations que nous aurons à prendre. »[20]
Page 4
Le rôle social de la religion constitue le deuxième pilier de la politique désirée par le parti de l’Ordre. « Par défense de la religion, il faut entendre celle du rôle social de l’Église catholique considérée comme un rempart de l’ordre »[21]. Paul de Dieuleveult ne fait pas preuve d’une foi catholique débordante. Mais son attachement à la fonction de pilier social conservateur de l’Église transparaît à travers ses propos. Selon lui, la religion doit encadrer la société afin d’empêcher la propagation d’idéologies dangereuses pour le maintien de l’ordre. « Cet attachement passionné à une religion intransigeante accompagne la conviction qu’elle doit imprégner toute la vie sociale et politique de la nation pour permettre une régénération en profondeur de celle-ci et garantir la stabilité des institutions »[22]. Le député légitimiste dénonce les méfaits occasionnés par l’enseignement des instituteurs publics, « si détestables et qui font un mal si horrible »[23]. Il privilégie le vote de la loi Falloux, plus générale, qui favorise le principe de la liberté d’enseignement.
La troisième grande orientation idéologique concerne la défense du droit de propriété. les lettres de Paul de Dieuleveult témoignent d’une aversion telle pour les Montagnards qu’il semble les assimiler à des criminels. Il perçoit en eux de perpétuels fauteurs de troubles qui risquent de remettre en cause le droit le plus élémentaire de la propriété et n’ont rien de commun avec lui. Il dénonce leur démagogie, leurs « cris ou plutôt [leurs] rugissements » et ajoute qu’« il faut en être témoin pour le comprendre »[24]. La missive qu’il expédie à son frère quelques jours plus tard est du même acabit. Il condamne le comportement des députés de la gauche qui n’agissent pas, à ses yeux, comme des honnêtes gens :
« Chacun sent le besoin de rendre nos discussion dignes, elles sont à chaque instant réellement scandaleuses, aussi a-t-on fait des propositions de changements au règlement : une commission a été nommée et elle s’en occupe : sous la première constituante, il y avait des peines contre les interrupteurs et les tapageurs, on envoyait même à l’abbaye les plus violents, je ne crois pas qu’on puisse rétablir ces pénalités, mais j’espère qu’on fera quelque chose pour arrêter ce dévergondage infâme. »[25]
Répression et réaction parlementaires sous la Constituante
À l’instar de leurs collègues du parti de l’Ordre, les 59 représentants légitimistes, élus à la Constituante en avril 1848, participent à la dissolution des ateliers nationaux. En tant que rapporteur dans le comité des travailleurs sur les ateliers nationaux, le comte de Falloux intervient dans l’hémicycle, le 23 juin, pour soutenir le projet de décret final de dissolution. Il rappelle brièvement le caractère néfaste des ateliers nationaux, qualifiés d’« expédients transitoires et précipités », et demande leur dissolution. Il les accuse, de nouveau, d’être à l’origine du malaise social dans le pays car « ce [que l’ouvrier] considérait comme son refuge était l’un des motifs principaux de sa détresse » « et que la première des conditions pour le retour de son bien-être était la dispersion radicale de ce foyer actif, concentré, d’agitation stérile. »[26]
Les légitimistes comme les conservateurs jouent un rôle actif dans la commission d’enquête sur les journées révolutionnaires de juin 1848 aux motifs plus politiques qu’économiques[27]. Le baron de Larcy, élu dans le Gard, affirme devant ses collègues que les « dispositions judiciaires », accumulées contre Louis Blanc et Louis Caussidière, sont bien plus accablantes, contiennent « quelque chose de plus grave, au moins de plus précis et de plus certain »[28], que les accusations exprimées par des hommes de gauche comme Ledru-Rollin d’un soutien légitimiste à ces soulèvements.
Ils œuvrent aussi à l’élaboration et au vote des lois répressives qui s’abattent sur les acteurs d’une République démocratique et sociale. Le 21 mars 1849, 53 légitimistes votent en faveur de l’article premier du projet de loi sur les clubs adopté par 404 voix contre 303. Quelques légitimistes se sont distingués pendant la discussion pour appuyer la dimension répressive. Le 19 mars, Vincent de Kerdrel, député de l’Ille-et-Vilaine, se prononce clairement en faveur d’une loi qui répond aux « commotions politiques »[29]. L’orateur légitimiste continue en faisant ressortir tous les dangers qu’ont occasionnés les clubs depuis la révolution de février 1848 et dénonce les pressions qui s’exercent sur les ouvriers pour les contraindre à s’y rendre sous peine d’être renvoyés de l’atelier. Le lendemain, il reprend la parole pour confirmer ses propos de la veille. Il reproche aux clubs, « tous subversifs », d’exercer une influence nocive : « L’ouvrier qui fréquente les clubs déserte le travail et le foyer, les idées et les devoirs de la famille en sont affaiblis. »
Dans les derniers temps de la Constituante les tensions avec la gauche sont très vives. Fin mai, le comte de Falloux domine les controverses avec ses adversaires politiques. Le 24, il rejette sur son contradicteur, Ulysse Trélat, la responsabilité de la dissolution des ateliers nationaux et repousse le qualificatif d’ « implacable » dont il est affublé :
« L’incurie devrait se montrer plus modeste devant le mal qu’elle a fait ; et s’il n’appartient à personne d’éveiller ainsi les passions et d’appeler les représailles, cela doit encore moins appartenir à la rancune et à l’inertie de monsieur Trélat. (…) Oui, c’est votre chimère, criminelle malgré vous, qui a fait verser ce sang. »[30]
Plusieurs fois interrompu, il conclut sur un rejet des fauteurs de troubles, « des hommes qui sont capables de tout », mais aussi de ceux qui n’ont aucune expérience et « ne sont capables de rien ».
Page 5
Répression et réaction parlementaires sous la Législative
Dans l’Assemblée législative élue en mai 1849, en raison des résultats électoraux favorables à la droite, le groupe parlementaire légitimiste est plus étoffé que sous la Constituante. Cent-trente-trois députés affichent clairement des convictions favorables à la branche aînée des Bourbons. Ils poursuivent l’action répressive et réactionnaire menée à l’encontre de la gauche. Confiants dans leur capacité à détruire les fondements d’une République démocratique et sociale, ils manifestent un antagonisme exacerbé contre leurs rivaux.
Les débats parlementaires initiaux sont particulièrement tendus. La séance du 29 mai augure ainsi de conflits futurs pour Paul de Dieuleveult: « La séance se continue tranquillement après un petit orage relatif à la non reproclamation (sic) hier de la République, on s’est levé et le cri a été poussé après des réflexions faites par un membre dont je ne sais pas le nom.»[31] Durant la séance, une soixantaine de représentants siégeant à gauche se lèvent et crient « Vive la République démocratique et sociale ! »[32].
Les députés légitimistes prennent toute leur place dans la répression violente qui se met en place à l’été 1849 après l’échec du rassemblement parisien du 13 juin. Le soulagement est de mise pour Paul de Dieuleveult, qui peut rassurer sa famille et Olympe, son épouse. Désormais, « tout est calme et tranquille » parce que les Montagnards « sont en fuite sur tous les points »[33] et que leur « déconfiture » est totale. La défaite de la gauche parlementaire paraît irrémédiable. Son personnage de premier plan, Ledru-Rollin, symbolise une telle déroute. En ce 16 juin 1849, à l’Assemblée législative, « le bruit court que Ledru-Rollin s’est échappé et qu’il s’est embarqué au Havre » mais que, « comme il était inviolable, on ne pouvait l’arrêter »[34]. Néanmoins, l’impact psychologique de ces troubles parisiens, ajouté à la poursuite de l’agitation en province, à Lyon notamment, qui atteste de « la vitalité républicaine autonome »[35] hors de la capitale, a pour résultat l’affirmation d’une forte volonté répressive chez l’ensemble des députés conservateurs.
Paul de Dieuleveult adhère pleinement aux mesures prises à la fin de la séance du 15 juin et à l’état d’esprit de l’ensemble des parlementaires. Ce jour-là, à quatre heures et demie, l’unanimité des députés autorise les poursuites contre les 34 signataires du manifeste du 13 juin générateur de la manifestation : l’urgence est mise aux voix puis adoptée sans problème[36]. Paul de Dieuleveult se félicite de l’homogénéité dont font preuve les conservateurs et semble soulagé de la victoire des droites :
« On vient à l’instant de nous demander encore d’accorder l’autorisation de poursuivre plusieurs nouveaux membres compromis, et nous sortons de nos bureaux où nous avons nommé une commission chargée de faire un rapport à l’assemblée. Elle sera accordée par l’immense majorité de la Chambre et, même les membres décimés de la Montagne ne se lèvent plus à la contre-épreuve. Ils ne votent pas, seulement pour la mise en accusation. »[37]
Paul de Dieuleveult et ses amis politiques poursuivent leur œuvre de « répression »[38] au cours des séances suivantes. Ils votent, le 19 juin 1849, la suspension de la liberté de la presse en cas d’état de siège par 351 voix contre seulement 154.
Le 30 juin, les demandes en autorisation de poursuites à l’encontre des Montagnards Martin Bernard, Charles Gambon, James Demontry et Jacques Brives, sont acceptées à une très large majorité, Paul de Dieuleveult votant pour à chaque reprise. Il écrit à son frère que l’ensemble des députés « est trop occupé de la discussion hier sur l’autorisation de la mise en accusation des quatre membres de la Montagne. On se passionne sur cette affaire »[39]. Si les parlementaires légitimistes se montrent assez discrets durant la discussion, Vincent de Kerdrel, en tant que rapporteur de commission, y participe pleinement, les 29 et 30 juin. Le 29, il demande une autorisation de poursuites, parce que des « indices graves »[40] permettent de supposer que les députés montagnards concernés appartiennent à une société secrète, la Solidarité républicaine, et ont participé aux manifestations du 13 juin.
Fin juillet, la discussion de la loi sur la presse s’inscrit dans cette logique répressive. Par exemple, le 27, l’article quinze discuté, Louis Favreau, légitimiste de la Loire-Inférieure, demande une sévérité accrue, c’est-à-dire une suspension immédiate, en cas de récidive, avant de retirer sa proposition. Au final, les légitimistes se joignent à une majorité de leurs collègues pour voter l’ensemble de ce projet (400 voix contre 146).
Page 6
[31] Lettre de Paul de Dieuleveult n°1, mardi 29 mai 1849
[32] Le Moniteur, mercredi 30 mai 1849, compte rendu de la séance du 29
[33] Lettre de Paul de Dieuleveult n°4, vendredi 15 juin 1849
[34] Lettre de Paul de Dieuleveult n°5, samedi 16 juin 1849
[35] Inès MURAT, La deuxième république, 1848-1851, Paris, Fayard, 1987, p. 412
Le 7 août, 428 voix contre 176 acceptent l’ordre du jour pur et simple et soutiennent la restauration du pouvoir papal à Rome. Ce jour-là, le comte de Falloux est en première ligne pour répondre aux accusations dont il est l’objet, en particulier de la part de Jules Favre. Le ministre légitimiste lui répond dans un climat d’agitation extrême, marqué par de très nombreuses interruptions, et suscite l’adhésion expressive de la droite. Il termine par une analyse de la culture politique de gauche, axée sur la « lutte surhumaine contre les traditions et le caractère des pays qui nous entourent, contre les mœurs et les traditions qui vivent dans notre propre pays, cette lutte contre les lois mêmes de la nature », et par son opposition à celle-ci « parce que c’est la ruine de tous ceux qui la rêvent et qui l’entreprennent »[41].
La dernière séance qui précède les vacances parlementaires, le 11 août 1849, symbolise le très net clivage entre la gauche et la droite, élément incontournable de ces trois premiers mois de débats parlementaires. Les réactions antagonistes, suscitées des deux côtés de l’hémicycle à la suite de la proclamation de l’ajournement de l’assemblée sont révélatrices : un certain nombre des députés de l’extrême gauche crient avec force « vive la République ! », alors qu’une voix de droite leur répond « pas la vôtre, surtout ! »[42]
À la rentrée parlementaire, Paul de Dieuleveult et ses amis mettent toujours en avant la défense de la société contre l’anarchie et la cause défendue par « les amis de l’ordre »[43], ce qui continue d’alimenter les tensions avec la gauche. Le 21 novembre, la demande faite par le comte Ségur d’Aguesseau, légitimiste élu dans les Hautes-Pyrénées, en faveur de secours « distribués aux braves gardes municipaux, à leurs veuves, à leurs enfants, aux familles de ces braves militaires, les seuls, (…) dignes de l’intérêt national, comme étant morts ou ayant été frappés pour la défense des institutions et des lois », provoque un incident. La gauche s’oppose avec force à cette initiative et dénonce les « deux poids deux mesures »[44].
Les légitimistes à l’intérieur de la majorité parlementaire poursuivent la mise en place de mesures structurelles, qui favorisent une réaction de grande ampleur jusqu’au milieu de l’année 1850. La loi sur l’enseignement, ainsi que la série de lois restrictives sur le jury, la presse, le cautionnement ou encore le timbre, et sur le sort des prisonniers arrêtés au moment des mouvements populaires, emportent l’adhésion de l’ensemble des droites coalisées.
Pour des députés légitimistes attachés au rétablissement de l’ordre social à partir des piliers sociaux traditionnels comme la religion, la promulgation de la loi sur l’enseignement ou loi Falloux représente l’un des actes législatifs les plus attendus du mandat parlementaire. Le 15 mars 1850, l’adoption d’une grande loi conservatrice sur l’enseignement qui vise à transformer en profondeur le système français en faveur d’un contrôle accru des institutions religieuses soulage les parlementaires légitimistes. Paul de Dieuleveult n’éprouve pas de doute quant au résultat du scrutin car, écrit-il, la loi étant bien en adéquation avec l’état d’esprit des membres du parti de l’Ordre, « elle sera adoptée à une forte majorité »[45]. Le texte recueille en effet 399 voix contre 237. Instaurant la liberté d’enseignement en France, cette loi s’intègre pleinement dans l’esprit réactionnaire de la première moitié de 1850. C’est la « nouvelle alliance du trône et de l’autel »[46]. L’instituteur est désormais soumis à l’autorité du maire et du curé et peut être choisi soit parmi les laïcs, soit parmi les membres des confédérations religieuses. Dans l’enseignement secondaire, les exigences quant à la qualification des professeurs de l’enseignement libre sont minimisées, ceux-ci pouvant provenir de congrégations religieuses non reconnues par l’État. Enfin, des mesures d’épuration sont prises dans l’enseignement supérieur afin d’éliminer les universitaires jugés trop républicains. L’application de la loi devrait permettre, aux yeux des légitimistes et des conservateurs, de lutter contre la progression constatée de l’esprit républicain chez les jeunes. Elle ouvre l’ère « des deux jeunesses », favorise une « division philosophique profonde » et contribue à « la revanche sur les Lumières ». « Lancée pour effacer 1848, elle en arrivait à contester 1789. »[47]
Page 7
Les légitimistes votent favorablement, le 5, sur la question de savoir si l’assemblée passera à une seconde délibération du projet de loi sur la déportation, qui est acceptée par 431 voix contre 217. Lors de cette séance, Victor Hugo s’écarte définitivement du camp conservateur. Son intervention attire sur lui les foudres de la droite. À l’instar de ses amis politiques, Paul de Dieuleveult témoigne de l’ironie à son encontre. Le jour même, il rédige ceci à l’intention de son frère : « Je ne puis continuer tant il y a de tumulte : Victor Hugo descend de la tribune. Il a parlé contre la loi de déportation : je te renvoie au journal de demain si tu as la curiosité de lire un tissu d’antithèses. »[48] La loi est définitivement adoptée le 8 juin et s’applique aux condamnés pour crime politique, qui doivent accomplir leur peine sur les îles Marquises dans le Pacifique.
Le 31 mai, il apporte sa voix, avec 432 de ses collègues et 106 autres légitimistes, à l’ensemble du projet de loi concernant la révision de la loi électorale du 15 mars 1849, seulement refusée par 241 députés. Cette loi électorale constitue l’apogée de la politique réactionnaire de l’assemblée. Elle institue un suffrage restreint, interdit pour les individus qui résident depuis moins de trois ans dans la commune d’inscription, pour ceux qui ne sont pas inscrits au registre des impôts ou ont été l’objet de condamnations même infimes.
Les derniers temps de la session parlementaire sont dominés par le débat sur l’augmentation du cautionnement des journaux et le timbre des écrits périodiques ou non, qui vise « la presse pauvre » dont la vie est rendue très difficile. Les députés légitimistes, qui aspirent globalement à la répression, y adhèrent. Le 16 juillet, l’ensemble est nettement adopté par 386 voix (dont 95 légitimistes) contre 256.
Malgré leur position de force au début de la Seconde République, les légitimistes subissent un échec politique qui les condamne à un effacement politique. Ils sont victimes des fragilités de la coalition des droites parlementaires et des tensions internes au sein de leur propre mouvement. La lutte sans merci qu’ils engagent contre les autres forces de droite est une impasse qui se concrétise par le coup d’État du 2 décembre 1851, véritable coup de grâce pour eux. L’après 2 décembre marque leur débandade à cause de leur impossibilité à surmonter les divisions et à établir une stratégie claire.
Ils ont œuvré au sein d’un parti de l’Ordre conservateur, sous l’Assemblée constituante comme sous l’Assemblée législative, à la mise en œuvre d’une République modérée, faute de mieux. Cette « République instituée » repose sur une Constitution, des élections au suffrage universel, une conception exclusive de la représentation qui refuse de permettre aux journaux et aux clubs de jouer un rôle politique.
Pour autant, les tenants d’une République démocratique et sociale n’abandonnent pas le combat. Des projets ouvriers d’émancipation des travailleurs en dehors de l’État continuent à voir le jour sous la Seconde République. L’Union des associations, créée en octobre 1849, vise à s’organiser sur une base corporative et à structurer l’ensemble de la vie économique. Elle est finalement dissoute en 1850. La culture corporative survit au Second Empire et ressurgit au moment de la Commune en 1871 avec la création de la Commission du travail et de l’échange. Les mouvements sociaux, qui s’expriment après 1870 sous les différentes Républiques, démontrent que les tensions entre République conservatrice et République démocratique et sociale n’ont pas disparu.
[1] David STEFANELLY, Affirmation puis effacement du mouvement légitimiste sous la Seconde République à partir de la correspondance de Paul de Dieuleveult, ANRT, 2013, 562 pages
[2] Samuel HAYAT, 1848, quand la République était révolutionnaire. Citoyenneté et représentation, Seuil, 2014, 405 pages ; Marie-Hélène BAYLAC, La peur du peuple. Histoire de la II e République 1848-1852, Perrin, 2022, 424 pages
[3] Claude NICOLET, L’Idée républicaine en France (1789-1924), Essai d’histoire critique, Paris, Gallimard, 1982, 668 pages
[4] Christine GUIONNET, L’apprentissage de la politique moderne : les élections municipales sous la monarchie de Juillet, Paris, L’Harmattan, 1997, p. 138
[5] Charles BERANGER, Pétition d’un prolétaire à la Chambre des députés (extrait du Globe du 3 février 1831), Paris, Bureau de l’Organisateur, 1831, p.4
[6] Le Moniteur universel, n°138, 17 mai 1840, p. 1080-1081
[7] Samuel HAYAT, « La représentation inclusive », Raisons politiques, n°50, 2013, p. 115-135
[8] Louis HINCKER, Citoyens-combattants à Paris, 1848-1851, Villeneuve-d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2007
[9] L’Ami du peuple, n° 2, 28 février 1848
[10] Karl MARX, Les luttes de classes en France, Paris, Gallimard, 2007 [1850], p. 20
[11] L’Ami du peuple, n°6, 23 mars 1848
[12] Le Populaire, n°7, 17 mars 1848, p. 2-3
[13] Bulletin de la République, n°15, 13 avril 1848
[14] Actes du Gouvernement provisoire, p. 148-149
[15] Actes du Gouvernement provisoire, p. 281
[16] Compte-rendu des séances de l’Assemblée nationale, t. 1, p. 190
[17] Alfred DE FALLOUX, Mémoires d’un royaliste, Paris, Perrin et Cie, 1888, p. 314
[18] Jean-François SIRINELLI, Les droites françaises – de la Révolution à nos jours –, Gallimard, Folio Histoire, 1995, p. 189
[19] Lettre de Paul de Dieuleveult n°3, lundi 11 juin 1849
[20] Albert DE RESSÉGUIER, « rapport fait, au nom de la dix-huitième commission d’initiative parlementaire, sur la proposition de monsieur Desmousseaux de Givré, tendant à mettre en harmonie le règlement de l’assemblée et les lois contre les attroupements. Séance du 5 avril 1851 », Assemblée nationale législative. Impressions. 1851, tome 26, n° 1827, BNF
[21] Jean-François SIRINELLI, Les droites françaises …, op. cit., pp. 191-192
[22] Pierre LÉVÊQUE, Histoire des forces politiques en France 1789-1880, tome 1, Paris, A. Colin, 1992, p. 164
[23] Lettre de Paul de Dieuleveult n°16, dimanche 16 décembre 1849
[24] Lettre de Paul de Dieuleveult n°2, mercredi 6 juin 1849
[25] Lettre de Paul de Dieuleveult n°3, lundi 11 juin 1849
[26] Alfred DE FALLOUX, « rapport fait, au nom du comité des travailleurs sur les ateliers nationaux. Séance du 23 juin 1848 », Assemblée constituante. 1848-1849. Impressions, tome 2, n° 114, BNF
[27] Sylvie APRILE, 1815-1870. La Révolution inachevée, Paris, Belin, 2010, p. 318
[28] Le Moniteur, dimanche 27 août 1848, compte rendu de la séance du 26
[29] Le Moniteur, mardi 20 mars 1849, compte rendu de la séance du 19
[30] Le Moniteur, vendredi 25 mai 1849, compte rendu de la séance du 24 ; comte Alfred DE FALLOUX, « discours de monsieur de Falloux, ministre de l’Instruction publique, sur la situation du pays et sur les ateliers nationaux, à la séance de l’Assemblée nationale du 24 mai 1849 », Assemblée constituante de 1848. Détails, BNF
[31] Lettre de Paul de Dieuleveult n°1, mardi 29 mai 1849
[32] Le Moniteur, mercredi 30 mai 1849, compte rendu de la séance du 29
[33] Lettre de Paul de Dieuleveult n°4, vendredi 15 juin 1849
[34] Lettre de Paul de Dieuleveult n°5, samedi 16 juin 1849
[35] Inès MURAT, La deuxième république, 1848-1851, Paris, Fayard, 1987, p. 412
[36] Le Moniteur, samedi 16 juin 1849, compte rendu de la séance du 15
[37] Lettre de Paul de Dieuleveult n°4, vendredi 15 juin 1849
[38] Maurice AGULHON, 1848 ou l’apprentissage de la République (1848-1852), Paris, Nouvelle histoire de la France contemporaine, Seuil, 1992, p. 160
[39] Lettre de Paul de Dieuleveult n°7, lundi 30 juin 1849
[40] Le Moniteur, samedi 30 juin 1849, compte rendu de la séance du 29
[41] Comte Alfred DE FALLOUX, « discours de monsieur de Falloux ministre de l’Instruction publique sur les affaires de Rome. Séance du 7 août 1849 », Comité pour la défense de la liberté religieuse, BNF
[42] Le Moniteur, dimanche 12 août 1849, compte rendu de la séance du 11
[43] Lettre de Paul de Dieuleveult n°15, mercredi 12 décembre 1849
[44] Le Moniteur, jeudi 22 novembre 1849, compte rendu de la séance du 21
[45] Lettre de Paul de Dieuleveult n°28, vendredi 15 mars 1850
[46] Philippe VIGIER, La Seconde République, Paris, PUF, collection Que sais-je ?, 2001, pp. 101-107
[47] Maurice AGULHON, 1848 ou …, op. cit., pp. 165-166
[48] Lettre de Paul de Dieuleveult n°34, vendredi 5 avril 1850
D'autres articles

La Loi Toubon et la Loi 101 de la philosophie au droit : la France et le Québec entre républicanisme et libéralisme
Comme les travaux menés par Joseph-G. Turi à la fin des années 1980 l’ont démontré, les législations linguistiques québécoise et française visaient toutes deux la consécration d’une seule langue officielle, mais avaient fait l’objet d’interprétations plutôt favorables à une langue autre[2]. Depuis…

Pasquale Paoli et sa documentation sur les régimes mixtes de l’Antiquité
Qu’est-ce que les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle ont cherché dans la documentation antique à propos des régimes mixtes et, surtout, qu’y ont-ils trouvé ? C’est une question que l’on abordera en la circonscrivant à des limites raisonnables, c’est-à-dire à un personnage, Pasquale Paoli, et à sa…

Échanges avec Vincent Peillon
Jean-Guy TALAMONI
Merci, Vincent Peillon, pour cette conférence qui ouvre des pistes et présente des idées nouvelles, à plusieurs titres. Il serait intéressant qu’il y ait un échange avec les collègues qui sont présents à ce colloque. D’autant que…