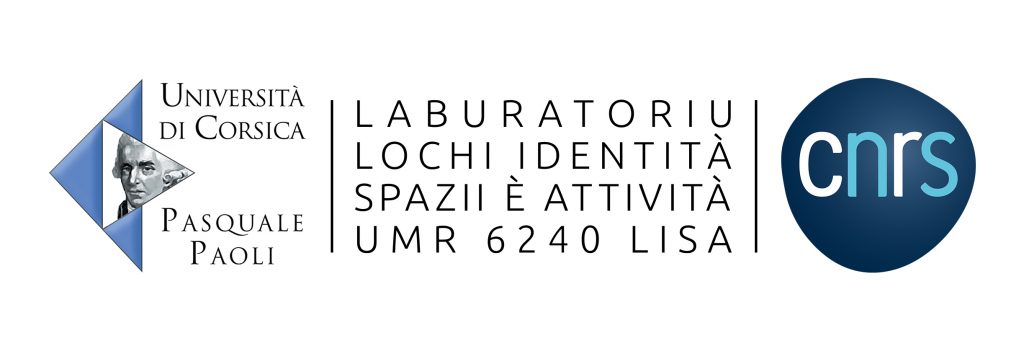Le Sindacato, une institution républicaine.La Constitution corse de 1755 et la question de la reddition de comptes des gouvernants.[1]
Pierre-Antoine Tomasi
« Nul emploi dans la république n’est exempt de reddition de comptes », Eschine, Contre Ctésiphon.
« Non conviene alla Corsica altra forma di Governo che repubblicano. La nostra Repubblica era già bella e stabbilità », Lettre d’Antonio Rivarola à Mathieu Buttafoco, 9 septembre 1768.
Le 18 novembre 1755, l’adoption d’une Constitution par la diète générale du peuple corse (la dieta generale del popolo corso) marque un moment précurseur dans l’émergence du constitutionnalisme moderne[1]. Quoique beaucoup reste encore à accomplir eu égard à la connaissance et à la promotion de l’œuvre constitutionnelle de Pasquale Paoli[2], le chef de l’État corse indépendant (1755-1769), un nombre croissant de travaux universitaires a permis, ces dernières années, de mettre en lumière l’étonnante modernité du texte de 1755 et de ses actualisations postérieures comme de ses influences antérieures[3]. À cet égard, son préambule se présente tout singulièrement comme un « concentré d’innovations[4] » au sens où il proclame, en l’espace de quelques lignes, des principes aussi fondamentaux que la souveraineté populaire, le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, affirme pour la première fois l’existence d’un droit au bonheur et consacre le concept de Constitution dans son acception moderne comme la norme fondamentale à laquelle l’ensemble des pouvoirs constitués sont soumis. À cela s’ajoute l’organisation précoce d’une balance des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et une assemblée législative, élue au sein des différentes communautés de l’île et régulièrement convoquée.
Au mitan du XVIIIe siècle, la nature républicaine de la Constitution paolienne constitue un élément cardinal de son originalité. En effet, l’État corse se présente sous les traits d’une République lato sensu, en ce qu’il a pour socle un corpus de principes reposant sur « le droit et le bien commun[5] ». Mais il s’agit également d’une République stricto sensu, c’est-à-dire un régime politique où les gouvernants, y compris le chef de l’État, sont désignés par le peuple et soumis, en dernière hypothèse, à sa volonté[6] indépendamment de tout principe héréditaire et sans référence à une légitimité transcendantale de nature métaphysique[7].
C’est pourtant un républicanisme tacite qui s’exprimera entre 1755 à 1769 à l’ombre de l’appellation officielle de l’État, demeurée Regno di Corsica. Mais, à l’évidence, ce Royaume est bien « une république qui ne pouvait dire son nom[8] » par effet de distanciation avec la Sérénissime République de Gênes, l’ancien occupant de l’île. Si la thèse d’un évitement purement tactique du terme a pu être discutée[9], elle nous semble accréditée par divers écrits provenant du premier cercle des partisans du régime.
Ainsi, alors que durant les près de quinze années du Généralat, la qualification républicaine du régime est quasi inexistante ou au mieux implicite, au crépuscule de l’État corse, les occurrences se font soudain plus nombreuses. À mesure que le danger de la République de Gênes s’éloigne et que le combat se concentre contre la monarchie française de droit divin, la révélation républicaine devient plus franche. La controverse qui opposa Antonio Rivarola à Mathieu Buttafoco entre août et novembre 1768 en est une illustration[10]. L’échange se concentre, en effet, pour une partie substantielle, sur l’effectivité du caractère républicain de l’État paolien. Pour le premier, celui-ci était déjà une « République belle et établie » (« La nostra Repubblica era già bella e stabilita[11] ») alors que le second, désormais contempteur de Paoli après en avoir été un proche collaborateur, considère que la dimension républicaine du régime ne fut qu’une chimère et prédit que, dans les faits, la « République ne s’établira pas » (« La Repubblica non si stabilirà[12] »). Il est toutefois impossible à Buttafoco de nier, à tout le moins, la vocation républicaine de l’œuvre paolienne alors qu’il est l’auteur d’un mémoire dont l’objet assumé est l’instauration d’une « république mixte[13] » et qui, en lien direct avec Paoli, aura largement alimenté la révision constitutionnelle adoptée par la Cunsulta en 1764[14]. Après le mois de juin 1769, date de l’exil du Général de la Nation et de nombreux partisans, l’affirmation républicaine se manifeste au sein d’écrits officiels. De façon explicite d’abord, dans ce courrier de Clemente Paoli, le frère du Général et chef des exilés en Toscane, adressé à un autre responsable des fuorusciti qui évoque la défense de la « constitution libre et républicaine[15] ». De façon plus allusive, mais difficilement contestable, dans un manifeste publié en 1770 en Toscane où le précepte républicain formulé par Harrington dans son Oceana, et qui sera repris quelques années plus tard par John Adams au moment de la rédaction de la Constitution de l’État du Massachussetts, à savoir « le gouvernement des lois et non des hommes[16] », est utilisé de façon quasi littérale[17].
En réalité, la définition de la République comme étant ce gouvernement des lois figurait déjà, en des termes voisins, dès les premières pages d’un autre manifeste publié, cette fois-ci, au cœur du Généralat : La Corsica ai suoi figli, dont on prête habituellement la paternité à l’abbé Bonfiglio Guelfucci, le secrétaire de Paoli[18]. Usant de nombreuses références au De legibus de Cicéron, l’auteur y exhorte les Corses à défendre leur liberté et « lo stato di Repubblica che voi ora rappresentate[19] », celui-ci reposant sur l’« esprit d’égalité » (« uno spirito di uguaglianza ») mais aussi sur l’obéissance aux lois qui sont « l’anima della Repubblica[20] ».
L’obéissance aux lois tant de la part des gouvernés que des gouvernants eux-mêmes est bien l’une des caractéristiques essentielle du républicanisme. Sous le régime de la Constitution corse de 1755 cet impératif est matérialisé par l’existence d’un organe de contrôle de l’action publique, le Sindacato. Si l’institution revêt un caractère protéiforme, on peut la définir synthétiquement comme un organe de reddition de comptes auquel sont systématiquement soumis tous les gouvernants arrivés en fin de charge et vis-à-vis duquel tout citoyen est susceptible de présenter des plaintes dès lors qu’il considère qu’un magistrat, au sens antique du terme, aurait agi en violation de la loi. Aussi, l’attribution d’un certificat attestant de la gestion vertueuse du magistrat conditionne son accession à de nouvelles charges.
Page 1
[5] Maurizio Viroli, Républicanisme, trad. Christopher Hamel, Editions Le bord…
[6] Ou pour le dire avec les mots de Cicéron dans son De oratore « magistratus…
[7] À cet égard, la Constitution de Paoli correspond parfaitement au processus…
[8] Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, op. cit., p. 35.
[9] Jean-Yves Coppolani, « Le républicanisme de Paoli entre constitutionnalisme…
[10] Sur cet échange passionnant on renverra à : Eugène Gherardi, Casa Rivarola…
[11] Lettre d’Antonio Rivarola à Mathieu Buttafoco, 9 septembre 1768, in…
[12] Lettre de Mathieu Buttafoco à Antonio Rivarola, 23 août 1768, in Lettere di…
[13] Ce manuscrit daté du 16 février 1764, généralement connu sous l’appellation…
[14] Plusieurs éléments adoptés à la Consulta de mai 1764 figurent au…
[15] Lettre de Clemente Paoli à Nicodemo Pasqualini, 2 juillet 1774, traduction…
[16] Constitution du Massachusetts, article 30. John Adams, Thoughts on…
[17] « Nei tempi della libertà non gli uomini ma le leggi governavan la Corsica »…
[18] Nous signalons, à cet égard, la proposition formulée par Erick…
[19] La Corsica ai suoi figli, réed., Bastia, Editions Ollagnier, 1886, p. 33.
L’institution du Sindacato n’est pas propre à la Corse et à la Constitution de 1755. Puisant ses racines dès l’Antiquité, elle est une « pratique courante[21] » sous les Républiques médiévales italiennes et constitue, à ce titre, un « marqueur du républicanisme classique[22] » au sens où elle concrétise ce droit de « participation active et constante au pouvoir collectif » qui, selon Benjamin Constant, caractérise la liberté des Anciens[23]. Néanmoins, entre 1755 et 1769, la pratique constitutionnelle témoigne de l’importance de l’institution du point de vue du droit corse. Le Sindacato apparaît, en effet, comme un invariant du constitutionnalisme paolien. Codifée au sein des textes révolutionnaires et pré-constitutionnels antérieurs à l’accession de Paoli au pouvoir, l’institution est consacrée par la loi fondamentale de 1755. Les comptes-rendus des différentes consulte, les publications des Ragguagli dell’Isola di Corsica, le journal officiel du Royaume, ainsi que la correspondance de Paoli témoignent, pour leur part, de l’effectivité de son action. À tel point que lors de la dernière consulta régulière tenue au mois de mai 1768, lors de laquelle, selon les termes mêmes du Général de la Nation, « on ne parla que de guerre[24] », deux articles de la délibération finale se présentent comme de singulières exceptions puisqu’en dépit des circonstances, ils concernent l’organisation du sindacato[25], selon des modalités exceptionnelles[26].
Par-delà le rôle primordial qui lui fut conféré par les responsables de l’État corse, l’action du Sindacato fut par ailleurs saluée, de façon consensuelle, par de nombreux observateurs, contemporains comme postérieurs. Si l’on ne s’étonnera guère que l’écossais James Boswell, auteur d’un véritable panégyrique de l’État paolien, y voit « une institution excellente[27] », le propos est plus étonnant, et de ce fait certainement plus significatif encore, sous la plume de l’officier français Pommereul. Alors que son Histoire de l’isle de Corse est un réquisitoire très sévère à l’endroit de Pasquale Paoli, celui-ci y décrit le « syndicat » comme « une censure très sage et faite pour retenir les magistrats dans les bornes de leur devoir, et empêcher leur autorité de s’accroître aux dépens de la liberté du peuple[28] ».
Aussi, la disparition de l’institution après 1769, y compris au moment où la Corse recouvre sa souveraineté entre 1793 et 1796, n’en est que plus étonnante. L’extinction des républiques médiévales italiennes qui connaissaient encore ce type de procédures mais aussi le triomphe d’un constitutionnalisme d’essence libérale davantage rétif à l’héritage latin, au sein duquel est profondément ancrée l’institution syndicale, expliquent certainement, pour partie, cette disgrâce.
Ces dernières années, on doit aux travaux universitaires du regretté Doyen Coppolani la mise en valeur de cette institution méconnue. La publication d’une somme d’articles consacrée au sujet ainsi que son enseignement d’Histoire du droit public corse, dispensé à des générations d’étudiants de Licence de l’Università di Corsica Pasquale Paoli, auront permis de faire sortir de l’oubli la pratique du sindicamento. Faisant nôtres les derniers mots de son étude publiée à l’occasion des Mélanges offerts au Pr. François-Paul Blanc[29], il nous semble que la réappropriation du Sindacato ne revêt pas uniquement un enjeu de connaissance historique – ce qui serait déjà beaucoup – mais interroge également des problématiques très actuelles à l’heure où les démocraties occidentales sont entrées dans « l’âge de la défiance[30] ». À cet égard, Pierre Rosanvallon nous rappelle que l’exigence de reddition de comptes des gouvernants, pièce maitresse de l’idéal républicain, se situe également au fondement de l’idéal démocratique. Cet impératif constitue, en effet, l’une des deux facettes du « dualisme démocratique » qui confère au citoyen actif, à la fois, une fonction de désignation des responsables publics mais également un « pouvoir de surveillance » sur ces derniers. Nous invitant à « relire l’histoire de la démocratie[31] », Pierre Rosanvallon rappelle que la fonction de contrôle a même précédé le pouvoir de désignation et suggère, surtout, que l’institutionnalisation du pouvoir de surveillance au sein des systèmes juridiques contemporains pourrait « réaliser le passage à une (nouvelle) étape des démocraties[32] ».
La richesse des questionnements soulevés par l’institution syndicale invite, en conséquence, à prolonger la réflexion sur l’expérience menée par le républicanisme paolien en matière de reddition de comptes des gouvernants. Ce faisant, cette étude se proposera d’examiner, d’abord, les modalités de réception de cette institution venue du républicanisme classique au sein d’un régime relevant du constitutionnalisme moderne (I) avant de mettre en exergue, ensuite, ce qui constitue l’innovation principale du Sindacato de l’ère paolienne, à savoir l’instauration pionnière du principe de responsabilité politique qui deviendra, par la suite, le critère principal de tout régime parlementaire (II). Enfin, l’évocation de la procédure du Sindacato della reggenza mise en œuvre, de nos jours encore, sous l’égide du Collegio garante de la Repubblica di San Marino permettra de réinterroger la postérité, après 1769, des institutions de type syndical en droit constitutionnel (III).
I. La transmutation du sindicamento paolien : du républicanisme classique au constitutionnalisme moderne
Alors que la Constitution de 1755 regorge de novations, la référence à la procédure de sindicamento s’inscrit, pour sa part, dans une logique de continuité. Aussi, à l’instar des principales institutions du régime, le Sindacato figurait déjà en bonne place au sein de la quasi-totalité des textes pré-constitutionnels adoptés depuis le début des révolutions de Corse. Le cinquième capitolo de la Consulta de Caccia, tenue au mois d’avril 1755 quelques semaines seulement avant l’accession de Paoli au Généralat, en offre, par exemple, une codification particulièrement précise.
À cet égard, il a pu être souligné avec justesse par le passé, le caractère incongru et même paradoxal, du maintien en fonction d’une institution génoise alors même que la Consulta révolutionnaire de 1735 avait considéré l’ensemble des lois prises par la Sérénissime comme nulles et non avenues. Par-delà le constat que cette politique de la tabula rasa fut, dans les faits, très relative, le paradoxe n’est peut-être qu’apparent au sens où le Sindacato ne saurait être réduit au seul héritage génois mais constitue, plus largement, une institution républicaine[33].
Page 2
[21] Maurizio Viroli, op.cit., p. 81.
[22] Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, op. cit., p. 56
[23] Benjamin Constant, « De la liberté des anciens comparée à celle…
[24] Propos de Paoli cités par Antoine-Marie Graziani, Pascal Paoli…
[25] Nous réservons l’usage de la majuscule lorsque l’expression…
Ceci étant dit, le propos n’a nullement pour but de minorer l’influence qu’a pu avoir la figure des Supremi Sindacatori Génois[34] à l’égard du constitutionnalisme corse. Par-delà le poids des siècles d’administration génoise, le fait que l’amiral Andrea Doria, le héros du « siècle des génois » eut refusé la fonction de Doge – et donc de chef de l’État – au profit d’une charge de Supremo Sindacatore à vie a, sans doute, contribué à valoriser la puissance potentielle de l’institution. En revanche, l’élargissement de la focale d’un point de vue géographique et historique contribue à consolider la compréhension du cheminement de cet organe depuis l’Antiquité vers le siècle des Lumières. Pour ce faire, il convient, d’effectuer le départ entre la généalogie historique effective de l’institution syndicale et les référentiels « mythiques[35] » qui ont pu également inspirer les responsables politiques de l’époque médiévale et moderne.
Aussi, une filiation directe peut être établie avec la Constitution de l’Empereur Zénon figurant au Code Justinien, publié au VIe siècle de notre ère[36]. Le texte impose, en effet, à l’ensemble des magistrats en fin de charge de demeurer dans leur circonscription afin de soumettre leur conduite au jugement des citoyens, lesquels disposant de « la libre faculté de les attaquer pour vol ou autres crimes[37] ». Il est néanmoins possible de faire remonter la pratique d’une obligation de reddition de comptes des gouvernants arrivés en fin de charge dès l’Antiquité grecque. Le procès de Périclès en constitue, l’un des exemples historiques les mieux connus. À la lecture de l’œuvre d’Eschine Contre Ctésiphon[38], les similitudes avec les dispositions du Code Justinien sont en effet manifestes au sens où cette reddition de comptes des magistrats en fin de charge revêt des critères de systématicité et d’universalité, puisqu’elle concernait quiconque a exercé une parcelle du pouvoir, mais également d’impérativité, au sens où elle faisait interdiction aux magistrats de quitter, pour une période déterminée, les lieux où ils avaient exercé leurs fonctions. Les écrits de Cicéron confirment à la fois l’antériorité de l’expérience grecque mais également son influence à l’égard du républicanisme romain. Au Livre III du De Legibus, celui-ci salue l’existence, à l’époque de la Grèce Antique, de « gardiens des lois », rôle qu’il se propose de confier aux censeurs romains[39].
C’est donc ce mécanisme qui cheminera de l’Antiquité vers les Républiques médiévales italiennes. On retrouve, bien sûr, la figure des sindacatori à Gênes – auxquels Jean Bodin consacre d’ailleurs quelques lignes dans ses Six livres de la République[40] – et à Venise ainsi que dans leurs colonies mais le Sindacato est, par ailleurs, une institution active à Florence, à Bologne, à Lucca, à Raguse[41], à Saint-Marin et jusque dans les cantons helvétiques, comme à Lugano[42]. Institution de tradition républicaine, le Sindacato n’est cependant pas méconnu des régimes monarchiques. Hérité du droit municipal, il figure en bonne place au cœur des « constitutions piémontaises » régissant le Royaume de Sardaigne[43], mais l’institution peut être observée au sein du Grand-duché de Toscane[44], dans le Royaume de Naples[45], dans celui de Sicile[46], ou encore, hors de l’aire italienne, sous l’appellation de purga de taula dans le Principat de Catalunya[47].
Le Sindacato paolien, inscrit dans cette longue tradition, a pu également être pétri de références plus indirectes, tenant davantage de l’invocation du mythe que du continuum juridique. Concernant les Supremi Sindacatori génois, Riccardo Ferrante observe que la littérature politique du XVIIe siècle sur le sujet est parsemée de références aux institutions antiques de l’éphorat spartiate et du tribunat romain[48]. Au XVIIIe siècle, la convocation de ces deux figures est fréquente chez les acteurs des Lumières de Rousseau à Fichte, de Filangieri à Pagano en passant par Montesquieu et Lolme. Sous la Constitution de Paoli, l’influence de l’institution tribunitienne affleure par endroit, sans doute par la médiation de l’œuvre de Machiavel qui, dans ses Discours, assigne aux tribuns de la plèbe la fonction de « gardes de la liberté[49] ». Cette référence aux gardiens se retrouve, en effet, au Mémoire de Vescovato produit par Buttafoco en prévision de la révision constitutionnelle de 1764. Dans le cadre d’un projet – inabouti – de réforme du Sindacato, ce dernier proposait d’instaurer des « gardiens de l’État[50] » empruntant, à cet égard, de façon quasi textuelle, à Machiavel la distinction entre la nécessité de faciliter à tout citoyen l’usage de la faculté d’« accuser » les magistrats et celle de punir avec une grande sévérité les calomniateurs en retour[51]. Pour en terminer sur ce point, on observera que le terme de « conservatori delle leggi » employé pour désigner les sindicatori au sein des procès-verbaux d’élection des représentants à la Consulta par les communautés est identique à celui que Rousseau emploie, à la même époque, dans son Contrat Social, pour désigner le tribunat romain (les « conservateurs des loix[52] »).
La réception de l’institution par le texte de 1755 concrétise sa transmutation du diritto statutario vers une norme constitutionnelle au sens moderne de l’expression et contribue à ériger l’œuvre paolienne en « parangon du constitutionnalisme latin[53] ».
Page 3
[35] Riccardo Ferrante, op. cit., p. 279-308 ou encore, Massimo Galtarossa…
[36] Jean-Yves Coppolani, « Le sindicamento », art. cit., p. 354 ; Isidre Llucià…
[37] Les douze livres du code de l’Empereur Justinien, trad. Pascal-Alexandre…
[38] Eschine, « Harangue d’Eschine contre la couronne » ou « Contre Ctésiphon »…
[39] Cicéron, De legibus, in De la République, des lois, trad., notice et notes…
[40] Jean Bodin, Les six livres de la République, t. II, Lyon, Librairie des Iontes…
[41] Riccardo Ferrante, op. cit., p. 309.
[42] Tableau de la Suisse ou Voyage pittoresque, t. XI, 2e édition…
[43] Leggi e costituzioni di S.M, Turin, Valetta, 1723, p. 177-182
[44] Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, Florence…
[45] Mireille Peytavin, Visite et gouvernement dans le royaume de Naples…
[46] Rosalba Sorice, « Il sindacato in Sicilia nel secolo XVI », in Orazio…
[47] Isidre Llucià i Sabarich, art. cit., p. 151-175.
[48] Riccardo Ferrante, op. cit., p. 294-308.
[49] Nicolas Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live…
[50] Philippe Castellin et Jean-Marie Arrighi, op. cit., p. 70.
[51] Ibid., p. 69 : « Il sera permis à chacun d’accuser un citoyen quelconque…
Au sein du texte constitutionnel de novembre 1755, les dispositions relatives au Sindacato figurent au chapitre consacré à la diète générale, soit au pouvoir législatif. En ce sens, la Consulta s’affirme comme « padrona della legge[54] » dans la double acception du terme. « Padrona » car détentrice du monopole de l’édiction de la loi mais aussi au sens latin de l’expression[55], c’est-à-dire gardienne de sa stricte application par les autorités exécutives. Cependant, à l’exception des hypothèses où la Consulta exerce le sindicamento en séance plénière, la composition du Sindacato paolien se présente comme un organe mixte, composé de quatre membres élus par la Consulta auxquels se joint le Général de la Nation en personne. S’il peut surprendre, ce procédé relevant d’une jonction des pouvoirs n’est pas unique sous le Généralat[56] et s’insère dans un dispositif global d’équilibre des pouvoirs, qui intègre, par ailleurs des logiques de collaboration, mais aussi de séparation stricte voire de confusion desdits pouvoirs. Au fil du temps, la composition effective de l’institution s’avérera beaucoup plus variable conformément à une approche évolutive de la Constitution dans l’attente d’arrêter une forme « fixe et durable ». Ainsi, le nombre de sindacatori désignés par la Consulta peut être tantôt supérieur, tantôt inférieur au nombre prévu par le texte de 1755[57], dans certains cas, la Consulta délègue la composition du Sindacato à l’exécutif[58], enfin, dans la pratique, le Général ne prend pas systématiquement part au sindicamento.
Nonobstant le caractère relativement elliptique des dispositions consacrées à l’institution, la Constitution de 1755, consacre en revanche clairement le principe fondamental de la reddition de comptes annuelle des gouvernants en disposant que : « ogni macistrato ed ufficiale della Nazione sarà tenuto dar conto della sua condotta ». Cette procédure n’épargne nullement le chef de l’État qui est responsable de ses actes directement devant les représentants de la Nation. En revanche, des incertitudes demeurent quant aux modalités de contrôle des membres du gouvernement : le Supremo Consiglio di Stato. À notre connaissance, il n’existe aucune archive connue d’une procédure de sindicamento à leur encontre. Une telle lacune a pu conduire Dorothy Carrington à envisager leur exemption de l’obligation générale de reddition des comptes. Cependant, le texte de la Consulta de 1764 ne laisse guère de place au doute quant à leur soumission au dispositif[59]. Il y est expressément prévu que les conseillers d’État ne pourront être réélus à cette charge qu’après avoir obtenu de la part des « Supremi Sindicatori » les « credenziali[60] » attestant de la conformité de leur gestion au regard des lois. Établi en droit, le sindicamento des conseillers d’État fut-il mis en pratique en fait avant la fin de l’expérience constitutionnelle paolienne ? En l’absence de compte-rendu officiel, les mémoires de Bonfiglio Guelfucci, le secrétaire de Paoli, apparaissent comme la source primaire la plus fiable à cet égard. Or, contrairement à ce que laisserait supposer la lecture littérale du texte de la Constitution de 1755[61], l’abbé Guelfucci rapporte que les conseillers d’État étaient soumis au même régime de sindicamento que le Général devant la « suprema general consulta[62] ».
Par-delà la lettre de la Constitution, le sindicamento correspond à une pratique constitutionnelle féconde. À cet égard, l’examen des pièces relatives au sindicamento conservées aux Archives de Corse à Bastia ainsi que la correspondance de Paoli semblent indiquer que l’action du Sindacato a été prioritairement dirigée vers le contrôle des agents de l’administration locale composant le Magistrato des différentes provinces. Une telle attention peut se concevoir doublement par la volonté de conserver, d’une part, l’unité et la fidélité des différentes régions qui fut obtenue progressivement et non sans mal et de veiller, d’autre part, à l’impartialité de ces agents dans l’exercice de leurs prérogatives judiciaires alors que la corruption des juges a constitué l’un des principaux griefs adressés à l’administration génoise par les révolutionnaires corses. D’ailleurs, une part prépondérante des plaintes adressées par les citoyens visent des décisions judiciaires émanant du Magistrato. La certification des comptes publics, qui constitue un aspect traditionnel du sindicamento, occupe également une part substantielle de l’action des sindicatori. Enfin, l’examen de la légalité des actes administratifs n’est pas méconnu par l’institution. Ainsi, en témoigne le contrôle effectué dans la Province de la Rocca – particulièrement bien documenté d’un point de vue archivistique – à l’occasion duquel les syndicateurs furent amenés à constater des négligences ayant trait à l’action administrative et relevant, en l’espèce, du mauvais entretien des routes ou du défaut d’informations transmises au gouvernement central quant à la situation locale[63].
Si les textes constitutionnels sont taisants quant au déroulement de la procédure et des prérogatives conférées aux syndicateurs, les lettres et circulaires émanant du Général et du Conseil d’État permettent de mieux en percevoir la réalité. Dans le cadre de leur action de contrôle, les sindicatori disposent de pouvoirs d’investigation étendus afin d’apprécier directement la gestion des administrateurs locaux, en réquisitionnant, au besoin, l’ensemble des documents nécessaires à leur mission. À la suite de quoi, les sindacatori disposent à la fois d’un pouvoir de sanction à l’égard des responsables publics reconnus coupables d’avoir transgressé les lois et d’une faculté d’annulation ou de réformation de leurs actes. Cependant l’institution veille, dans le même temps, à garantir à l’ensemble des citoyens un rôle actif dans la reddition de comptes des gouvernants, tant par son caractère itinérant que par l’assurance donnée à chacun de pouvoir exercer son droit de plainte[64].
La nature du contrôle a trait, pour sa part, au respect de la légalité par les magistrats « auxquels revient seulement l’exécution des lois et non la faculté de les faire ou de les mépriser[65] » (« che a loro compete solamente l’esecuzione delle leggi, e non la facoltà di formarle e trascurarle »). Pour ce faire, le Sindacato est juge de l’action mais aussi de l’omission ou, pour le dire avec les mots des antiques statuts de la République de Saint-Marin, « del fatto e del non fatto[66] ». Aussi, dans l’affaire du sindicamento de la Province de la Rocca, la non application des instructions provenant du gouvernement central donne lieu à la création d’une Giunta di esecuzione chargée de pallier les carences dûment constatées[67]. Cette forme de recours en manquement atteste d’une volonté de garantir la primauté de l’organe législatif, en tant qu’expression de la souveraineté, face aux organes exécutifs. Elle répond ainsi à une problématique d’une grande modernité relative aux moyens à la disposition des parlementaires afin de mettre un terme à l’inertie gouvernementale[68] et plus largement d’assurer le respect de la volonté générale par l’organe exécutif.
En outre, l’une des principales prérogatives du Sindacato réside dans son pouvoir de sanction des responsables publics. Celle-ci peut aller d’une simple remontrance à l’interdiction d’exercer de nouvelles charges[69]. À l’inverse, et afin de préserver les fonctions publiques de dénonciations malveillantes, les sindacatori peuvent également condamner les accusateurs lorsque ceux-ci se rendent coupables de calomnie[70].
La constitutionnalisation de ce procédé de limitation du pouvoir des gouvernants d’inspiration romaniste et caractéristique du républicanisme classique relève déjà d’une démarche singulière qui confère à la Constitution de 1755 « un supplément de latinité spécifique[71] ». L’articulation de ce mécanisme avec des techniques assimilables au parlementarisme moderne vient renforcer l’originalité du constitutionnalisme paolien.
Page 4
[59] Consulta de mai 1764, article 10 : « I consiglieri di Stato (…) non possano…
[60] Pommereul utilise à cet égard l’expression de « certificat de bonne…
[61] Celui-ci soumet le Général de la Nation au jugement de la dieta generale et…
[62] Bonfiglio Guelfucci, Memorio per servire alla storia delle Rivoluzioni di…
[64] Circulaire du Generale ed il Supremo Consiglio di Stato, 9 février 1764…
[65] Compte-rendu de la Consulta du 26 décembre 1763 in ibid., p. 208-209.
[66] Leges statutae Santi Marini, Livre I., chapitre XIX.
[67] Lettere di Pasquale de’Paoli, op. cit., p. 232.
[68] On observera à ce sujet, qu’en Italie, l’inertie réglementaire du gouvernement…
[69] Pour un exemple de sanctions prononcées à l’issue d’un sindicamento…
[70] Ibid., p. 204 : « avvertiamo però che i ricorsi e reclami che saranno…
II. L’innovation majeure du Sindacato paolien : l’apparition pionnière du principe de responsabilité politique
Dans son ouvrage consacré au parlementarisme, Philippe Lauvaux observe, à titre liminaire, que « le problème des origines de l’institution parlementaire reste l’un des moins éclaircis de l’histoire constitutionnelle ». Et, tout en admettant la contribution « déterminante » de la Grande-Bretagne à cet égard, celui-ci note toutefois « qu’elle n’a pas été la matrice unique des institutions parlementaires modernes[72] ». Quoique Philippe Lauvaux ne mentionne pas la Corse à son exposé, le caractère pionnier de la Constitution paolienne de 1755 au regard de l’histoire des régimes parlementaires est pourtant manifeste dès lors que l’on retient comme critère décisif, en la matière, l’existence d’un mécanisme de responsabilité politique du pouvoir exécutif devant une assemblée élue représentant le peuple[73].
Or, l’inclusion du Sindacato au sein d’un texte constitutionnel, au sens moderne de l’acception, eut pour conséquence l’évolution de l’institution républicaine vers un dispositif relevant du parlementarisme moderne et s’insérant dans une logique globale de balance des pouvoirs.
De ce point de vue, l’examen des comptes-rendus des Consulte publiés au journal officiel du Regno di Corsica, atteste d’une singularité quant au contrôle auquel était soumis le Général de la Nation. Celle-ci tient à la procédure applicable, puisque la reddition de comptes s’effectue devant l’assemblée plénière des représentants, mais surtout à sa nature. Le sindicamento des autres agents de l’État repose, en effet, sur le respect de la loi et s’effectue sur pièces aux termes d’un formalisme particulièrement strict[74]. Or, si le respect de la légalité constitue très certainement l’une des composantes du contrôle opéré par les représentants de la Consulta à l’endroit du chef de l’État, celui-ci relève d’une perspective beaucoup plus ample. À titre principal, à travers son discours inaugural, le Général de la Nation recherche, en effet, sans ambiguïté l’adhésion de ses mandataires à la politique menée durant l’année écoulée et la confirmation du lien de confiance duquel dépend la poursuite de sa charge.
Les éléments rapportés par les Ragguagli permettent de conférer une triple fonction au discours du chef de l’État. Il est, en premier lieu, un exercice de justification des mesures adoptées par le Général de la Nation durant l’année écoulée et jugées, par lui, comme étant les plus significatives[75]. Ainsi, le discours prononcé en ouverture de la Consulta de 1765, et qui semble être reproduit in extenso[76], est consacré exclusivement à la question de l’arrivée des troupes françaises au sein des présides littoraux. À cette occasion, Paoli y décline ses principales initiatives sur le sujet en prenant soin de motiver systématiquement son action au regard de ce qu’il considère comme l’intérêt national – « senza pregiudicare i diritti della nostra libertà e indipendenza » – et en ne manquant pas de présenter celle-ci comme la mise en œuvre fidèle des orientations arrêtées antérieurement par les représentants du peuple (« avete altresì potuto scorgere che non mi sono punto scostato da quanto mi fu prescritto nel riferito ultimo congresso »).
Moment de justification, le discours inaugural est, en second lieu, un appel à la légitimation formelle de la politique menée entre deux consulte. Aussi, Paoli lui-même ne présente pas ces déclarations comme un simple moment d’information mais bien comme une procédure d’approbation de son action. Dans son discours de 1765, le Général de la Nation sollicite explicitement « la comune approvazione e il gradimento » des délégués et conclut en espérant mériter la confiance de la Consulta (« meritarmi la vostra confidenza »).
Passée la séquence de reddition de comptes à proprement parler, le discours prononcé par le Général en ouverture des travaux de la Consulta se projette, en troisième et dernier lieu, vers l’avenir. En ce sens, il prend la forme d’une invitation adressée aux délégués afin qu’ils adoptent les décisions les plus conformes au bien commun. Or, si cette adresse est parfois formulée en des termes très généraux et préserve, à tout le moins sur le plan formel, la pleine souveraineté de la Consulta à laquelle le Général et le Suprême Conseil d’État ne prennent pas part, il arrive également que le Général évoque très directement certaines questions qui seront soumises au vote ultérieur des représentants et exerce, de ce fait, un vrai ministère d’influence. Aussi, à titre d’illustration, lors de la Consulta de 1766, l’article premier de la délibération qui reconnaît que les « presidiani[77] sont considérés comme membres de la Nation » répond clairement au discours introductif prononcé par Paoli par lequel il faisait état de la volonté de ces habitants de se voir pleinement intégrés à l’État corse en étant reconnus comme « figli e membri della patria[78] ».
Au regard de ces différentes caractéristiques, le discours du Général de la Nation devant la Consulta se situe à mi-chemin entre le mécanisme contemporain de la question de confiance et le Discours annuel sur l’état de l’Union propre au présidentialisme américain. En tout état de cause, il répond sans aucun doute aux canons modernes du principe de responsabilité politique au regard de deux critères essentiels. D’abord, car le « jugement du peuple » auquel fait référence le texte de 1755 procède bien d’une « affectation de valeur à une conduite gouvernementale[79] » et non d’un simple examen de conformité aux lois en vigueur. Ensuite, car il s’agit bien d’une « procédure qui permet de mettre fin à l’exercice du pouvoir politique par un homme ou une équipe qui ne jouissent plus de la confiance des gouvernés[80] ». Sur ce dernier point, les dispositions prises par la Consulta de 1764 laissent peu de place à l’équivoque. En indiquant que la charge de Général de la Nation peut être vacante du fait de son décès, d’un acte d’abdication ou « in qualunque altra maniera », il apparaît évident qu’il est fait ici référence, certes en recourant à une périphrase euphémisante, à une procédure de destitution.
Page 5
[77] Le terme désigne les habitants des présides, villes côtières fortifiées demeurées…
[78] Ragguagli dell’Isola di Corsica, op. cit., p. 616-619 et Ambrogio Rossi…
[79] Philippe Ségur, La responsabilité politique, Paris, Presses universitaires de…
[80] Didier Maus, « Responsabilité », in Olivier Duhamel et Yves Mény (dir.)…
Sur ce point, les quinze années de pratique constitutionnelle du Généralat n’offrent pas d’exemple de sanction révocatoire, ce qui n’invalide nullement l’effectivité et l’intérêt du dispositif. D’ailleurs, dans la plupart des régimes parlementaires contemporains, la sanction demeure la plupart du temps virtuelle sans pour autant ôter au mécanisme sa vocation première, à savoir contribuer à l’équilibre entre les différents pouvoirs. À l’inverse, une trop forte récurrence des crises parlementaires est généralement le symptôme d’une défaillance du régime, ce dont témoignent les IIIe et IVe Républiques en France. En quelque sorte, la menace de la révocation peut être vue comme une meilleure garante d’une balance des pouvoirs harmonieuse que la survenance de crises parlementaires répétées.
L’expérience paolienne confirme que l’engagement de la responsabilité politique du chef de l’État devant l’organe parlementaire constitue une condition sine qua non à la poursuite de son action. Si dans un manifeste politique publié en 1762, le Supremo Consiglio di Stato loue le « zelo » avec lequel Paoli « si sottopose volontariamente al sindacato[81] », les parlementaires considèrent bien sa comparution devant la Consulta, et en personne, comme un devoir constitutionnel[82], ce qui entraîna, du reste, une forte protestation des délégués lorsque le Général, retenu hors de la capitale du fait d’une opération militaire, délégua l’un de ses proches afin de le représenter[83]. Et si les modalités d’expression de l’assentiment parlementaire ne sont pas codifiées, les comptes-rendus publiés aux Ragguagli mettent bien en évidence la formulation d’un consentement formel, parfois accompagné d’instructions ou d’encouragements[84].
La soumission des conseillers d’État à un contrôle relevant de la responsabilité politique demeure, en revanche, une question ouverte en l’absence de documentation idoine. Quand bien même retenons nous l’hypothèse de leur contrôle annuel par l’organe législatif, l’imputation à leur endroit de motifs d’ordre politique semble peu évidente eu égard à la logique d’ensemble de l’architecture constitutionnelle. En effet, le mandat viager dont dispose, à titre exclusif, le Général de la Nation, implique logiquement, en contrepartie, l’exigence d’un renouvellement annuel de la confiance des parlementaires. En revanche, la menace d’une cessation du mandat des conseillers d’État pour rupture du lien de confiance est inopérante au sens où l’exercice de leur pouvoir est limité par des principes issues de la plus pure tradition romaniste, à savoir l’annalité et la non-itération des charges[85]. En ce sens, il semble vain de vouloir destituer un ministre, au prétexte d’un désaccord de fond, alors que son mandat arrive, en toute hypothèse, à terme et qu’il ne pourra plus exercer ladite fonction qu’après avoir observé une période de contumacia[86] ou repos forcé de deux années. En revanche, la responsabilité des conseillers d’État est, en principe, engagée au regard de la conformité aux lois de leur gestion puisque la révision constitutionnelle de 1764 conditionne leur accession future à la fonction à l’obtention de leurs attestations de syndicature[87]. En conséquence, le parlementarisme paolien dénote une forme originale de syncrétisme entre le constitutionnalisme latin de tradition antique et un constitutionnalisme moderne en cours de sédimentation.
Une chose est néanmoins certaine : au regard de l’histoire constitutionnelle, le dispositif de contrôle de l’action du Général de la Nation sous le régime de la Constitution corse de 1755 doit être considéré comme une consécration pionnière du principe de responsabilité politique dans son acception la plus moderne. La démission collective du gouvernement britannique dirigé par Lord North en 1782 qui est usuellement présentée comme l’acte de naissance du principe de responsabilité politique, et partant, du parlementarisme, lui est postérieure de plusieurs décennies[88]. La Suède de l’Ère de la liberté (Frihetstiden) offre, en revanche, des exemples plus précoces de révocation ministérielle pour des motifs de pure opportunité politique par l’invocation de manquements aux « véritables intérêts du Royaume ». La reddition de comptes des sénateurs y est codifiée à l’article 14 du Regeringsform (Forme du Gouvernement de Suède) de 1720 et donnera lieu à de nombreux licentiering dont le premier pourrait être daté de l’année 1738 à travers la résignation volontaire du kanslipresident Arvid Horn[89].
Sans minorer l’apport de l’expérience suédoise au titre des « prodromes de la responsabilité politique[90] », le sindicamento du Général de la Nation corse se présente toutefois sous des traits plus conformes à la définition moderne du parlementarisme qui postule la responsabilité gouvernementale devant une assemblée représentative du peuple selon une dimension holistique. Or, cela est bien le cas de la Consulta ou « Dieta generale del popolo corso » mais pas des États de Suède qui demeuraient une « assemblée d’ordres[91] » et non « pas un parlement, ni au sens médiéval, ni au sens contemporain[92] ».
Enfin, alors que le déclenchement des dispositifs suédois et britanniques est abandonné à une logique de discrétionnalité des parlementaires ou du gouvernement – à l’instar de la plupart des votes de censure ou de confiance actuels – le parlementarisme paolien se distingue par la périodicité et la systématicité de sa procédure de mise en jeu de la responsabilité politique. Or, si cet élément n’est pas un critère déterminant quant à l’existence d’un régime de type parlementaire, il traduit une conception particulièrement aboutie de la logique d’accountability des responsables publics[93].
III. Les (rares) survivances du sindicamento en droit constitutionnel : le cas singulier du Collegio garante de la Repubblica di San Marino
La chute du gouvernement national au printemps 1769 marque la fin de l’expérience constitutionnelle paolienne et la disparition subséquente du sindicamento. Élément central du dispositif de 1755, le Sindacato est absent au sein du dernier grand texte constitutionnel corse : la Costituzione Del Regno di Corsica (usuellement baptisée Constitution du Royaume anglo-corse) adoptée par la Consulta de Corti du 17 juin 1794. Ou du moins, il n’y réapparaît pas sous sa forme traditionnelle. En revanche, la technique éprouvée par la Constitution de 1755 connaît une postérité partielle par l’introduction d’un principe de responsabilité politique de l’exécutif par lequel le Parlement est habilité à demander le renvoi du Vice-Roi et qui, par le truchement d’une crise extraparlementaire, aboutira de facto au renversement collectif du Consiglio di Stato, évoluant ainsi davantage vers un fonctionnement parlementariste classique au sein duquel le gouvernement est collégialement responsable devant l’assemblée législative. Il a été, à juste titre, observé que le texte de 1794 était largement influencé par la tradition constitutionnelle britannique à laquelle peut être rattaché le principe de responsabilité gouvernementale[94]. Il n’est cependant pas incongru de penser que ce mécanisme de mise en jeu de la responsabilité politique de l’exécutif se situe au confluent des éléments d’inspiration britannique et de ceux en provenance de la tradition institutionnelle corse[95]. Il serait en effet étonnant que le souvenir d’une pratique si scrupuleusement appliquée durant le Généralat n’ait pas, à tout le moins, facilité la réception du mécanisme en 1794 alors que le texte constitutionnel résulte d’une rédaction commune entre Paoli et le « comité de rédaction » dont Pozzo di Borgo fut le rapporteur d’une part, et Sir Gilbert Elliot, le futur vice-roi, d’autre part.
Page 6
Il est en revanche indéniable que la procédure de sindicamento héritée du républicanisme classique ne connut pas de postérité directe. Ceci étant dit, ultérieurement à la fin de l’État paolien, le droit constitutionnel a offert quelques rares exemples d’institutions relevant du constitutionnalisme latin et répondant, pour tout ou partie, à la lettre ou à l’esprit du sindacato.
Tout en soulignant dès à présent l’absence d’équivalence avec l’expérience corse, la Constitution de l’État de Pennsylvanie adoptée en 1776 offre un exemple original de reddition des comptes des responsables publics. Le texte rédigé sous la présidence de Benjamin Franklin est de nette inspiration antique. Conjointement aux principes d’annalité et de non-itération, on y retrouve un mécanisme de contrôle des gouvernants baptisé « council of censors[96] ». L’institution censoriale, dont l’objet général consiste à « préserver la liberté de la république » est appelée à veiller au bon usage des fonds publics ainsi qu’au respect de l’exécution des lois, deux des caractéristiques traditionnelles du sindacato. À cet effet, les censeurs disposent de pouvoirs d’investigation leur permettant d’ordonner la comparution devant leur tribunal des responsables publics ainsi que la présentation des documents nécessaires à leur office. Enfin, à l’instar des procédures de sindicamento, le Conseil a la faculté de prononcer des « censures publiques ». Toutefois, plusieurs différences notables distinguent l’institution du Sindacato classique. C’est le cas de la curieuse périodicité septennale du contrôle, à laquelle s’ajoute l’absence de prérogatives accusatoires ouvertes au citoyen. Surtout, le dispositif pennsylvanien intègre un mécanisme précoce de contrôle de constitutionnalité qui oriente, en conséquence, son action non seulement à l’endroit des actes du pouvoir exécutif mais également de ceux émanant du pouvoir législatif. Or, il y a là une dissemblance significative avec le sindicato paolien qui s’inscrit dans une logique de plénitude de la souveraineté parlementaire.
L’existence des censeurs pennsylvanien fut de courte durée puisqu’ils furent supprimés en 1790, date à laquelle l’institution devait tenir sa deuxième session. En revanche, l’État du Vermont qui avait dupliqué le dispositif en 1777, le maintint en vigueur jusqu’en 1840.
L’institution des éphores napolitains promue par Francesco Mario Pagano, en 1799, dans son projet constitutionnel pour la jeune république parthénopéenne est habituellement présentée comme l’épigone des censeurs pennsylvaniens. Ce corps de représentants du peuple se voyait conférer la « Custodia della costituzione e della libertà ». À ce titre, il était donc appelé à sanctionner les excès du pouvoir exécutif dans l’hypothèse où celui-ci porterait atteinte aux lois, tout comme au pouvoir législatif s’il venait à usurper leur exécution, cela « riparendo gli eccessi di commissione ed i difetti di omissione ». Par-delà quelques parentés évidentes, le parallèle avec le Sindacato repose ici certainement davantage sur les référents théoriques de Pagano que sur la fonction effective du dispositif. À ce titre, le père du projet de Constitution parthénopéenne fut incontestablement influencé par la prégnance de la culture antique au sein de la littérature du XVIIIe siècle, mais pas seulement. Alors que le texte napolitain est généralement présenté comme un simple duplicata de la Constitution française de l’an III, Antonio Trampus met en lumière l’originalité des développements consacrés aux éphores[97]. Il insiste, en outre, sur l’ancrage des articles figurant au sein de la déclaration des droits au sein d’une culture constitutionnelle issue des Lumières italiennes et notamment de la pensée d’Antonio Genovesi dont Pagano, comme Paoli ou Filangieri, furent les disciples[98]. À cet égard, il mentionne notamment les dispositions du projet relatif aux devoirs des magistrats qu’il relie aux préceptes figurant à la Diceosina de Genovesi où ceux-ci sont décrits comme les dépositaires et gardiens des lois et, partant, du bien public[99]. Aussi, peut-on considérer sans extrapolation excessive que l’éphorat paganien était appelé à jouer, en quelque sorte, un rôle de gardien des gardiens. Le retour du roi Ferdinand VI sur le trône et l’exécution de Pagano, cinq mois seulement après la proclamation de la République, reléguèrent à jamais le corps des efori au rang d’utopie constitutionnelle.
Indépendamment de leurs incontestables disparités, les institutions de contrôle de tradition antique, syndicales ou censoriales, ont été totalement supplantées comme instruments de limitation des pouvoirs par l’approche libérale de la balance des pouvoirs. Le cas de la République de Saint-Marin vient néanmoins relativiser l’idée d’irréductibilité de ces différentes logiques[100]. La plus vieille république du monde offre, en effet, une synthèse particulièrement intéressante par laquelle le constitutionnalisme moderne opère la jonction entre une singulière survivance du sindicato antique, les attributs classiques du parlementarisme que sont la responsabilité gouvernementale et le droit de dissolution et l’existence d’une cour constitutionnelle globalement conforme au modèle kelsénien.
La République de Saint-Marin est, en effet, un étonnant vestige d’« antiche istituzione di libertà » dont Niccolò Tommaseo soulignait les similitudes avec la Constitution républicaine de Pasquale Paoli. À ce titre, l’auteur du Risorgimento italien notait, outre la brièveté des mandats publics, « gli uffizi soggetti a pubblico sindacato » comme l’une des institutions républicaines que les deux États avaient eu en partage[101].
Page 7
Le principe du sindicamento demeure en partie régi par le chapitre XIX du Livre I des Leges statutae Sancti Marini de l’an 1600. Aux termes de ces dispositions, le mécanisme de contrôle s’adresse à l’ensemble des responsables publics qui sont « tenuti a dar ragione del fatto e del non fatto durante la carica e così debbano stare al sindacato ». Il était initialement confié à deux sindacatori élus par l’organe parlementaire. À la suite d’une procédure conférant aux particuliers le droit de présenter des requêtes « per interesse suo, o degli altri », ces derniers étaient tenus de prononcer « la sentenza condannatoria o assolutoria ». Pour ce qui concerne la reddition de comptes des deux « capitaines-régents » qui exercent collégialement la fonction de chefs de l’État pour un mandat de six mois, le mécanisme a survécu en l’état, à travers les siècles[102]. Ainsi, en 1996, les plaintes déposées par des citoyens saint-marinais sur le fondement des statuts de 1600, ont eu pour conséquence la condamnation par les sindacatori de l’un des deux Capitaines-régents à une peine d’inéligibilité de dix années pour des irrégularités dans le maniement des fonds publics.
La révision – matériellement – constitutionnelle de 2002 est venue opérer une petite « révolution[103] » quant à la pratique du Sindacato della reggenza en en confiant la charge non plus à des sindacatori élus par le Parlement mais aux juges du Collegio garante della costituzionalità delle norme nouvellement créé. Alors que le précédent système avait fait l’objet d’objections tenant à son incompatibilité avec les exigences relatives au droit à un procès équitable telles qu’édictées à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme[104], le transfert du sindicamento vers le Collegio garante a permis de maintenir en fonction le mécanisme tout en consolidant les garanties juridictionnelles à cet égard. À titre d’illustration, les règles organisant les obligations d’abstention et les possibilités de récusation des magistrats en cas de conflit d’intérêts visent à préserver leur impartialité, alors que le législateur a également renforcé les assurances relatives à la formalisation des requêtes et au caractère contradictoire de la procédure[105].
Cela étant, la mise en jeu de la « responsabilité institutionnelle » des Capitaines-régents à l’issue de leur charge, s’est adaptée à la réalité des temps sans toutefois pervertir l’institution originelle. Ainsi, chaque citoyen inscrit sur les listes électorales de la République conserve son droit immémorial de présenter des accusations « in ordine al fatto e non fatto » devant le juge constitutionnel[106]. Conformément à la tradition du sindicamento, et afin de faire contrepoids avec cette faculté accusatoire accessible à l’ensemble des membres de la communauté politique saint-marinaise, la loi organique régissant le fonctionnement du Collegio garante retient le principe selon lequel les démarches privées de tout fondement et ayant pour seul objectif de dénigrer la fonction, ainsi que celui qui l’incarne temporairement, exposent le calomniateur à des poursuites pénales[107].
Le concept de responsabilité de l’exécutif recouvre une certaine plasticité au sens où il englobe l’ensemble des « faits commis ou omis dans l’exercice des fonctions auxquelles les Capitaines sont préposés[108] ». Dans sa mise en œuvre, on retrouve certains traits assimilables à une responsabilité de type disciplinaire. En effet, les actes pouvant faire l’objet de sanctions peuvent évidemment concerner des manquements ressortissant à l’exercice des fonctions de Capitaine-régent telles que prévues par la Constitution et les lois en vigueur, ce qui inclue la carence fautive et le conflit d’intérêt. Mais leur responsabilité peut être également engagée sur le fondement de comportements qui, bien que relevant de la sphère privée, porteraient préjudice au prestige de la fonction. Aussi, l’exigence de probité et d’exemplarité semble donc être partie intégrante des obligations résultant du serment prêté par les Capitaines-régents[109].
Du point de vue des sanctions applicables, celles-ci sont strictement liées à l’exercice des fonctions de chef de l’État, étant entendu que la loi organique prévoit un principe d’indépendance des sanctions institutionnelles et des sanctions pénales ou civiles. En conséquence, en l’absence de décision absolutoire, le Collegio garante est en mesure de prononcer des sanctions allant de l’avertissement ou « censure morale[110] » jusqu’à l’inéligibilité avec privation de droits civiques[111].
Le Sindacato della reggenza, dont il est fait, semble-t-il un usage mesuré, se combine au sein du constitutionnalisme saint-marinais avec les techniques du parlementarisme classique (droit de dissolution et motion de censure) comme deux modes complémentaires de limitation du pouvoir des responsables publics. On observera, en outre, que ce parlementarisme spécifique a intégré d’autres éléments de la tradition institutionnelle propre à la République contredisant ainsi l’idée d’une incompatibilité principielle entre le constitutionnalisme d’inspiration romaniste et le constitutionnalisme libéral. En effet, si les chefs de l’État disposent bien d’un droit de dissolution à l’égard du Parlement (Consiglio Grande e Generale), ils l’exercent conformément au principe de collégialité de tradition antique[112]. Aussi, si le Congresso di Stato est bien, de façon habituelle, « politiquement responsable devant le Consiglio », les textes constitutionnels saint-marinais adjoignent explicitement à cette formulation moderne l’obligation de « rendre compte » héritée du vocabulaire républicain classique[113], offrant ainsi au concept anglo-saxon d’accountability une transposition particulièrement aboutie[114]. Pour terminer, dans le cadre de l’engagement de leur responsabilité politique, les ministres répondent à la fois collégialement de la politique générale du Congresso di Stato conformément au principe de solidarité gouvernementale, mais aussi individuellement des actes pris dans l’exercice des compétences propres à la gestion de leur dicastère[115].
Conclusion :
Victime d’une forme de disgrâce de la culture antique et du triomphe corrélatif du constitutionnalisme libéral, cette survivance unique du sindacato sur les pentes du Mont Titan peut, à notre époque être perçue au mieux comme une curiosité, au pire comme une anomalie. Au prétexte de la peine d’inéligibilité prononcée en 1996 par les sindacatori à l’encontre d’un Capitaine-régent, le délégué de l’État italien à l’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe contestait la participation des représentants de la République de Saint-Marin aux travaux de cette instance. Il y dénonçait « un acte dont le contenu pourrait être qualifié de moyenâgeux[116] ». Dans ce cadre, le terme ne visait pas à situer historiquement l’origine du mécanisme mais bien à déconsidérer une procédure que l’orateur considérait comme contraire à une certaine conception de la démocratie.
Pourtant, face à la crise de la représentation qui frappe l’ensemble des démocraties occidentales, la redécouverte de ces « institutions de l’exemplarité[117] » participe de questionnements d’une grande modernité. Aussi, à travers ses travaux, Pierre Rosanvallon démontre que la défiance présente les caractéristiques d’un concept ambivalent. Elle peut, certes, manifester l’une de ces passions tristes et se traduire par « un sentiment destructeur des démocraties », mais peut également se concevoir dans une perspective constructive et être mise au service d’une « vitalité démocratique » dès lors qu’il s’agit « de considérer que tout pouvoir doit être mis sous surveillance et contrôlé, que tout pouvoir doit donner des preuves permanentes que son action est au service du bien commun[118] ». En ce sens, le Sindacato offre assurément quelques pistes pour envisager une « mécanisation de la vertu[119] » adaptée à notre siècle. L’institutionnalisation de la reddition de comptes des gouvernants organisée autour de principes de systématicité et de périodicité, tout comme la participation active des citoyens au contrôle, tempérée par la sanction des accusations malveillantes, constituent autant de pistes qui, loin d’entrer en contradiction avec les préceptes du parlementarisme, nous semblent plutôt contribuer à l’enrichir.
À l’occasion d’une étude consacrée à la purga de taula, l’équivalent catalan du Sindacato, Isidre Llucià i Sabarich conclut son propos en revendiquant la restauration de cette institution caractéristique de « l’esprit du droit public catalan[120] » comme un instrument de réhabilitation du rapport des citoyens à la chose publique. Par extension, à travers le Sindacato, l’« esprit du droit corse[121] », peut sans doute constituer une source d’inspiration en vue de reconsidérer les modalités de mise en œuvre des idéaux républicains et démocratiques, dont l’invocation dans le débat public se limite bien souvent – malheureusement – à un usage strictement rhétorique[122].
Page 8
[118] Pierre Rosanvallon, « La myopie démocratique », Commentaire…
[119] Selon l’expression employée par John G.A Pocock in Le Moment machiavélien…
[120] Isidre Llucià i Sabarich, art. cit., p. 173-174.
[121] L’expression est empruntée à l’ouvrage d’Antoine Leca, L’esprit du droit…
[122] Quant à la place du « fétichisme républicain » dans le discours…
[1] Antonio Trampus, Storia del costituzionalismo italiano nell’età dei Lumi, Rome-Bari, Laterza, 2014, 334 p ; Jean-Philippe Genest, « Les constitutions avant le constitutionnalisme », in François Foronda et Jean-Philippe Genest (dir.), Des chartes aux constitutions. Autour de l’idée constitutionnelle en Europe (XIIe-XVIIe siècle), Paris, Editions de la Sorbonne, 2020, p. 11-12.
[2] Les ouvrages de droit constitutionnel, notamment en France, y font rarement référence à de notables exceptions. Dans son article consacré aux « seize « capitoli » de la Constitution d’Alesani du 15 avril 1736 » (http://www.adecec.net/parutions/pdf/les-seize-%22capitoli%22-de-la-constitution-alesani-du-15-avril-1736.pdf), le regretté Claude OLIVESI faisait notamment mention du traité de Droit constitutionnel et institutions politiques de Charles Cadoux publié aux éditions Cujas au débuts des années 1980 et de l’ouvrage de Didier Linotte : Les constitutions françaises, Paris, Litec, 1991, p. 2-4. Pour des références plus récentes : Stéphane Caporal-Gréco, Pierre-Esplugas-Labatut, Philippe Ségur, Lencka Popravka et Sylvie Torcol, Droit constitutionnel, Paris, Ellipses, 2022, p. 16 ; Hélène Simonian-Gineste, Introduction au Droit constitutionnel, Paris, Ellipses, 2020, p. 39 ; Laurence Baghestani, Raphaël Porteilla, Introduction au droit public, Paris, Ellipses, 2020, p. 65.
[3] Le projet de recherche « Paoli-Napoléon » porté par l’UMR CNRS LISA 6240 de l’Università di Corsica Pasquale Paoli a largement ouvert ses différentes publications et manifestations scientifiques aux aspects constitutionnels de l’œuvre de Paoli et des révolutionnaires corses du XVIIIe siècle (pour un ouvrage récent, voir : Jean-Guy Talamoni (dir.), Héros de Plutarque, Ajaccio, Albiana, 2022, 305 p.). En outre, et sans prétention à l’exhaustivité, on signalera ici les ouvrages et articles suivants : Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, Ajaccio, Albiana, 2018, 120 p. ; Linda Colley, The Gun, the Ship and the Pen. Warfare, Constitutions and the Making of the Modern World, 2021, 512 p. ; Carlos Arturo Duarte Martinez, « La Republica corsa y la invencion de una Constitucion liberal (1755) », Historia Constitucional. Revista Electronica de Historia Constitucional, n° 23, 2022, pp. 237-265 ; Wanda Mastor, « Il modello corso di Pasquale Paoli : la Costituzione del 1755 », in Michela d’Angelo, Rosario Lentini et Marcello Saija, Il « decennio inglese » 1806-1815 in Sicilia. Bilancio storiografico e prospettive di ricerca, Soveria Manneli, Rubbettino, 2020, p. 281. Et pour des références antérieures : Marie-Thérèse Avon-Soletti, La Corse et Pascal Paoli. Essai sur la Constitution de la Corse, Ajaccio, La Marge, 1999, 1200 p. Ou encore Dorothy Carrington, La Constitution de Pascal Paoli. 1755, Ajaccio, La Marge, 1996, 78 p.
[4] Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, op. cit., p. 57
[5] Maurizio Viroli, Républicanisme, trad. Christopher Hamel, Editions Le bord de l’eau, Lormont, 2011, p. 7.
[6] Ou pour le dire avec les mots de Cicéron dans son De oratore « magistratus in populi (romani) esse potestate debent », que l’on pourrait traduire par : les magistrats doivent être soumis au pouvoir du peuple (romain). V. Giovanni Lobrano, Res publica res populi : la legge e la limitazione del potere, Turin, Giappichelli, 1996, 350 p.
[7] À cet égard, la Constitution de Paoli correspond parfaitement au processus d’institutionnalisation du pouvoir et de ses corollaires que sont la sécularisation – la diète générale « décrète » sans aucune référence à une volonté divine – et la dépersonnalisation du pouvoir au sens où l’existence du régime est indépendante de la personne de Paoli comme en atteste la Consulta de mai 1764 qui, en son article 8, prévoit les modalités de désignation du chef de l’État au terme du mandat.
[8] Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, op. cit., p. 35.
[9] Jean-Yves Coppolani, « Le républicanisme de Paoli entre constitutionnalisme latin et constitutionnalisme britannique », in Jean-Guy Talamoni (dir.), Héros de Plutarque, op. cit., Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 2022, p. 94.
[10] Sur cet échange passionnant on renverra à : Eugène Gherardi, Casa Rivarola, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 2023, p. 244-254 et « Antonio Rivarola, un honnête homme », in Kevin Petroni et Christope Luzi (dir.), Anthologie des grands discours sur la Corse et les Corses (XVIIIe-XXe siècle), Paris, Classiques Garnier, 2023, p. 297-323 ; Ange Rovere, Mathieu Buttafoco 1731-1806, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 2015, p. 83-86.
[11] Lettre d’Antonio Rivarola à Mathieu Buttafoco, 9 septembre 1768, in Lettere di Pasquale de’ Paoli. Con note e proemio di N. Tommaseo, Florence, Vieusseux editore, 1846, p. 154.
[12] Lettre de Mathieu Buttafoco à Antonio Rivarola, 23 août 1768, in Lettere di Pasquale de’Paoli, op. cit., p 149.
[13] Ce manuscrit daté du 16 février 1764, généralement connu sous l’appellation de « Mémoire de Vescovato », porte l’intitulé complet de Memoria sopra la Costituzione Politica da stabilire nel Regno di Corsica nella quale si dà un piano generale delle code più essenziali che constituiscono un governo in Republica mista. Philippe Castellin et Jean-Marie Arrighi, Projets de Constitution pour la Corse, Ajaccio, La Marge, 1980, p. 61-73.
[14] Plusieurs éléments adoptés à la Consulta de mai 1764 figurent au manuscrit de Buttafoco. C’est notamment le cas du droit de veto (finalement de nature conditionnelle alors que le mémoire proposait au veto absolu) conféré au Supremo Consiglio di Stato. Aussi, plusieurs indices laissent à penser que le correspondant auquel s’adresse Paoli dans une lettre daté du mois de février 1764, donc en amont de la Consulta, où il indique avoir reçu « il piano, o sia l’ossatura della costituzione » est bien Matteo Buttafoco.
[15] Lettre de Clemente Paoli à Nicodemo Pasqualini, 2 juillet 1774, traduction française, Archives de la Collectivité de Corse, Fonds Pradine. Reproduite in Jean-Pierre Poli, 1769-1789. Vingt années de résistance corse, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 2019, p. 226.
[16] Constitution du Massachusetts, article 30. John Adams, Thoughts on government, April 1776, Founders Archives : « the very definition of a Republic, is “an Empire of Laws, and not of men.” » par référence à James Harrington, : « a commonwealth is a government of law and not of men », James Harrington, « The commonwealth of Oceana » and « A system of Politics », Cambridge University press, 1993, p. 35.
[17] « Nei tempi della libertà non gli uomini ma le leggi governavan la Corsica ». Lettera di un zelante corso in terra ferma ad un Nazionale suo corrispondante in Patria, cité in Jean-Pierre-Poli, op. cit., p. 123.
[18] Nous signalons, à cet égard, la proposition formulée par Erick Miceli, lequel attribue la paternité du texte au père Leonardo Grimaldi. Erick Miceli, « L’essor d’un républicanisme patriotique à la fin des révolutions corses », Lumi, n° 3, décembre 2023, https://m3c.universita.corsica/lumi/.
[19] La Corsica ai suoi figli, réed., Bastia, Editions Ollagnier, 1886, p. 33.
[20] Ibid., p. 8.
[21] Maurizio Viroli, op.cit., p. 81.
[22] Jean-Guy Talamoni, Le républicanisme corse, op. cit., p. 56
[23] Benjamin Constant, « De la liberté des anciens comparée à celle des modernes », in Oeuvres politiques, Paris, Charpentier et Cie, 1874, p. 268.
[24] Propos de Paoli cités par Antoine-Marie Graziani, Pascal Paoli. Père de la patrie corse, Paris, Tallandier, 2002, p. 247.
[25] Nous réservons l’usage de la majuscule lorsque l’expression Sindacato désigne l’institution et utilisons la minuscule lorsque celle-ci renvoie à la procédure de contrôle, par ailleurs qualifiée de sindicamento.
[26] Consulta de mai 1768, articles 7 et 8.
[27] James Boswell, État de la Corse suivi d’un voyage dans l’isle et des mémoires de Pascal Paoli, t. I, Londres, 1769, p. 103.
[28] François-René Jean de Pommereul, Histoire de l’isle de Corse, t. II, Berne, Société typographique, 1779, p. 198.
[29] Jean-Yves Coppolani, « Le sindicamento », Mélanges offerts au Doyen François-Paul Blanc, tome I, Presses universitaires de Perpignan et Presses universitaires de Toulouse I Capitole, 2011, p. 353-364.
[30] Pierre Rosanvallon, La contre-démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Editions du Seuil, 2006, 345 p.
[31] Ibid., p. 29.
[32] Ibid., p. 88
[33] D’une certaine façon, on pourrait ajouter que pour les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle, le Sindacato est une institution toute autant corse que génoise dans la mesure où elle fit l’objet d’un conventionnement, autrement dit d’un pacte, entre les représentants du peuple corse et la Sérénissime au moment de la deditio de 1453 (Giustificazione della rivoluzione di Corsica. Combattuta dalle Riflessioni di un Genovese e difesa dalle osservazioni di un Corso, Corte, Battini editore, p. 207-208). D’ailleurs, après avoir dénoncé les manquements de Gênes à cet égard, les justificateurs observent que cette institution fut – selon leurs termes – restituée lorsque la Corse passa temporairement sous la domination du Royaume de France (Ibid., p. 382).
[34] Sur le sindicamento génois : Riccardo Ferrante, La difesa della legalità. I sindacatori della Repubblica di Genova, Turin, Giappichelli, 1995, 358 p.
[35] Riccardo Ferrante, op. cit., p. 279-308 ou encore, Massimo Galtarossa, « L’idea del tribunato nella storia della Repubblica di Genova », Diritto@Storia, n° 7, 2008.
[36] Jean-Yves Coppolani, « Le sindicamento », art. cit., p. 354 ; Isidre Llucià i Sabarich, « Purgar taula : el present d’une institució historica », Revista de Dret Històric Català, vol. 16, 2017, p. 158.
[37] Les douze livres du code de l’Empereur Justinien, trad. Pascal-Alexandre Tissot, t. II, Metz, Behmer, 1807, p. 236-237
[38] Eschine, « Harangue d’Eschine contre la couronne » ou « Contre Ctésiphon », in Oeuvres complètes de Démosthène et d’Eschine en grec et en français, t. V, nouvelle ed. revue et corrigée par Joseph Planche, Paris, Verdière et al., 1820, p. 37-43.
[39] Cicéron, De legibus, in De la République, des lois, trad., notice et notes par Charles Appuhn, Paris, Flammarion, 1985, p. 203
[40] Jean Bodin, Les six livres de la République, t. II, Lyon, Librairie des Iontes, 1591 p. 316 : « Il y a Cinq Sindicis, pour informer contre le Duc et les gouverneurs apres leur charge expiree, faissant publier s’il’y a personne qui ayt rien à dir contr’eux : et s’ils sont trouvés innocents, on leur baille lettre d’innocence ».
[41] Riccardo Ferrante, op. cit., p. 309.
[42] Tableau de la Suisse ou Voyage pittoresque, t. XI, 2e édition, Paris, Lamy, 1785, p. 189.
[43] Leggi e costituzioni di S.M, Turin, Valetta, 1723, p. 177-182
[44] Bandi e ordini da osservarsi nel Granducato di Toscana, Florence, Stampa granducale, 1776, p. 110-113.
[45] Mireille Peytavin, Visite et gouvernement dans le royaume de Naples, XVIe-XVIIe siècle, Madrid, Casa de Velasquez, 2003, p. 342 et s.
[46] Rosalba Sorice, « Il sindacato in Sicilia nel secolo XVI », in Orazio Condorelli (dir.), « Panta rei ». Studi dedicati a Manlio Bellomo, t. V, Rome, Cigno Edizioni, 2004, p. 245-273.
[47] Isidre Llucià i Sabarich, art. cit., p. 151-175.
[48] Riccardo Ferrante, op. cit., p. 294-308.
[49] Nicolas Machiavel, Discours sur la première décade de Tite-Live, Préface de Claude Lefort, traduit de l’italien par Toussaint Guiraudet, Paris, Berger-Levrault, 1980, p. 41 et s.
[50] Philippe Castellin et Jean-Marie Arrighi, op. cit., p. 70.
[51] Ibid., p. 69 : « Il sera permis à chacun d’accuser un citoyen quelconque d’un crime contre l’État, la Société, le Gouvernement, etc. (…) l’accusateur, s’il ne parvient pas à établir la preuve du crime ou du moins son apparence sera châtié comme calomniateur ». À mettre en parallèle avec Nicolas Machiavel, op. cit., p. 50-52 : « chapitre VIII : Autant les accusations sont utiles dans une république, autant la calomnie y est pernicieuse ».
[52] Jean-Jacques Rousseau, Du contrat social, ou principes du droit politique, Amsterdam, Marc Michel Rey, 1762, p. 278.
[53] Jean-Yves Coppolani, « La Constitution paolienne de 1755, parangon du constitutionnalisme latin ? », in Mélanges en l’honneur de Francine Demichel, à paraître.
[54] Lettre de Paoli à Buttafoco, 12 février 1764 in Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, Pascal Paoli. Correspondance, vol. VI : L’égalité ne doit pas être un vain mot, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 2015, p. 296 : « [l’] assemblea generale la quale [è] padrona della legge ».
[55] Le Gaffiot latin-français de 1934 indique pour « patrona » le sens de « protectrice » et pour « patronus » : « protecteur des plébéiens », « avocat, défenseur (…) protecteur ».
[56] Lors des dernières années du Généralat, le Gran Consiglio était pareillement une structure réunissant des délégués de la Consulta, le Général et les membres du Consiglio di Stato. Il agissait comme une commission chargée d’examiner les projets de lois avant leur examen et approbation par la Consulta en séance plénière.
[57] La Consulta désigne trois sindacatori en 1763 et six l’année suivante.
[58] Consulta de mai 1765.
[59] Consulta de mai 1764, article 10 : « I consiglieri di Stato (…) non possano essere rieletti nella stessa carica se prima (…) non avranno riportate dai supremi sindicatori le credenziali sulla loro buona e lodevole condotta in rapporto all’impiego esercitato ».
[60] Pommereul utilise à cet égard l’expression de « certificat de bonne administration » et Marie-Thérèse Avon-Soletti, traduit le terme de « credenziali » par « brevets de syndicature ». Jean Bodin, quant à lui, parle de « lettres d’innocences » en référence aux décisions rendues par les Supremi Sindacatori génois.
[61] Celui-ci soumet le Général de la Nation au jugement de la dieta generale et renvoie le contrôle des autres magistrats au Sindacato composé de quatre membres et du Général lui-même. Corrobore également cette interprétation du texte, un document conservé aux Archives de Corse qui charge les sindacatori élus de contrôler « tutti i soggetti dei rispettivi governi compressi quelli che anno servito al Supremo Consiglio » (archives de Corse, fonds du gouvernement corse, liasse 28, pièce n° 185).
[62] Bonfiglio Guelfucci, Memorio per servire alla storia delle Rivoluzioni di Corsica, dal 1729 al 1764, Bastia, Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, Ollagnier, Bastia, 1882 p. 178.
[63] Lettere di Pasquale de’ Paoli., op. cit., p. 229-231.
[64] Circulaire du Generale ed il Supremo Consiglio di Stato, 9 février 1764, in Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, Pascal Paoli. Correspondance, vol. VI, op. cit., p. 288-293. Les différents documents officiels attestent du souci constant de garantir l’accès le plus large au droit de recours devant la Sindacato (voir à cet égard, la lettre de Paoli ai diletti popoli della Provincia della Rocca in Lettere di Pasquale Paoli, op. cit., p. 194-195. Aussi, lors de sa dernière réunion ordinaire en mai 1768, la Consulta adopte des mesures exceptionnelles pour garantir l’accès au Sindacato au plus grand nombre, notamment aux veuves, aux pupilles « e altre persone miserabili » en ordonnant la mise à disposition d’avocats à titre gracieux (article 8).
[65] Compte-rendu de la Consulta du 26 décembre 1763 in ibid., p. 208-209.
[66] Leges statutae Santi Marini, Livre I., chapitre XIX.
[67] Lettere di Pasquale de’Paoli, op. cit., p. 232.
[68] On observera à ce sujet, qu’en Italie, l’inertie réglementaire du gouvernement central a retardé de plusieurs décennies l’entrée en vigueur effective du pouvoir régional et que le même phénomène s’est reproduit en Espagne, bloquant ainsi le transfert de nombreuses compétences vers les communautés autonomes. En France, sous la Convention, l’inaction gouvernementale est considérée comme « un attentat à la liberté », sans que les mesures idoines ne permettent d’y mettre en terme. À plus de deux siècles d’intervalle, en 2008, une proposition de loi fut déposée, sans succès, devant l’Assemblée nationale en faveur de la « création d’une injonction d’initiative parlementaire pour le contrôle de l’application de la loi ».
[69] Pour un exemple de sanctions prononcées à l’issue d’un sindicamento concernant les charges de président, auditeur et chancelier d’un Magistrato : Lettere di Pasquale de’Paoli, op. cit., p. 204-207.
[70] Ibid., p. 204 : « avvertiamo però che i ricorsi e reclami che saranno per presentare, sieno sussistenti e veridichi ; poichè in caso diverso, non avranno i ricorrenti altra speranza che di essere severamente castigati come calunniatori, con la pena a noi arbitraria ».
[71] Jean-Yves Coppolani, « La Constitution paolienne de 1755, parangon du constitutionnalisme latin », art. cit.
[72] Philippe Lauvaux, Le parlementarisme, Paris, Presses universitaires de France, 1987, Reed. Numérique Fenixx.
[73] Philippe Lauvaux et Armel Le Divellec, Les grandes démocraties contemporaines, 4e éd., Paris, Presses universitaires de France, 2015, p. 199 : « le seul critère du parlementarisme parait donc être la responsabilité gouvernementale devant une assemblée élue ».
[74] Compte-rendu de la Consulta du 26 décembre 1763, in Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, Pascal Paoli. Correspondance, vol. VI, op. cit., p. 208-209. « Li presidenti di detti magistrati debbano tenere un libro in cui notare tutto ciò che fanno ed operano (…) avvertendoli a non mancare di segnare il tutto distintamente e con sincerità. In detto libro dovranno notare parimenti tutto ciò che entra per qualsivoglia capo o motivo, e tutto ciò che da essi si spende ; significando la cagion così dell’entrata come della spesa ».
[75] Consulta de mai 1768, in Lettere di Pasquale de’Paoli, op. cit., p. 133 : « eccovi, o signori, la seria degli avvenimenti più rimandabili, e quella di mia condotta dall’ultima general Consulta sino all’apertura della presente ».
[76] Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, Ragguagli dell’Isola di Corsica, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 2021, p. 586-589.
[77] Le terme désigne les habitants des présides, villes côtières fortifiées demeurées aux mains de la République de Gênes.
[78] Ragguagli dell’Isola di Corsica, op. cit., p. 616-619 et Ambrogio Rossi, Osservazioni storiche sopra la Corsica, Livre XI : 1761-1769, réed. Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, Bastia, Ollagnier, 1903, p. 242-243.
[79] Philippe Ségur, La responsabilité politique, Paris, Presses universitaires de France, 1997, p. 17.
[80] Didier Maus, « Responsabilité », in Olivier Duhamel et Yves Mény (dir.), Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Presses universitaires de France, 1992, p. 926.
[81] Manifeste du Supremo Consiglio di Stato du 7 septembre 1763 en vue de la Consulta de Corti, in Antoine-Marie Graziani et Carlo Bitossi, Pascal Paoli. Correspondance, vol. V : Le temps des espérances, 1762-1763, Ajaccio, Editions Alain Piazzola, 2011, p. 162-163.
[82] La réponse de la Consulta au discours inaugural prononcé par le chef de l’État en mai 1765 offre un témoignage de la façon dont les députés pouvaient formuler leur quitus à la politique menée : « La suprema General Consulta del Regno, intesa e considerata la relazione fatta da sua Eccellenza il signor generale (…), lodando e approvando in tutte le sue parti il contenuto di essa relazione, ha incaricato il presidente generale di passarne a nome dell’assemblea un atto di ringraziamento all’Eccellenza sua; ed ha inoltre determinato che egli debba proseguire a coltivare que’mezzi che riconoscerà più propri… » (in Ragguagli dell’Isola di Corsica, op. cit., p. 590-591).
[83] Il s’agit de l’épisode que Marie-Thérèse Avon-Soletti nomme l’ « affaire Barbaggi » (op. cit., p. 843-844) et dont plusieurs auteurs, dont Pommereul, font mention. Si l’on ne trouve pas trace des protestations de la Consulta à la lecture des archives officielles, les Ragguagli confirment que Paoli est bien demeuré à Roglianu afin de superviser le siège de Macinaghju au moment où se tenait la réunion des députés et y a mandaté Giuseppe Barbaggi : Ragguagli dell’Isola di Corsica, op. cit., p. 202-203 : « Ebbimo qualche apprensione, che esso signor generale si allontanasse da noi per andar a presedere al congresso che si è tenuto in Corti. Né si calmarono le nostre inquietudini, che allora quando ci assicurò che con le instruzioni avrebbe mandato in Corti il signor Barbaggi, ed avrebbe continuato a restar tra di noi ».
[84] Ibid., p. 591.
[85] Consulta du mois de mai 1764, articles 3 et 10. La constitutionnalisation par les articles 5 à 8 du cursus honorum est un autre élément provenant en droite ligne de la culture romaniste. En substance, ne peuvent accéder aux fonctions suprêmes que les magistrats ayant déjà gravi les échelons des magistratures subalternes.
[86] Consulta de mai 1764, article 10. La contumacia est l’équivalent du divieto florentin, à savoir « uno spazio di tempo legittimo in cui i magistrati che uscivano di carica non potevano essere rieletti » et par lequel « ritornavano essi allora nell’eguaglianza repubblicana ; si trovavano soggetti, come tutti gli altri privati cittadini, all’impero delle leggi, all’autorità di coloro cui avevano precedentemente comandato » (Simondo Sismondi, Storia delle repubbliche italiane de’ secoli di mezzo, vol. II, Lugano, Storm e Armiens, 1838, p. 1043). Sous la Constitution de Paoli, l’interdiction d’exercer de nouvelles charges revêt une portée moins absolue et se limite à l’ultime fonction exercée, les anciens conseillers d’État participant notamment aux travaux des Congrès extraordinaires, du Gran Consiglio et même de la Consulta.
[87] Consulta du mois de mai 1764, article 10.
[88] À l’instar d’Adhémar Esmein (Éléments de droit constitutionnel français et comparé, réed., Paris, Editions Panthéon Assas, 2001, p. 166, Philippe Lauvaux (Le parlementarisme, op. cit.) considère la démission du gouvernement North comme l’acte fondateur du principe de responsabilité gouvernementale alors qu’il qualifie – seulement – de « quasi parlementaire » la démission individuelle de Lord Walpole, en 1742, suite à des accusations de corruption.
[89] Jean-Paul Lepetit, « La constitution suédoise de 1720. Première constitution écrite de la liberté en Europe occidentale, Jus Politicum, n° 9 : « Constitutions écrites dans l’histoire », 2013, 161 p. 89-92.
[90] Philippe Lauvaux, « Aspects historiques de la responsabilité politique », in Olivier Beaud et Jean-Michel Blanquer, La responsabilité des gouvernants, Paris, Descartes, 1999, p. 20.
[91] Jean-Paul Lepetit, art. cit., p. 155.
[92] Ibid., p. 34
[93] Wanda Mastor, « Il modello corso di Pasquale Paoli : la Costituzione del 1755 », art. cit.
[94] Jean-Yves Coppolani, « La Constitution du Royaume anglo-corse », in Pasquale Paoli. Aspects de son œuvre et de la Corse de son temps, Ajaccio, Albiana, 2008, p. 172-189.
[95] Au titre des apports de la tradition constitutionnelle corse au bénéfice de l’architecture institutionnelle de 1794, Jean-Yves Coppolani relève notamment le maintien du Conseil d’État et surtout de la Consulta en tant qu’organe législatif monocaméral disposant du pouvoir constituant ou encore le rétablissement des institutions locales traditionnelles. V. Jean-Yves Coppolani, op. cit., p. 182.
[96] Constitution de Pennsylvanie (1776), section 57. Sur le sujet : François Charbonneau, « Une autre idée a pris place en Amérique. L’impact du conflit impérial (1765-1775) sur l’adoption des constitutions étatiques américaines (1776-1780) », Jus Politicum, n° 1 : « Le droit politique », 2008 ; Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 93-105.
[97] Federica Morelli, Antonio Trampus (dir.), Progetto di costituzione della Repubblica napoletana presentata al governo provvisorio dal comitato di legislazione, p. 112 et s.
[98] Antonio Trampus, « Un modèle pour le constitutionnalisme des Lumières : la culture napolitaine et les droits de l’homme », Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2007, http://journals.openedition.org/nuevomundo/3479
[99] Antonio Genovesi, Della diceosina ossia della filosofia del giusto, Livre II, chapitre IX, Milan, Società tipografica de’ classici italiani, 1835.
P 513 : « Un magistrato non è già un Legislatore, solo un esecutore delle leggi (…) Da niun’altra cosa dee tanto maggiormente astenersi un magistrato, quanto dalla violazione di quelle leggi, di cui egli è custode. (…) Un altro dovere del Magistrato si è l’amor della patria, cioè del pubblico bene. Ogni Repubblica non è che l’unione delle utilità dei privati. Siccome ogni privato mette le porzioni de’ suoi diritti in comune, i Magistrati non sono che i custodi di tali depositi». La publication de la première édition de la Diceosina est postérieure au séjour napolitain de Paoli, néanmoins on rapprochera l’extrait précédent de cette délibération prise par la Consulta en 1763 : « si avvertono (…) i magistrati (…) che a loro compete solamente l’esecuzione delle leggi, e non la facoltà di formarle», v. note n° 52.
[100] Michel Troper, « La question du bicamérisme en l’an III », in Pierre Serna (dir.), Républiques soeurs. Le Directoire et la Révolution atlantique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, http://books.openedition.org/pur/124185.
[101] Niccolò Tommaseo, « Proemio », in Lettere di Pasquale de’Paoli, op. cit., p. CLXXXI.
[102] La compétence du Collegio garante en matière de sindicamento se limite au Sindacato della reggenza. Toutefois, aux termes de l’article 6 de la loi constitutionnelle n° 185 du 16 décembre 2005, les citoyens peuvent présenter aux Capitaines-régents leurs plaintes relatives à l’action des autres organes de l’État.
[103] Ludovico Luis Espinoza, L’ordinamento costituzionale di San Marino e il ruolo del Collegio garante della costituzionalità delle norme, Tesi di Laurea, Università di Pisa, Dipartimento di Giurisprudenza, 2015, p. 114.
[104] Cour européenne des Droits de l’Homme, 1§ mars 1999, Bugli c/ Saint-Marin, n° 35635/97 ; Conseil de l’Europe. Assemblée parlementaire, session ordinaire, 27-31 janvier 1997, compte-rendu des débats, t. I, p. 4.
[105] Loi qualifiée n° 55/2003 du 25 avril 2003, art. 17 et art. 21 à 23.
[106] À cet égard, on peut être surpris que la tradition constitutionnelle saint-marinaise n’ait pas influencé davantage l’exercice par le Collegio garante des fonctions classiques inhérentes au contrôle de constitutionnalité. Aussi, on ne retrouve pas de mécanisme de saisine citoyenne du juge constitutionnel par voie d’action à l’instar de ce qui peut exister en Allemagne mais simplement un droit de saisine par voie d’exception semblable à l’amparo espagnol ou la question prioritaire de constitutionnalité française.
[107] Loi qualifiée n° 55/2003 du 25 avril 2003, art. 17, al. 9.
[108] Ludovico Luis Espinoza, op. cit., p. 114.
[109] Luigi Lonfernini, Diritto costituzionale sanmarinese, San Marino, Guardigli editore, 2006, p. 212 : « Le funzioni d’Ufficio a cui sono preposti (…) non sono esclusivamente quelle previste dalla carta costituzionale e dalle leggi di attuazione, ma si ampliano assorbendo tutte le attività che con il giuramento si impegnano a promuovere e rispettare ».
[110] CG 31 mai 2011, n° 8.
[111] V. note 104.
[112] Legge costituzionale sui capitani reggenti, n° 185/2005, art. 3.
[113] Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese, art. 3.
[114] Voir à ce sujet : Pierre Avril, « Responsabilité et accountability », in Olivier Beaud et Jean-Michel Blanquer (dir.), op. cit., p. 85-93.
[115] Legge costituzionale sul congresso di Stato, n° 183/2005, art. 5.
[116] Conseil de l’Europe. Assemblée parlementaire, ibid.
[117] Eric Buge, « L’exemplarité ou les institutions de la vertu », Jus Politicum, n° 28, [https://www.juspoliticum.com/article/L-exemplarite-ou-les-institutions-de-la-vertu-1488.html]
[118] Pierre Rosanvallon, « La myopie démocratique », Commentaire, n° 131, 2010, p. 603.
[119] Selon l’expression employée par John G.A Pocock in Le Moment machiavélien, Paris, Puf, 1997, p. 283.
[120] Isidre Llucià i Sabarich, art. cit., p. 173-174.
[121] L’expression est empruntée à l’ouvrage d’Antoine Leca, L’esprit du droit corse d’après le plus ancien code insulaire, les statuts de San Colombano de 1348, Ajaccio, La Marge, 1990, 164 p.
[122] Quant à la place du « fétichisme républicain » dans le discours politique en France, nous renvoyons au texte de la conférence inaugurale prononcée par François Sureau à l’Università di Corsica Pasquale Paoli, le 28 septembre 2023, en sa qualité de parrain de la rentrée solennelle de la Faculté de Droit et de Science Politique : https://www.universita.corsica/fr/francois-sureau/.
D'autres articles

La Loi Toubon et la Loi 101 de la philosophie au droit : la France et le Québec entre républicanisme et libéralisme
Comme les travaux menés par Joseph-G. Turi à la fin des années 1980 l’ont démontré, les législations linguistiques québécoise et française visaient toutes deux la consécration d’une seule langue officielle, mais avaient fait l’objet d’interprétations plutôt favorables à une langue autre[2]. Depuis…

Pasquale Paoli et sa documentation sur les régimes mixtes de l’Antiquité
Qu’est-ce que les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle ont cherché dans la documentation antique à propos des régimes mixtes et, surtout, qu’y ont-ils trouvé ? C’est une question que l’on abordera en la circonscrivant à des limites raisonnables, c’est-à-dire à un personnage, Pasquale Paoli, et à sa…

Échanges avec Vincent Peillon
Jean-Guy TALAMONI
Merci, Vincent Peillon, pour cette conférence qui ouvre des pistes et présente des idées nouvelles, à plusieurs titres. Il serait intéressant qu’il y ait un échange avec les collègues qui sont présents à ce colloque. D’autant que…