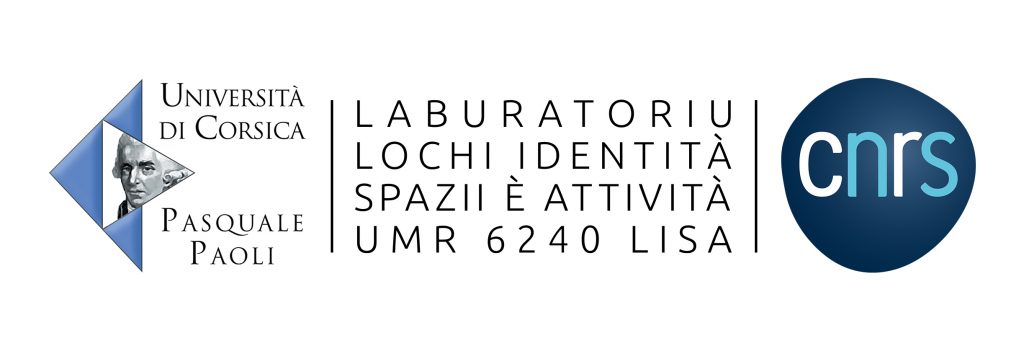L’idée républicaine dans les débats constituants américains du XVIIIème siècle
Wanda Mastor
Il est classique, à propos du régime des États-Unis, d’évoquer spontanément l’idée de démocratie plus que celle de la République. Toute une série de raisons expliquent ce réflexe quasi inconscient.
La première est culturelle. Un intellectuel qui réfléchit au régime américain, quelle que soit par ailleurs sa spécialité, ne saurait occulter la force d’une référence universelle : celle de La démocratie en Amérique de Tocqueville[1]. Lorsqu’il quitte le Havre avec Gustave de Beaumont le 2 avril 1831, le jeune Alexis de Tocqueville n’avait sans doute pas conscience de l’immensité de l’œuvre qu’allait nourrir ce voyage en Amérique. De la démocratie en Amérique est tout d’abord un chef-d’œuvre littéraire. Dès les premières lignes de l’introduction, le lecteur est séduit par une plume visuelle, toujours subtile mais jamais obscure. Le style intelligent d’un voyageur qui fait partager ses carnets de voyages ; celui du futur homme politique qui entend tirer de cette expérience des leçons pour son propre pays. Il s’agit ensuite d’un chef-d’œuvre juridique. On a souvent loué la clairvoyance de Tocqueville, son génie visionnaire. Lui-même saluait sa propre prophétie. Dans l’avertissement de la dixième édition, l’auteur formalise le projet qui l’animait au moment de l’écriture : « Ce livre a été écrit il y a quinze ans, sous la préoccupation constante d’une seule pensée : l’avènement prochain, irrésistible, universel de la Démocratie dans le monde ». Et avoue plus loin que l’avènement de la République a rendu « prophétiques » certaines de ses lignes rédigées à l’époque de la Révolution de Juillet.
La seconde raison découle, non d’une erreur, mais d’une confusion largement répandue entre les deux termes, les Anciens eux-mêmes les utilisant parfois indifféremment.
Dans La politique, Aristote distingue trois formes de gouvernements : la royauté, l’aristocratie, la République, dont les déviations sont respectivement la tyrannie, l’oligarchie et la démagogie, « le plus supportable des mauvais gouvernements »[2], mais qu’il condamne néanmoins, contrairement à Platon visé implicitement : « Un écrivain, avant nous, a traité le même sujet; mais son point de vue différait du nôtre : admettant que tous ces gouvernements étaient réguliers, et qu’ainsi l’oligarchie pouvait être bonne aussi bien que les autres, il a déclaré la démagogie le moins bon des bons gouvernements, et le meilleur des mauvais ». Et Aristote d’ajouter que « Nous, au contraire, nous déclarons radicalement mauvaises ces trois espèces de gouvernements ; et nous nous gardons bien de dire que telle oligarchie est meilleure que telle autre ; nous disons seulement qu’elle est moins mauvaise »[3].
Expliciter le lien, les différences entre démocratie et République est une vraie difficulté tant les deux concepts et réalités sont souvent confondus. Il existe des démocraties qui ne sont pas des Républiques (le Royaume-Uni) et des Républiques qui ne sont pas démocratiques (la République populaire de Chine). Aristote lui-même, pouvant être considéré à bien des égards comme le père du constitutionnalisme moderne, entretient cette confusion en présentant la République comme le « mélange » -le mot est le sien- de la démocratie et de l’oligarchie[4]. Pour le Stagirite, la démocratie est la souveraineté, non du plus grand nombre, mais des pauvres : « C’est une erreur grave, quoique fort commune, de faire reposer exclusivement la démocratie sur la souveraineté du nombre »[5], tandis que l’oligarchie est la domination des riches.
Proposons le lien suivant entre la démocratie et la République : la première est une forme de gouvernement, dont la seconde est l’habillage institutionnel. La République peut être considérée comme le choix du cadre juridico-politique dans lequel s’épanouit la démocratie, en tant que gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Elle est l’armature choisie, donc quelque part artificielle, de quelque chose qui ne peut pas exister dans son expression la plus pure.
Admettre la démocratie, c’est admettre que la souveraineté, c’est-à-dire le pouvoir absolu, premier et dernier, la compétence de la compétence, n’appartient qu’au peuple. L’une des grandes questions qui ont présidé à la naissance des premières constitutions fut la suivante : de quel peuple parle-t-on ? À Athènes, berceau de la démocratie, tous les êtres humains n’étaient pas des citoyens. Étaient exclus de l’Ecclesia, les femmes, les esclaves et les métèques. Aristote lui-même, né à Stagire, faisait partie de ces derniers et n’avait pas le droit de participer à la vie politique de la Cité. Pour son maître Platon l’idéaliste, qui était citoyen d’Athènes et originaire d’une grande famille, le peuple dominant devait être celui des aristocrates, dans le sens des savants, des sachants, avec le philosophe-Roi comme leader potentiel. L’expression ne figure pas dans son œuvre mais il est classique de tirer cette image du dialogue entre Socrate et Glaucon dans La République : « À moins que, dis-je, les philosophes n’arrivent à régner dans les cités, ou à moins que ceux qui à présent sont appelés rois et dynastes ne philosophent de manière authentique et satisfaisante et que viennent à coïncider l’un avec l’autre pouvoir politique et philosophie ; à moins que les naturels nombreux de ceux qui à présent se tournent séparément vers l’un et vers l’autre n’en soient empêchés de force, il n’y aura pas, mon ami Glaucon, de terme aux maux des cités ni, il me semble, à ceux du genre humain »[6].
Page 1
C’est une vision que l’on pourrait qualifier, au prix d’un anachronisme, d’élitisme politique. Pour Aristote le pragmatique, c’est aux pauvres que doit appartenir le pouvoir puisque ce sont eux qui sont en nombre majoritaire, et Aristote de préciser comme déjà souligné plus haut qu’il ne s’agit pas du gouvernement idéal, mais du « plus supportable des mauvais gouvernements »[7].
Le parallèle peut être fait avec la démocratie américaine dont sont exclus les esclaves, et qui va rapidement également épouser des contours élitistes. Ces contours seront ceux de la forme républicaine du gouvernement.
Les États-Unis ont été, et demeurent, la plus grande démocratie au monde. Rien d’axiologique dans cette remarque ; je ne parle pas de « grandeur » du régime, mais bien de sa complétude quand on étudie, de manière neutre, les critères permettant de l’identifier. « We, the People », qui ouvre la Constitution n’est pas qu’une formule cosmétique ornant un parchemin. C’est tout à la fois la source, la légitimité, la clef du fonctionnement et l’objectif ultime de la plus vieille Constitution du monde. Le peuple élit ses représentants à qui il n’abandonne sa souveraineté que par un mandat impératif ; y compris ses juges, qu’il peut également destituer. C’est uniquement parce que le peuple ne peut pas gouverner directement, surtout dans un espace territorial si vaste, que l’armature républicaine est venue habiller cette démocratie née d’une guerre d’indépendance. Et c’est cette idée que l’on trouve au fondement de la République dans ses travaux préparatoires du XVIIIème siècle.
Par « débats constituants » du XVIIIème siècle, nous entendons dans le cadre de cette étude tous les travaux des assemblées délibérantes qui ont entouré l’adoption de la Constitution mais aussi les écrits doctrinaux signés de personnes qui, dans le même temps, siégeaient dans lesdites assemblées. Cet ensemble, depuis les premières résolutions adoptées par les assemblées des colonies jusqu’aux débats de la Convention de Philadelphie, en passant par les célèbres lettres anonymes publiées dans la presse pour défendre le projet de Constitution, forment le socle constituant. Si, en France, les travaux préparatoires de la Constitution de 1958 se limitent aux seuls débats parlementaires, il en va différemment aux États-Unis où les lettres rassemblées sous l’appellation de « Federalist Papers » sont tout autant considérées et estimées[8]. Le travail d’archives est de nos jours rendu possible par les bibliothèques numériques, notamment celles du Congrès[9] et de l’université de Yale, baptisée Avron Project[10].
Pour tenter d’expliquer le triomphe de l’idée républicaine, qui est, en réalité, le triomphe de la démocratie, il faut commencer par en rappeler le contexte historique et surtout, établir les influences intellectuelles qui ont nourri à l’époque les Fouding Fathers. Et poursuivre par le contexte délibérant et les joutes qui les opposèrent au moment de la Convention de la Philadelphie, la République s’imposant comme une réalité pragmatique. Il conviendra donc d’expliquer comment la République a tout d’abord germé en tant qu’idée, héritage de la liberté (I) avant de triompher comme nécessité pragmatique (II).
I. La République comme héritage de la Liberté
L’idée républicaine, au XVIIIème siècle, va germer dans l’esprit de colonies soumises à un oppresseur monarchiste. Sans doute la conquête du Nouveau Monde a-t-elle rapidement forgé de nouveaux tempéraments, exalté des qualités spéciales, tanné le cuir des nouvelles peaux de ces Anglais qui n’en étaient plus. En Europe, la guerre entre l’Angleterre et la France vide les coffres royaux et les colonies vont rapidement être utilisées comme outils d’aide au pouvoir royal. En 1765, l’application aux colonies du Stamp Act démontre que les colons n’ont pas les mêmes droits que les Anglais d’Angleterre et progressivement, les assemblées coloniales vont adopter des motions, résolutions manifestant leur réprobation face aux sanctions douanières et fiscales. En 1767, de nouveaux droits d’importations qui frappent le thé, le verre, le plomb, le papier entrainent réactions modérées (le boycott) ou radicales (la revendication de l’indépendance).
A. Lire les écrivains anglais de la liberté
Patrick Henry, George Mason ou Samuel Adams font partie des seconds : « tous sont issus de milieux aisés, parfois des catégories les plus riches de la population » note l’historien André Kaspi[11]. Ils partagent avec les premiers (Georges Washington, Thomas Jefferson ou John Adams), une culture politique britannique. Leur éducation intellectuelle aura évidemment une influence, voire une conséquence sur leurs choix politiques futurs. Les auteurs de chevet sont les penseurs dissidents de l’Angleterre du XVIIème siècle : Trenchard et Gordon, Milton et surtout John Locke.
Ce point est déterminant pour comprendre le surgissement de l’idée républicaine au moment de l’indépendance. Les Pères fondateurs ont lu et admiré le contrat social proposé par Locke comme ils ont mythifié la Glorieuse Révolution de 1688. Les quatre auteurs cités sont des écrivains de la liberté. Dans la série des Cato’s Letters (tirant leur nom de Caton le Jeune), John Trenchard et Thomas Gordon expriment un point de vue libéral radical : défense de la liberté d’expression, dénonciation de la corruption politique et de toute entreprise coloniale[12]. Ce sont ensuite pas moins d’une centaine d’essais pamphlétaires que les deux auteurs vont publier dans le London Journal entre 1720 et 1723. Essais auxquels les révolutionnaires américains vont vouer un véritable culte. Il en ira de même pour un discours du poète John Milton, surtout connu pour être l’auteur du Paradis perdu. Dans Areopagitica, ou De la liberté de la presse et de la censure, publié en 1644, Milton s’adresse au Parlement de Westminster, pour y défendre la liberté de la presse, supprimée un an auparavant dans le contexte de la première Révolution anglaise. Les premières lignes de l’avant-propos révèlent un courage qui lui coûtera plus tard un enfermement à la Tour de Londres : « Lorsque les voix les plus éloquentes se sont élevées en faveur de la liberté de la presse, lorsque les hommes les plus vertueux et les philosophes les plus éclairés ont démontré son utilité et ses bienfaits, comment se fait-il que, sous un gouvernement constitutionnel, on ose encore réclamer l’esclavage de la pensée ? C’est au nom du bonheur public qu’on propose cette funeste mesure, mais ce n’est qu’un vain prétexte à l’ambition d’audacieux hypocrites qui, sous le nom sacré de religion et de morale, étalent insolemment leur orgueil et foulent aux pieds les droits de la nation »[13].
Quant à John Locke, l’historien Louis Hartz va jusqu’à affirmer qu’il « domine la pensée politique américaine comme jamais un penseur n’a dominé la pensée d’une autre nation » [14]. Domination de l’idée du contrat social mais aussi de la force du droit de propriété dont la préservation, chez Locke, est l’un des fondements des républiques. Les représentants choisis par le peuple doivent lui assurer la protection (la « clôture » écrit Locke) du citoyen-propriétaire[15].
De cet ensemble d’influences littéraires et politiques ressort un goût immodéré pour la liberté et une exaltation démocratique. Le peuple, seul souverain, est libre de former un pacte avec l’État comme il est libre de le dénoncer. À l’image du renversement du roi Jacques II au profit de sa fille Mary et de son gendre William, les révolutionnaires américains croient au droit de résistance à l’oppression. Ils en sont d’ailleurs nés.
B. Retranscrire la liberté de l’Amérique indépendante
Un premier congrès continental se réunit à Philadelphie le 5 septembre 1774, au cours duquel les radicaux l’emportent sur les modérés et avec eux, l’idée de prise des armes. Le deuxième congrès confie le commandement de l’armée à Georges Washington le 15 juin 1775. À son issue, une commission est composée pour rédiger une déclaration d’indépendance autour de John Adams, Benjamin Franklin, Tomas Jefferson, Robert Livingston et Roger Sherman. On sait ce que la Déclaration d’indépendance, adoptée le 4 juillet, doit à Jefferson. Brillant avocat issu d’une famille très aisée de Virginie, Jefferson avouera plus tard avoir trouvé son inspiration dans le Traité de gouvernement de Locke. Les idées ne sont en effet pas nouvelles mais se forment dès ce texte de 1776 les contours d’une conscience nationale. Le mot « peuple » est utilisé plusieurs fois, comme le « nous ». Face à cette philosophie hautement démocratique surgit déjà l’idée républicaine : les signataires indiquent tenir leur mandat « par délégation du bon peuple ». Cette idée de délégation, de représentation est au cœur de la définition de la nouvelle, non République démocratique, mais bien démocratie républicaine.
À partir de l’armistice du 4 février 1783, où « Sa majesté britannique reconnaît que lesdits États-Unis (…) sont des États libres souverains et indépendants », le peuple sera la source de tout pouvoir. Et la République le gouvernement dérivant de ce pouvoir. D’une idée héritée des penseurs anglais mais également des philosophes de l’Antiquité, la République va se muer en nécessité pratique. Les Pères fondateurs rêvent de démocratie directe, tout en reconnaissant son impossibilité matérielle.
II. La République comme nécessité pragmatique
Face à l’oppression du colonisateur, le peuple Américain naissant commence par légitimer sa volonté d’indépendance. Le Préambule de la résolution de la convention de Virginie proclame ainsi, le 15 mai 1776, que la revendication de justice de la part des colonies s’est heurtée « de la part d’une administration impérieuse et vindicative, [à] une augmentation des insultes, de l’oppression, et une tentative vigoureuse d’effectuer notre destruction totale ». La Déclaration d’indépendance, bien avant la Constitution, porte en germe l’un des critères fondamentaux de la République : « The public Good ». Le peuple y proclame ainsi « son assentiment aux lois les plus salutaires et les plus nécessaires au bien public ».
Page 3
A. Prendre garde à la démocratie directe
À la Convention de Philadelphie s’opposent Fédéralistes et anti-Fédéralistes. En-dehors de ce qui sera plus tard baptisé l’Independance Hall, la joute se prolonge par articles de presse interposés. Hamilton, Madison et Jay, sous le pseudonyme de Publius, défendent le projet de Constitution vilipendé par Patrick Henry, Robert Yates et Samuel Byron -occasionnellement sous le masque de Brutus[16]-. Ces derniers entendaient défendre un gouvernement moins centralisé, plus respectueux des États fédérés, et craignaient que le présidentialisme ne dérive vers la monarchie. Ainsi, pour celui qui signe « An Old Whig », la Constitution s’apprête à créer la pire monarchie qui soit : celle d’un « roi élu »[17]. La question du choix de la République n’est donc pas centrale dans ce célèbre débat ; c’est bien plus celle des équilibres qui le fut.
Lors de la Convention de Philadelphie, plusieurs thèmes débattus mettent en avant la question de la forme républicaine du gouvernement. Le 6 juin 1787, les discussions portent sur le mode de désignation de la chambre basse, qui deviendra plus tard la chambre des représentants. Les membres s’opposent sur la définition du corps électoral. Pour Elbridge Gerry, la démocratie ne saurait être synonyme de suffrage universel. « En Angleterre » dit le délégué du Massachussetts, « le peuple perdra probablement sa liberté à cause de la faible proportion de ceux qui ont le droit de vote. Notre danger vient de l’extrême opposé : c’est ainsi qu’au Massachusetts, les pires hommes entrent dans le corps législatif. Plusieurs membres de ce corps avaient été récemment condamnés pour des crimes infâmes. Les hommes de l’indigence, de l’ignorance et de la bassesse ». D’où sa préférence pour un système intermédiaire qui donnerait la primauté au mérite, le peuple désignant certains candidats qui pourraient ensuite être nommés par les États.
Cette idée de la représentation, consubstantielle à la République, est également défendue par Roger Sherman : « Le corps législatif doit être la transcription la plus exacte possible de l’ensemble de la société. La représentation n’est nécessaire que parce qu’il est impossible au peuple d’agir collectivement ». Et le délégué du Connecticut d’ajouter que le peuple est plus heureux dans les petits États que dans les grands. Il défend ainsi l’idée, majoritairement partagée au sein de la Convention, de la nécessité pratique de ne donner la voix au peuple d’un territoire qui plus est trop vaste, que par l’intermédiaire de ses représentants.
B. Privilégier les « citoyens éclairés »
Toujours le même jour, Madison défend le système républicain comme celui de la prévalence de l’intérêt général sur les intérêts particuliers, et le présente comme un « remède » permettant « d’élaborer un système républicain à une échelle et sous une forme telles qu’il puisse contrer tous les maux dont nous avons fait l’expérience ».
Vingt jours plus tard, Madison questionne particulièrement l’objectif du régime que la nouvelle Constitution entend mettre en place. Selon lui, ce doit être tout d’abord de protéger le peuple contre ses gouvernants, ensuite contre ses propres vicissitudes, susceptible qu’il est « d’errer aussi, par inconstance et par passion ». Pour parer à ce danger, le délégué de Virginie propose la sélection du demos, un peu à la manière d’un Platon. « Les citoyens éclairés » propose Madison, « pourraient s’interposer opportunément contre les conseils impétueux ». Le pragmatisme américain qui fascinait déjà tant Tocqueville transparaît des propos du Père fondateur qui ne voit pas en le peuple une masse homogène au savoir supérieur mais plutôt « différentes classes ayant une différence d’intérêts réelle ou supposée. Il y a des créanciers et des débiteurs, des agriculteurs, des commerçants et des industriels (…) Et il y aura la distinction entre les riches et les pauvres ». Et Madison d’anticiper sur les changements qui s’opèreront dans les générations futures en aggravant lesdites différences.
À la question « Comment se prémunir contre ce danger sur la base des principes républicains ? », son partenaire Hamilton prévient qu’il faut offrir au gouvernement républicain « la stabilité et la sagesse nécessaires », sous peine d’être « déshonoré et perdu pour l’humanité pour toujours ». Dans des écrits antérieurs, le même Hamilton avait également insisté sur la nécessité de la représentation, et la supériorité de la République : « Si nous devions comparer nos gouvernements avec ceux des républiques antiques, nous donnerions, sans hésitation, la préférence aux nôtres parce que, chez nous, tous les pouvoirs sont exercés par représentation (…) »[18].
Le principal point de différence entre la démocratie et la République est donc la représentativité, et sera particulièrement développé dans Le Fédéraliste. Madison y écrit ainsi, dans la lettre n°14, que « dans une démocratie, le peuple s’assemble et exerce le pouvoir lui-même ; dans une République, il s’assemble et l’administre par ses représentants et ses agents. Une démocratie en conséquence sera confinée dans un petit espace. Une République peut être étendue sur un grand pays »[19]. Cette question de l’extension de la sphère républicaine n’est pas secondaire dans l’esprit de Madison. De ladite extension découlera également un autre élément pivot de sa théorie : celle du danger des factions. « La multiplication des factions » analyse David Maugouin, « rendue possible par l’extension de la sphère républicaine, doit permettre de réduire leur capacité de nuisance quand l’intérêt général est en jeu et d’empêcher une faction de pouvoir prétendre incarner à elle seule l’intérêt général »[20].
Pour conclure, il pourrait être tentant de se demander si les Pères fondateurs ont réussi dans leur entreprise d’aménagement représentatif de la démocratie. Il pourrait être évidemment avancé, au vu de certains événements qui ont ébranlé l’image de cette démocratie née en même temps que son peuple, que l’équilibre débattu à Philadelphie n’a pas résisté. Non à l’épreuve du temps, mais d’une présidence qui, à bien des égards, n’est comparable à aucune autre. L’assaut du Capitole restera le symbole de l’échec de ce que les Américains pensaient invincibles : leur système politique, leur force démocratique, sans parler de celle de la sécurité.
Mais finalement, il pourrait être aussi avancé que cet épisode, comme d’autres, apportent la preuve que les Pères fondateurs avaient vu juste en alertant sur le danger des factions. Sur la nécessité de maîtriser, canaliser les passions et l’incohérence de ce peuple dont l’homogénéité n’était ni réelle ni souhaitable. Cet instrument de rationalisation fut la République ; dans le détail, ce fut par exemple l’élection si complexe pour un observateur étranger du président par un collège électoral. Il est toujours difficile d’expliquer aux étudiants que dans la plus grande démocratie du monde, le peuple n’élit pourtant pas directement son président.
La réponse était déjà dans les débats constituants du XVIIIème siècle. Malgré toutes les incongruités qui ont par exemple fait entrer à la Maison Blanche des présidents qui ont obtenu moins de voix populaires que leurs adversaires, les Américains préfèrent conserver ce système plutôt que d’en adopter un nouveau qui serait plus « démocratique ». Ils ont en quelque sorte compris que la démocratie qui coulait dans leurs veines historiques avait besoin du rempart républicain.
[1] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Tome 1, Douzième édition, éditions Pagnerre, 1848, 358 pages.
[2] La Politique, livre III, chapitre 2, §2. Sauf indication contraire, les traductions choisies sont du latiniste et helléniste Philippe Remacle, disponibles ici : https://remacle.org/bloodwolf/philosophes/Aristote/politique6.htm
[3] Ibid., livre III, chapitre 2, §4.
[4] Ibid., Livre III, Chapitre VI, §2 : « Après avoir indiqué les motifs de notre classification, passons à l’examen de la république. Nous en sentirons mieux le véritable caractère, après l’examen que nous avons fait de la démocratie et de l’oligarchie ; car la république n’est précisément que le mélange de ces deux formes ».
[5] Ibid., livre III, chapitre 3 §6.
[6] La République, traduction G. Leroux, Paris, livre V, 473 d, Paris, GF, p. 301.
[7] Ibid., livre III, chapitre 2, §2.
[8] James Madison, Alexander Hamilton and John Jay, The Federalist Papers, Penguin Classics, 1987, 517 pages.
[9] https://www.loc.gov/
[10] https://avalon.law.yale.edu/
[11] André Kaspi, Histoire des Américains, tome 1, Naissance et essor des États-Unis, Points, collection Histoire, 2014, p. 113.
[12] John Trenchard et Thomas Gordon, Cato’s Letters: Essays on Liberty, Civil and religious, and other important subjects, edited by Ronald Hamowy, Liberty Fund Inc, reedition 1995, 493 pages.
[13] John Milton, De la liberté de la presse et de la censure, Paris, « Chez tous les libraires », 1826, Avant-propos, Page 6, disponible sur Gallica :
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k424985t/f3.item
[14] Louis Hartz, The liberal tradition in America, New York, Harcourt Brace and World, 1955, p. 140.
[15] Voir surtout dans le Second Traité, sections 124 et 222 : John Locke, Le second traité du gouvernement. Essai sur la véritable origine, l’étendue et la fin du gouvernement civil, PUF, Collection Épimethée, 1994.
[16] Voir The federalist and anti-federalist papers, debates that made America, Complete Works, Pacific Publishing Studio, 2009, 398 pages.
[17] An Old Whig, « The powers and dangerous potentials of his elected majesty”, The New-York Journal of December, 11, 1787, cité in Ibid., Antifederalist n°70, p. 363.
[18] « The Continentalist n° 1 », in Morton J. Frisch (ed.), Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, op. cit., p. 43, cité par
David Mongoin, « Le Fédéraliste revisité », Jus Politicum, n° 8 [https://juspoliticum.com/article/Le-Federaliste-revisite-539.html]
[19] Madison, The Federalist, n° 14, p. 84.
[20] David Mongoin, « Le Fédéraliste revisité », op. cit.
D'autres articles

La Loi Toubon et la Loi 101 de la philosophie au droit : la France et le Québec entre républicanisme et libéralisme
Comme les travaux menés par Joseph-G. Turi à la fin des années 1980 l’ont démontré, les législations linguistiques québécoise et française visaient toutes deux la consécration d’une seule langue officielle, mais avaient fait l’objet d’interprétations plutôt favorables à une langue autre[2]. Depuis…

Pasquale Paoli et sa documentation sur les régimes mixtes de l’Antiquité
Qu’est-ce que les révolutionnaires corses du XVIIIe siècle ont cherché dans la documentation antique à propos des régimes mixtes et, surtout, qu’y ont-ils trouvé ? C’est une question que l’on abordera en la circonscrivant à des limites raisonnables, c’est-à-dire à un personnage, Pasquale Paoli, et à sa…

Échanges avec Vincent Peillon
Jean-Guy TALAMONI
Merci, Vincent Peillon, pour cette conférence qui ouvre des pistes et présente des idées nouvelles, à plusieurs titres. Il serait intéressant qu’il y ait un échange avec les collègues qui sont présents à ce colloque. D’autant que…